Encyclopédie de la musique
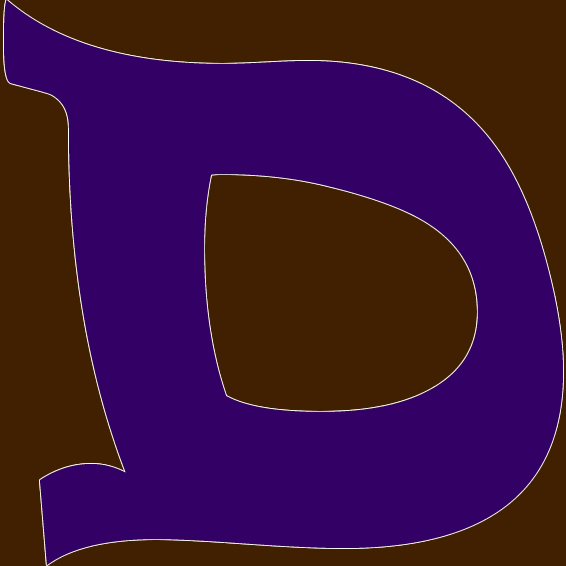
- Da capo
- [italien] : abréviation : D.C. Signe indiquant la répétition d'un passage depuis le début ou d'un endroit précisé par les signes
 ou
ou  . L'endroit où il faut achever la reprise est parfois indiqué par le mot fine. On trouve alors, au point de reprise, l'indication da capo al fine.
. L'endroit où il faut achever la reprise est parfois indiqué par le mot fine. On trouve alors, au point de reprise, l'indication da capo al fine. - Dactyle
- pied de la poésie grecque et latine, formé par une
syllabe longue et deux brèves. Au moyen-âge, les théories de la musique en
font le troisième mode rythmique. Mètre dactyle :
 .
. 

- Daiko
- [japonais, accompagné d'un préfixe ] : mot japonais qui, accompagné d'un préfixese désigne les familles de tambours (taiko) comme tsuri-daiko, da-daiko, o-daiko, nagado-daiko, okedo-daiko, shime-daiko.
- Damaru
- Petit tambour au fût étranglé en son milieu attesté dans l'Antiquité, aujurd'hui au Bengale et au Tibet et quelques régions d'Asie orientale. Les deux peaux peuvent être frappées avec les mains, mais le plus souvent par une ou deux boules de bois attachées par un lacet fixé dans l'étranglement du fût, en faisant basculer l'intrument alternativement.
- Damnation de Faust
- oratorio d'Hector Berlioz
- Danzón
- danse populaire cubaine à 2/4 attestée à la fin du
XVIIIe siècle, qui eut un grand succès au XIXe siècle. Rythme de base et
dérivé :
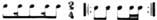
- Darbukka
- tambour de la musique arabe à une peau tendue sur un fût de terre cuite de forme évasé, il est ouvert du côté opposé à la peau parfois doublée de peau de poisson. Il se joue avec les dix doigts, coincé entre les jambes.
- Dasiane
- [notation dasiane] : notation musicale utilisée du IXe siècle dans quelques traités de théorie musicale.
- Davul
- grand tambour cylindrique de la musique militaire ottomane, puis des musiques populaires turques, balkaniques sous des noms variés (Tupan en Bulgarie). Les deux membranes sont frappées par des mailloches de consistance différente, produisant un jeu sur de timbre.
- Déchant
- [s. m., 1164 de dé et chant du latin médiéval discantus] : à l'origine, de mot est synonyme d'organum, c'est à dire de toute forme musicale polyphonique...
- Déchiffrer
- [v.], lire ou exécuter de la musique à première vue, première lecture d'une partition.
- Decisio
- déterminé, accentué.
- Decrescendo
- avec régulièrement moins d'intensité sonore
- Def [daph ; deph]
- Tambourin du Moyen-Orien, de grand diamètre, le deph peut être agémenté à son pourtour de grelots ou de petites cymbales en lation (sonailles). La peau est collée au cadre, souvent confectionné à partir plusieurs parties de bois dur, avec une perce pour passer le pouce. Il est attesté dès le Moyen-Âge, au Moyen-Orient.
- Degré
- (s. m) numéro d'ordre donné à chacune des notes de la gamme du système tonal à partir de la fondamentale. Les degrés sont généralement écrits en chiffres romains. L'intérêt de ce chiffrage est de généraliser les fonctions tonales relatives aux degrés qui sont les mêmes dans toutes les transpositions des gammes majeurs et mineurs. On les appelle aussi, dans l'ordre : tonique, subtonique, médiante, sous-dominante, dominante, subdominante, sensible
- Dehol
- [Dhol ; Dhole ; Dehole ; Dohol] : Tambour à deux faces d'Hindoustan, Arménie, Perse, Pakistan, Penjab, en Somalie...
- Démancher
- [v.] : technique dans le jeu des instruments à archet ; la main gauche de l'exécutant quitte le manche pour se rapprocher du chevalet et évoluer librement sur la touche.
- Demi-ton
- le plus petit intervalle entre deux hauteurs dans le système tonal. Il représente 1/12e de l'octave.
- Dessus
- [s. m. terme ancien désignant ] partie supérieure d'une
composition ;
synonyme de soprano y compris dans les familles d'instruments - Détaché
- [s. m.] : séparer les sons consécutifs ; s'applique particulièrement au jeu des instruments à archet (large coup d'archet pour chaque note)
- Détoner
- [v.] : jouer faux, en dehors du ton ; se dit surtout des solistes ou chanteurs
- Detroit Chamber Trio
- Trio de musique de chambre de Détroit aux États-Unis
- Detryphone
- (ou Tryphone ; Triphon ; Tryphon), un des noms du xylophone au XIXe siècle (xylosistron en est aussi un). Peut-être est-ce du nom d'un certein Charles de Try, qui rebaptise ainsi le xylophone, dont il aurait été un virtuose, vers les années 1860. Il aurait contribué à l'introduction de cet instrument à l'orchestre. Le plus célèbre exemple en est son utilisation dans la Danse Macabre (1874) de Camille Saint-Saëns.
- Développement
- [s. m.] : terme de composition musicale désignant la partie qui suit l'exposition qui en réélabore des éléments selon diverses techniques de composition, de transformations, de prolifétration, de combinaisons. En général une rééxposition de la phrase initiale suit le développement.
- Dhol (doli)
- tambour à double face, tendu de peaux de veau ou de mouton. Instruement de la musique traditionnelle géorgienne.
- Diable
- (en musique)
- Diapason
- [s. m.] : convention fixant la hauteur d'un son de référence. Actuellement et instrument le donnant.
- Diapente
- Dans l'antiquité et au moyen-âge désigne l'intervalle de quinte
- Diaphonie
- [s. f.] : dans l'antiquité diaphonie désigne les dissonances, c'est à dire tus les intervalles
sauf la quarte, la quinte, l'octave
 Au moyen-âge, diaphonie est synonyme d' organum ou de de déchant
Au moyen-âge, diaphonie est synonyme d' organum ou de de déchant  En électroacoustique désigne la capacité d'un système à séparer les
canaux stéréophoniques
En électroacoustique désigne la capacité d'un système à séparer les
canaux stéréophoniques - Diastématique
- représentation spaciale de la hauteur des notes (les notes graves en bas, les notes aiguës en haut)
- Diatessaron
- dans l'antiquité et au moyen-âge désigne l'intevalle de quarte
- Diatonique
- dans le système tonal, succession de notes de noms
différents comme do-ré bémol ; do-do dièse est chromatique
 Dans l'antiquité, désignait l'une des trois formes des modes théoriques
musicaux : diatonique, chromatique, enharmonique
Dans l'antiquité, désignait l'une des trois formes des modes théoriques
musicaux : diatonique, chromatique, enharmonique - Diatonisme
- qualité de ce qui est diatonique
- Dictée musicale
- exercice qui consiste à noter ce qu'on entend.
- Dictionnaires de musique (bibliographies)
- Dictionnaires musicaux / terminologie musicale
- Dictionnaires biographiques (bibliographie)
- Didon et Enée
- (Dido and Æneas), opéra d'Henry Purcell et Nahum Tate
- Dièse
- [s. m.] : signe d'altération marquant l'élévation d'un demi-ton chromatique la note qu'il affecte il se note : #
- Differentia
- désigne les différentes terminaisons ou cadences possibles dans un ton de psalmodie
- Diminué
- [adj. qual.] : se dit des intervalles réduits d'un
demi-ton, ou des accords comportant un intervalle diminué.
Exemples d'intervalles diminués à partir du sol :
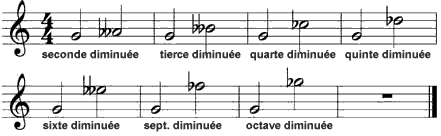
- Diminuendo
- [italien] : indique une diminution de l'intensitésonore dans une partition. Il se note dim. ou s'il doit être graduel, dim.................. Il est le contraire du crescendo.Courant à partir du XVIIIe siècle.
- Diminution
- 1. dans le contrepoint, représenter un thème ou un motif avec des notes diminuées (divisés) en durée, 2. ornementation.
- Diple
- double clarinette de Croatie et de Bosnie, creusée dans un seul bloc de bois. La combinaison des perces respectives des deux tuyaux peut varier (de bourdon à mélodique). On peut fixer cette clarinette à une outre de peau pour en faire une cornemuse, elle prend alors le nom de diple sa mijehom. Les deux tuyaux peuvent diverger, c'est le diple Surle (voir sur cette page).
- Dissonance
- (consonance) : dans un
ensemble, sons ne semblant pas ajustés
 Fonction harmonique ou mélodique chargé des tensions entre le
résolution consonantes.
Fonction harmonique ou mélodique chargé des tensions entre le
résolution consonantes. - Distincto
- [latin, distinct] : dans le plain-chant, incise mélodique intermédiaire.
- Dithyrambe
- [ grec] : choeur accompagné par l'aulos en l'honneur de Dionysos. Les
débuts de la tragédie se seraient développés à partir de la dithyrambe.
 Vers 400 ans avant J.-C, la dithyrambe est une une oeuvre avec des solis
virtuoses.
Vers 400 ans avant J.-C, la dithyrambe est une une oeuvre avec des solis
virtuoses. - Divertimento
- [ italien] : voir «divertissement»
- Divertissement
- au XVIIe siècle, un divertissement est
une compostiton de musique profane sans forme déterminée, de caractère
récréatif
 Au XVIIIe siècle, le divertissement est un ensemble de compositions
instrumentales au caractère de suite récréative, pour ensemble de chambre,
destiné aux fêtes et banquets mais aussi une œuvre courte de circonsatnce
comprenat un ballet, voire une comédie-ballet
Au XVIIIe siècle, le divertissement est un ensemble de compositions
instrumentales au caractère de suite récréative, pour ensemble de chambre,
destiné aux fêtes et banquets mais aussi une œuvre courte de circonsatnce
comprenat un ballet, voire une comédie-ballet
 Au XIXe siècle, ce peut être des pots-pourris sur des airs célèbres
(d'opéras et d'operettes)
Au XIXe siècle, ce peut être des pots-pourris sur des airs célèbres
(d'opéras et d'operettes)  dans la fugue, le divertissement est un passage entre deux enoncés du
sujet
dans la fugue, le divertissement est un passage entre deux enoncés du
sujet - Divisi[ latin]
- abréviaiotn : div. ; divisé. Dans la partition indique que l'effectif d'un pupitre doit se partager, par exemple, pour jouer des intervalles horizontaux peu pratiques ou impossibles.
- Dixieland
- Jazz de la Nouvelle-Orléans, attesté vers 1890 (ce nom parce que situé au Sud de la ligne de Dixon).
- Dixième
- intervalle de dix degrés, c'est aussi l'intervalle de tierce redoublé (une octave et une tierce)




- Do
- syllabe de solmisation apparue au milieu du XVIIe siècle en remplacement de ut. On attribue cette initiative à au cantor Otto Gibelius.
- Dodécaphonisme
- technique compositionnelle créée par Arnold Schönberg dans les années 1920, qui vise à composer avec les douze sons non apparentés entre eux (total chromatique).
- Dohl
- tambour géorgien
- Doigté
- technique de notation de la manière de toucher les notes sur un instrument. En général, on numérote les doigts de la main, et on indexe les notes avec ces chiffres.
- Dolçaina
- Dolce, dolcemente
- calme, tendre, doux, avec douceur ; dolcissimo : très doux
- Doloroso
- [ italien] : douloureux, affligeant, triste.
- Domaine musical
- Le Domaine musical est un groupe musical créé par Pierre Boulez le 13 janvier 1954 pour assurer une diffusion de qualité aux oeuvres d'avant-garde. [ Voir article de Jésus Aguila sur le site du Ministère de la Culture]
- Dominante
- [ n. f.] : cinquième degré des gammes majeurs ou mineures dans le système tonal.
- Domra
- instrument populaire russe en forme de luth à long manche avec 3 cordes, joué avec un plectre dur. Il est remplacé par la balalaïka vers 1700.
- Doppio movimento
- [italien] : mouvement doublé, deux fois plus rapide.
- Dorfmusikantensextett
- nom donné au Divertimento K 522 pour cordes et 2 cors de W.A. Mozart
- Double
- [ n. m.] : Répétition variée d'une danse dans la suite instrumentale aux XVIIe et XVIIIe siècles.
- Douçaine
- Doudouk
- voir Düdük
- Doxologie
- Formule de louange de la liturgie latine. La grande doxologie, action de grâce qui termine l'office du matin est devenue le Gloria de la messe. La petite doxologie est le Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto de la fin des psaumes.
- Dramma per musica
- (ital.). Nom donné pour opéra séria (sérieux) aux XVIIe-XVIIIe siècle. Plusieurs cantates profanes de Johann Sebastian Bach sont sous titrées Dramma per musica.
- Drehorgel
- [f] : allemand pour orgue de barbarie
- Dreigroschenoper (die)
- (L'Opéra de quat'sous) opéra de Kurt Weil (1900-1950), sur un ivret de Berthold Brecht, adapté de l'opéra de Christopher Pepush et John Legay, The Beggar's Opera (l'Opéra des gueux).
- Drehleier
- mot allemand pour vielle à roue
- Droit d'auteur du musicien interprète : glossaire
- Dualisme
- [s. m.], point de vue de théorie musicale basé sur l'opposition ou la complémentarité des modes majeurs et mineurs.
- Duble time (anglais)
- : Mesure à 2 temps
- Ductia
- [s. f.], musique instrumentale à une ou deux voix pour un genre de danse attestée à la fin du XIIIe siècle en France et en Angleterre. La cadence est marquée par une percussion.
- Ductus
- (latin), suite de sons, motif, sujet musical.
- Ductus circumcurrens
- (latin), suite ascendante et descendante de sons.
- Ductus rectus
- (latin), suite ascendante de sons, énoncé original d'un motif musical.
- Ductus reversus
- (latin), suite descendante de sons, énoncé rétrograde d'un motif musical.
- Duda, Dudy
- nom pour les cornemuses à anche simple et tuyau cylindrique.) en Hongrie, Pologne, Ukraine, Biélorussie et Tchécoslovaquie
- Dudelsack
- (allemand) : cornemuse, musette
- Dudka
- chalumeau populaire russe
- Düdük
- nom turc pour désigner le flûte à bec en général. Désigne plus particulièrement une flûte de Géorgie, Croatie, Serbie à sept trous sur le devant et un à l'arrière, avec une large embouchure en forme de disque. Il est d'une sonorité grave, sombre et douce.
- Duduki
- flûte de Géorgie et de Turquie (Düdük)
- Due volte (italien)
- deux fois
- Duetto
-
 duo
duo - Dulcian
- (all.) terme allemand des XVIe-XVIIIe siècles, désignant un basson ancien - Jeu d'orgue à anche.
- Dulciane
- jeu d'orgue attesté en Allemagne au XVIIe siècle, adopté en angleterre et par l'orgue symphonique français du XIXe siècle.
- Dulcimer
- [ s. m.] : nom aglais pour plusieurs types de cithares. Le plus connu est le dulcimer à bourdon, joué avec un plectre, importé par les imigrants installés dans le Tenessee et le Kentucky. Il est un des intruments du Folk Revival, il est surnommé appalachian dulcimer.
- Dumka
- (ukrainien duma = pensée, chant populaire). Ballade épique ou narrative populaire d'origine ukrainienne, répandu en Russie et en Pologne. Voir : Beethoven (10 thèmes variés pour piano, opus 107), Liszt (Dumka pour piano, op. 48), Wieniawski (Dumka pour violon et piano), Dvořák (Dumka et Furiant pour piano, opus 12, Dumka pour piano, opus 35, Trio « Dumky » en 6 parties pour violon, violoncelle et piano, opus 90.), Tchaïkovski (Dumka en do mineur opus.59), etc.
- Dump
- (domp, anglais) chant mélancolique anglais et irlandais attestés aux XVII et XVIIIe siècles.
- Dung chen [rag-dung]
- Duo
- [s. m.] : attesté au XVIe siècle. Composition pour deux voix chantées ou intrumentales ◆ Voir Article Duo du «Dictionnaire de musique» de Jean-Jacques Rousseau
- Duolet
- [s. m] : division binaire dans un rythme ternaire
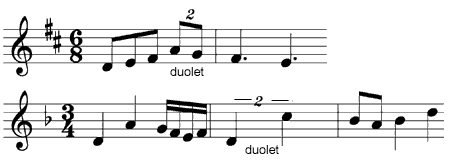
- Duolo
- [Italien], douloureux
- Duplex longa
- [latin], dans la notation mesurée des XIII-XIVe siècles, la note la plus longue. Aussi maxima, double de la longa
- Duplicare
- [italien], doublé
- Duplice
- [italien], deux foix
- Duplum
- [latin], dans le motet ou l'organum, seconde voix accompagnant la voix principale.
- Duplication
- [s. f.] Terme de plain-chant. L'intonation par duplicationse fait par une sorte de périélèse, en doublant la pénultième note du mot qui termine l'intonation : ce qui n'a lieu que lorsque cette pénultième note est immédiatement au dessous de la dernière. Alors la duplication sert à la marquer davantage, en manière de note sensible (Jean-Jacques Rousseau, «Dictionnaire de musique»).
- Dur
- allemand = majeur - Dur, adj. On appelle ainsi tout ce qui blesse l'oreille par son âpreté. Il y a des voix dures et glapissantes, des instruments aigres et durs, des compositions dures. La dureté du bécarre lui fit donner autrefois le nom de B du r. Il y a des intervalles durs dans la mélodie ; tel est le progrès diatonique des trois tons, soit en montant, soit en descendant, et telles sont en général toutes les fausses relations. Il y a dans l'harmonie des accords durs, tels que sont le triton, la quinte-superflue, et en général toutes les dissonances majeures. La dureté prodiguée révolte l'oreille et rend une musique désagréable; mais ménagée avec art, elle sert au clair-obscur, et ajoute à l'expression. (Jean-Jacques Rousseau, «Dictionnaire de musique»).
- Duramente
- [italien], dur, avec dureté
- Dutâr
- Instrument cordophone à manche long et à deux cordes d'Asie centrale.
- dvojnice
- [serbo-crotate], nom pour une flûte double de Yougoslavie.





À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISSN 2269-9910.
Samedi 7 Février, 2026


