Variations sur les « Ave Maria » d’Anna German
 Anna German (1936-1982), Photographie © Jerzy Plonski.
Anna German (1936-1982), Photographie © Jerzy Plonski.
Nous proposons aujourd’hui aux lecteurs de musicologie.org quelques variations improvisées sous la direction d’un expert de cet art de part et d’autre de la très poreuse frontière séparant, prétend-on, musique classique et musique populaire ainsi que musique religieuse et profane, les domaines entre lesquels s’est tenue cette merveilleuse chanteuse dans chacune de ses productions sans qu’on ne parvienne jamais à les différencier vraiment les uns des autres.
Ce que l’on appelle de nos jours l’« Ave Maria » — l’improvisation de Gounod sur le texte religieux de l’Église catholique romaine et la musique très classique du prélude en do majeur du Clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach devenue si célèbre dans le domaine profane qu’il n’est même plus nécessaire de préciser de quelle œuvre on parle — était une des œuvres préférées d’Anna German, probablement même la plus chère à son cœur mais qui n’a jamais eu pour elle qu’une signification purement religieuse. Néanmoins, n’étant pas catholique, elle ne l’a vraisemblablement chanté qu’une seule fois à l’église, et ceci uniquement parce qu’avant qu’elle ne débute sa carrière ses amis l’ont placée dans une situation où il lui était impossible de refuser. C’est aussi l’œuvre qui fait le mieux comprendre sa personnalité exceptionnelle, pourquoi les Russes l’appelaient « sainte » et « divine » et les Polonais « l’ange blanc de la chanson », pourquoi toutes ses chansons profanes font immédiatement sentir à chacun qu’elles sont l’expression d’une foi profonde et à quel point elle était totalement étrangère par nature au monde du show business dans lequel elle a pourtant vécu toute sa vie. C’est encore, croyons-nous, celle qui a le plus puissamment contribué à façonner la spiritualité de son répertoire car c’est l’un des tout premiers morceaux qu’elle a chantés et probablement aussi le dernier. Le lecteur n’aura aucun mal à trouver un enregistrement à son goût de cet air de Gounod, que ce soit pour un instrument solo et chant, accompagné par une petite formation de chambre ou un orchestre, avec ou sans la musique de Bach, car il en existe des dizaines sur Internet dont beaucoup sont interprétés par Anna German. Il se rendra alors compte que jamais, sans doute, cet air qui a figuré au répertoire de tant de chanteurs célèbres, n’a eu de meilleure interprète que cette remarquable chanteuse et, s’il s’intéresse à elle, qu’aucune autre romance, à part « L’Echo de l’amour », surtout lorsqu’elle le chantait a cappella, n’a mieux exprimé sa personnalité.
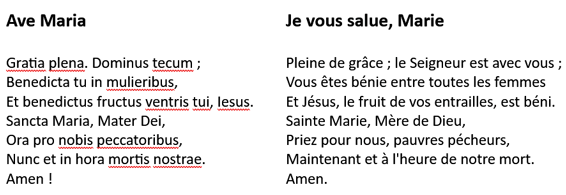
Nous pourrions évoquer l’importance de l’« Ave Maria » dans son enfance mais il nous paraît plus intéressant de choisir comme point de départ l’anecdote mentionnée supra qui date du 28 octobre 1958, soit du milieu de ses études de géologie à Wrocław et qui prouve qu’elle connaissait la pièce par cœur à cette époque déjà. Une de ses amies et camarades d’études, Bogoumila Gorlicka (Bogoumila est un ancien nom slave, plus présent en Pologne que partout ailleurs, qui signifie « chérie de Dieu »), est la première du groupe à se marier. Or en Pologne, un pays très catholique, existe une tradition qui veut que les jeunes gens chantent l’« Ave Maria » à leur mariage. Bogoumila, soutenue par tout le groupe de ses amis étudiants, se rend donc avec eux à l'église avant la cérémonie pour tenter de persuader l'organiste qui doit y participer de donner suite à cette tradition vocale en permettant à Anna de chanter. Celui-ci s’y oppose toutefois au nom du règlement de la cathédrale qui prévoit que seule une chanteuse professionnelle peut être autorisée se produire à l’église et en aucun cas une simple étudiante en géologie. Cependant, le groupe réussit à traîner à la cérémonie une Anna réluctante à y venir et chanter dans ces conditions puisqu’elle a essuyé un refus et qu’il est totalement contraire à sa nature et à son éducation mennonite de passer outre. Elle est du reste depuis la plus tendre enfance ce qu’elle sera toujours, une jeune fille très timide et exceptionnellement modeste, réservée et respectueuse. L’organiste se laisse finalement fléchir et finit par donner son autorisation. Le groupe a sans doute dû exercer malgré tout une grande pression sur lui, et surtout sur elle, pour que tous deux acceptent de contrevenir aussi gravement au règlement de l’église. Toujours est-il que selon son amie, Anna, au moment prévu, se lève, timide et crispée, et qu'elle chante. Dès les premières notes, l’organiste, pourtant à l’abri des vanités de ce monde à sa console, comme tous les organistes, se détourne et la regarde, muet de stupéfaction, comme tous les assistants. Il continue de jouer mais à la fin de la cérémonie il se rend vers elle, lui baise la main et lui dit : « Vous devriez vous occuper de votre voix magnifique, laissez tomber la géologie ! » Bogoumila, bouleversée par l’interprétation d’Anna mais dont on ne sait si elle n’a pas « arrangé » quelque peu cette histoire, conclut en disant qu’ainsi il lui est arrivé ce qu’elle croyait impensable : elle a pleuré à son mariage.
Il existe de très nombreuses autres anecdotes très révélatrices de la place toute particulière que tenait cette pièce dans la vie et le cœur d’Anna German. En 1978, au studio d'enregistrement « Melodia », sous prétexte d'enregistrer une œuvre classique, elle enregistre l’« Ave Maria » et l’envoie à Jean-Paul II, un de ses grands admirateurs. À la même époque, événement rarissime dans toute sa vie, elle ose insister, bien entendu toujours avec la plus grande douceur et la délicatesse dont elle ne s’est jamais départie, pour qu’un programme musical filmé à la télévision polonaise s'ouvre par l’« Ave Maria ». Il s’agissait à cette occasion d’une version avec orchestre. Puis il y a ce fait, peut-être le plus parlant de tous : lors de ses derniers concerts en Union soviétique, que l'on peut qualifier de concerts d'adieu (1979-1980), elle monte sur scène sans aucune annonce préalable, dans l'obscurité totale ; on allume alors un unique projecteur et elle interprète l’« Ave Maria ». Elle vient d’apprendre qu’elle est atteinte d’un cancer trop avancé pour être encore soigné. Elle prend alors également l’habitude de terminer chacune de ses apparitions publiques par cette pièce. Le 31 décembre 1979, elle donne un concert au centre culturel Kapranov de Leningrad. Son amie, la journaliste Lia Spadoni, en laisse le souvenir suivant :
Ce soir-là, j'ai ressenti, dans le public, un terrible sentiment de fatalité et de finitude. Anna est entrée sur scène dans une robe noire et a chanté l’« Ave Maria » a cappella. Cette célèbre prière avait été chantée par de nombreuses personnes avant elle mais il y avait quelque chose d'inexplicable dans son interprétation ce soir-là. C'était comme si elle nous disait au revoir. Lorsqu'elle a terminé, il y eut un silence de mort dans la salle. Ce n'est qu'ensuite qu'une salve d'applaudissements a retenti.
C'est avec cette prière qu'elle arrive en URSS et qu'elle en repart. C'est aussi avec cette prière qu’elle commence sa vie de chanteuse et qu’elle la quitte puisque l’on sait, de façon certaine, qu’elle a consacré les derniers mois de sa vie, clouée sur son lit de souffrance, à l’« Ave Maria » et à d’autres pièces religieuses, lisant la vieille Bible en écriture gothique de ses ancêtres, pieusement conservée par sa famille à grand péril à travers les âges, cachée sous le fumier lors des persécutions du NKVD en URSS et emmenée en Pologne en 1946 par sa grand-mère presque comme unique bagage, dissimulée dans on ne sait quels vieux vêtements ou chiffons.
Anna German commençait invariablement chacun de ses concerts par une prière ; son « Ave Maria » s'engouffrait dans l'auditorium bondé. Il était impossible de ne pas répondre à cet appel à la prière ou d’y rester indifférent.
1972. La salle du théâtre Estrada, sur la rive de la Moskova, est bondée. Les auditeurs attendent avec impatience l'apparition d'Anna. Tout le monde s'inquiète d'une chose : pourra-t-elle chanter comme avant après sa longue maladie ? La lumière s'éteint dans la salle. Un projecteur éclaire le visage d'Anna. Et dans le silence flottent les sons de l'« Ave Maria ». Le dernier son, long comme l'infini. Un silence respectueux règne dans la salle. Pas d'applaudissements. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on entendit un léger bruissement. » (Extraits des mémoires de l'archimandrite Viktor Mamontov).
Mais qu’est-ce au juste que l’« Ave Maria » ? C’est d’abord un texte, celui d’une prière catholique en latin et en deux parties qui remonte au xiiie siècle. La première partie est formée de deux petits extraits que l’on trouve dans l’Évangile de saint Luc du Nouveau Testament, le premier reprenant l’annonce de l’archange Gabriel (Annonciation, Luc 1.28) et le second les paroles qu'adresse Élisabeth à la Vierge Marie (Visitation, Luc, 1.42). Suit une seconde partie dans laquelle les croyants demandent à Marie d’intercéder pour nous. Cette prière d’intercession constitue également le cœur du Rosaire.
Bien qu’Anna German ait toujours chanté l’« Ave Maria » en latin et dans la version Bach / Gounod, nous ajoutons à la traduction française traditionnelle le texte de la version orthodoxe russe pour l’intérêt qu’elle peut présenter pour certains lecteurs. On remarquera qu’elle n’est pas suivie de la demande d’intercession.
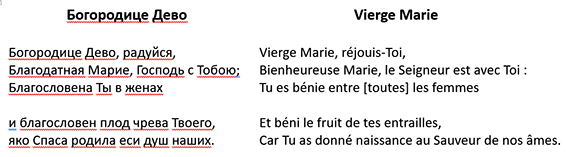
Musicalement, cet air n’est à l’origine qu’une improvisation mélodique de Gounod au piano sur le morceau purement harmonique en arpèges dont est formé le très célèbre prélude en do majeur du premier livre du Clavier bien tempéré (1722), de Johann Sebastian Bach. À l’époque, Gounod est fiancé à Anna Zimmermann, la cadette des quatre filles de l’excellent pianiste, compositeur trop peu connu et inspecteur général des études au Conservatoire impérial de Paris Pierre Joseph Guillaume Zimmermann (Paris, 19 mars 1785 – Paris, 29 octobre 1853) qui aurait pu acquérir une renommée plus durable s’il ne s’était pas perdu avec tant de dévouement dans l’enseignement. Zimmermann prend note de cette improvisation et en réalise tout d’abord une version pour violon accompagné par un petit chœur, puis le fameux arrangement pour violon (ou violoncelle) et piano (ou harmonium), destiné à être joué en concert sous le titre de Méditation et publié par Heugel. C'est encore Zimmermann qui l'adapte pour la voix. Cette dernière version est alors créée sur le texte de la version latine classique de la prière par Caroline Miolan-Carvalho1, le 24 mai 1859 seulement et c’est à elle que Gounod la dédiera. Pourquoi si tard ? C’est ici que l’histoire de la genèse de cette œuvre si célèbre devient extrêmement amusante et en totale contradiction avec l’intense spiritualité qu’elle dégage et dont beaucoup la croient inspirée. Dans l’explication qu’en donne le musicologue Alain Duault, qui reprend dans un article du Figaro du 5 août 2011 les aveux faits en 1993, au centenaire de la mort du compositeur, dans une conférence à Genève par le fils de Jean-Pierre Gounod, lui-même petit-fils de Charles Gounod, Zimmermann a tout d’abord
transposé l’improvisation de Gounod à la quinte, puis la lui joue au violon en lui demandant de l'accompagner au piano. Gounod, ravi, le remercie et a d’autant plus de raisons de le faire que Zimmermann vend la mélodie à un éditeur et donne à Gounod les 200 francs qu'il en a retiré ! Quelque temps plus tard, Gounod est séduit par la voix et par les courbes d'une de ses jeunes élèves, une certaine Rosalie Jousset. Pour pousser son avantage, il colle à la tendre mélodie des vers de Lamartine qui disent clairement à la jeune fille ce qu'il ressent. La jeune fille rougit, son sein se soulève à un rythme soutenu, sa respiration s'affole... Mais la mère de Rosalie s'émeut du tour pressant des leçons de Gounod et, découvrant le manuscrit de cette mélodie que le professeur a remis à sa fille, entreprend pieusement d'en remplacer les paroles [profanes] par celles, latines, de l'Ave Maria... Gounod s'en amuse et décide d'adopter cette version : c'est ainsi qu'une mélodie sentimentale de circonstance, née d'une simple improvisation, devint un tube, ce fameux Ave Maria de Gounod qui fera le tour du monde !
Il serait tentant de poursuivre l’histoire avec le même humour dont fait preuve Alain Duault et facile de verser d’autres pièces à ce dossier. On mettrait alors l’accent sur le fait que ce petit coquin de Gounod est fiancé à Anna Zimmermann « au moment des faits », comme on dit au tribunal, et qu’il dédie pourtant l’œuvre à Caroline Miolan-Carvalho bien qu’il épouse sa fiancée le 20 avril 1852 en jetant sans façons aux oubliettes une Pauline Viardot très amoureuse qui avait grandement contribué à le « lancer » au cours des trois années précédentes. Mais il s’agissait d’un mariage sans passion, de convenances, contracté surtout pour obliger les Zimmermann, Monsieur, tout d’abord, qui lui est bien utile en soutenant sa carrière et surtout Madame, qui ne cessait de se lamenter sur son triste sort en disant : « Quatre filles à marier, rendez-vous compte, quatre ! comment vais-je y parvenir ? Ah-ha, Anna ? Mais bien sûr, mon cher, prenez-la, je vous la donne ! » Gounod, dont nous avons (croyons-nous du moins) été le premier à révéler la bipolarité2, en fera bien d’autres en France et en Angleterre avec ses multiples amours extra-conjugales, lui qui, selon ses amis de jeunesse « un jour embrassait le mari et le lendemain courtisait la femme », mais aux gens vertueux qui voudraient profiter de ce trait de caractère pour rabaisser son génie, nous rappelons, à titre de plaisanterie, que les faits qui leur paraissent répréhensibles sont prescrits depuis longtemps et que, ceci constituant une modulation trop lointaine, il est temps de suivre les conseils de César Franck et de revenir à la tonique, c’est-à-dire au sérieux de la musicologie.
 Charles Gounod.
Charles Gounod.
Nous rappelons donc que Gounod, hésitant sans cesse entre conversion et reconversion, n’a longtemps pas su où était sa vraie place, dans le monde religieux ou le monde profane. Il entre chez les Carmélites en octobre 1847, demande et obtient l’autorisation de porter l’habit ecclésiastique avant de se décider, comme il le dit, à « rentrer dans le monde » en février 1848. Sa mère, Victoire Lemachois, qui ne savait pas non plus à quoi s’en tenir, lui écrivait : « Je ne sais de quel côté tu désireras loger lorsque tu reviendras [de Rome]. Sera-ce près des Missions où près de l'Opéra ? » Une fois cette décision prise, alors qu’il semble avoir fait un choix définitif, un simple coup d’œil à sa production suffit pourtant pour constater que celle-ci continue à se diviser en parties presque égales entre musique religieuse et profane. On se demande alors si Gounod est un laïque qui écrit de la musique religieuse (plus d’une douzaine de messes, des requiem, cantate, motet, Paroles du Christ, etc.), ou un religieux qui écrit des opéras et des mélodies profanes ? On se demande surtout s’il est juste de poser le problème ainsi car qui oserait soutenir que sa musique religieuse est écrite « techniquement » d’une manière différente de sa musique profane ? Bach écrivait-il sa musique religieuse différemment de sa musique profane ou utilisait-il les mêmes règles pour les deux ? Pour revenir à l’exemple qui nous intéresse, nous savons que l’« Ave Maria » de Gounod n’a jamais été destiné à être joué dans une église. Mais ce n’est pas non plus de la musique profane puisqu’il s’agit d’un texte liturgique. C’est pourquoi dans un premier temps, mais dans un premier temps seulement, nous pourrions adhérer à la formule, réductrice comme toutes les formules, de l’arrière-petit-fils de Gounod qui affirme dans sa conférence que « l’"Ave Maria" illustre bien le fait que Gounod savait exprimer d'une même plume l'amour profane et l'amour sacré. » Mais on sent bien que ceci n’est qu’une jolie phrase qui ne veut rien dire, que le fond du problème est ailleurs et ne caractérise pas plus Gounod que Bach ou n’importe quel autre compositeur travaillant sur les deux fronts. Où est-il alors, ce problème ? Eh bien, même si personne ne semble l’avoir remarqué, c’est la brave Madame Jousset, qui veillait si bien sur la vertu de sa fille, qui nous le révèle. Voilà qui est bien amusant de nouveau, n’est-ce-pas ? Sans s’en douter le moins du monde, elle réactive en effet pour l’occasion une pratique musicale qui a été un des fondements principaux ayant permis à notre histoire musicale de se développer jusqu’à ce qu’au xixe, précisément, on puisse enfin prétendre avec des raisons suffisantes que les compositeurs se trouvent devant un papier blanc au moment d’écrire une œuvre : elle redécouvre le contrafactum, c’est-à-dire le remplacement du texte original d'une œuvre vocale par un nouveau texte, sans modifier la musique, par exemple l’adaptation d’un texte profane à une mélodie sacrée, ou l’inverse.
Elle n’opère toutefois pas exactement selon le même type de recyclage que le vrai contrafactum du Moyen Age, (qu’on l’appelle plutôt « travestissement » au xvie siècle, ou encore « parodie » aux xviie et xviiie siècles même si ce dernier terme devient alors une source supplémentaire de confusion) mais selon une proche variante puisqu’elle remplace un texte profane français que sa religion juge immoral par les paroles latines originales sacrées d’une prière religieuse catholique adaptées à une musique profane (néanmoins composée par un luthérien convaincu). Vous vous y perdez ? Félicitations alors car vous avez trouvé la solution, qui est tout bonnement que ces catégories religieuse et profane n’ont aucun sens. La brave madame Jousset n’a toutefois pas poussé la réflexion jusqu’à en tirer cette conclusion. On ne lui en voudra pas, elle avait d’autre préoccupations, plus immédiates et plus terre-à-terre.
Mais pour nous, musicologues du xxie siècle, ceci nous incite à nous poser enfin sérieusement la question de savoir ce qui peut bien différencier la musique religieuse et la musique profane et ce problème nous fait irrésistiblement penser à ce que nous-même répétions souvent en son temps à nos étudiants de contrepoint pour les encourager et combattre la mauvaise réputation de cette matière : « la seule vraie difficulté du contrepoint, c’est l’harmonie ». Il serait temps aujourd’hui de nous avouer sur le même modèle que « la seule vraie caractéristique de la musique religieuse, c’est son texte ». Plus, bien sûr le genre, la fonction, le cadre, etc., qui sont certes toutes des choses très importantes mais extrinsèques à l’écriture musicale. Il faudrait alors recourir aux lapalissades et dire que « la musique religieuse est celle que l’on joue à l’église », ce que font d’ailleurs certains dictionnaires faute de trouver mieux. Comme certaines vérités sont difficiles à accepter, surtout pour les esprits religieux, on a fait au cours de l’histoire de nombreuses tentatives pour faire croire à l’existence de ces deux blocs en leur inventant des traits spécifiques mais qui se montent finalement à très peu de chose puisqu’on n’a jamais pu agir que sur des paramètres secondaires et jamais sur les principaux. Il n’existe pas d’harmonie religieuse. Seule objection apparente, l’existence du répertoire mélodique grégorien modal et son utilisation possible, ainsi que celle des modes dits « d’église », mais qui nous empêche aujourd’hui d’utiliser tout cela dans de la musique profane ? Et qui croit encore qu’il n’existe pas de modes dans la musique populaire ? et que ce sont les religieux qui en sont les inventeurs parce qu’ils sont les seuls à avoir pu les noter ? Les notes n’en sont pas devenues religieuses pour autant et n’appartiennent pas à ceux qui s’en servent. Que n’a-t-on pas prétendu cependant ? Que d’âneries n’a-t-on pas proférées au cours des siècles ! Qu’il suffirait pour fabriquer de la musique religieuse d’utiliser un peu plus de contrepoint ? d’ajouter par-ci par-là des degrés modaux ? un vie degré plus fréquent ? même le iiie parfois ? d’ajouter une cadence plagale à la cadence v-i en fin de morceau ? de renoncer aux dissonances ? d’instrumenter différemment ? Allons, allons, soyons sérieux ! Et précisément, on pourrait encore ajouter à cette petite liste la gravitas, le caractère méditatif, la simplicité, le dépouillement, la bannissement des instruments, la suppression réclamée par le Concile de Trente « des tropes, de la multitude des notes, des ornements » (mais pourquoi sinon parce que cela menaçait l’intelligibilité du texte sacré3), l’effort (allant dans le même sens) consenti pour le ralentissement du tempo, la douceur, la clarté (la voix claire, aiguë mais suave, « liquide », caressante, non aspera, non rauca,sine angor, sine clamore, sancte religioni congruentem4 également demandée par le concile), soit, à cette époque qu’on appelle parfois le « Paradis perdu de la musique », une forme, c’est-à-dire un ensemble de paramètres essentiels concourant tous au même but : exprimer l’éternité, l’inexistence du temps et de l’évolution, l’intemporalité de la conception du monde pré-copernicienne. Oui, cela, on a pu longtemps faire croire que c’était une objection majeure mais la religion n’a pas cessé d’évoluer pour s’adapter aux temps et d’autre part, même s’il reste toujours passionnant de disséquer à toute époque chacun de ces éléments, d’analyser à la manière de Descartes sa fonction propre et dans l’ensemble en pesant leur valeur individuelle et globale aussi exactement que possible, il n’y a rien dans tout cela qui puisse nous faire croire à une réelle spécificité religieuse ou profane5, et on entre dans le xxie siècle en se demandant, comme le fait l’écrivain suisse Étienne Barilier dans une conférence intitulée « Qu’est-ce qu’une musique religieuse ? » si « n’importe quelle musique, fût-ce le sirop qui nous est versé dans les oreilles chaque fois qu’on visite un magasin "grande surface", ne deviendrait pas une musique religieuse si l’on plaquait sur elle les paroles du Requiem ou du Miserere ». Car se servir du texte pour changer radicalement le caractère de la musique… oui, cela a été fait mille et mille fois dans l’histoire de la musique, dès ses origines, et c’est peut-être même tout simplement ce recours systématique au texte et à des genres pré-étiquetés « spécifiquement religieux » qui suffit déjà à prouver qu’il n’existe pas de musique intrinsèquement religieuse. Prenons quelques exemples.
Celui qui a entendu une des pièces les plus profanes qui soient, La Bataille [de Marignan] de Clément Janequin et constaté que le compositeur n’en change pas une note dans une pièce qui sonne pourtant comme une des plus religieuses de toutes, sa messe La Bataille, ou qui lit avant de les écouter des chansons grivoises de la Renaissance dans lesquelles il suffit de troquer les noms des protagonistes de l’action, ou même de l’acte en cours, contre ceux de Jésus et de Marie pour en faire d’émouvantes et vertueuses prières à la Vierge, celui-là peut-il encore croire à ces catégories ? Et des pièces de ce type, cela pullule à cette époque. Veut-on alors des exemples plus tardifs ? Demandez qui vous voulez. Purcell ? Bach ? Händel, qui pille Legrenzi, Carissimi, Porta, Telemann, Keiser, Erba, Habermann, Krieger, Kerll, Steffani… qui écrit des drames sur des textes sacrés et dont, inversement, les oratorios et les anthems regorgent à ce point de ses propres fragments d’opéras qu’on pourrait dire qu’une bonne moitié de ce qu’on y entendait avait déjà été entendu au King’s Theatre (His Majesty’s Theatre) ou plus tard à Covent Garden (Royal Opera House) ? Mozart, alors ? un exemple intéressant parce qu’il se produit dans le sens contraire, un fragment de messe mariale devenant, (ô Seigneur ! protège-nous du démon !) un fragment d’opéra bouffe : le début de l’Agnus Dei de sa fameuse Messe du couronnement de la Vierge. kv 317, qui date de 1779 et l’air no 19 « Dove sono i bei momenti » des Noces de Figaro, représenté pour la première fois le 1er mai 1786. Comme nous le verrons tout à l’heure, à propos d’un autre « Ave Maria », cela n’a jamais manqué de scandaliser certains esprits étroitement religieux.
Mais entre gens plus intelligents, amusons-nous-en plutôt, comme Rossini qui, après avoir composé sa Petite messe solennelle, pensait qu’il avait écrit là « une sacrée musique » bien plus qu’« une musique sacrée » !
Peut-être serait-il plus sage de se demander si nous ne projetons pas tout simplement dans les choses nos structures de pensée. Pour que la pensée puisse se former il faut en effet qu’elle passe par des moules de manière à pouvoir appréhender, identifier, organiser, comparer, différencier, classer et finalement catégoriser les stimuli reçus par le cerveau. Le problème est que, si ces moules sont indispensables à la formation de la pensée, ils tendent toujours, si ce n’est pas le cas dès le début du processus, à la rigidification et finissent par faire obstacle à son développement. Il faut alors que la pensée les brise et se reforme dans d’autres moules plus grands, plus souples et ceci sans fin, pour grandir, évoluer, jusqu’à ce qu’enfin l’intelligence puisse se développer par l’abolition de tout ce qui fait obstacle à la libre circulation des idé…
César Franck nous interromprait certainement ici : « Comment, d’abord ce ton moqueur puis, tout de suite après et sans repasser par la tonique, un ton doctoral et philosophique et une cadence si marquée qu’elle devrait être conclusive alors qu’elle n’est même pas dans le bon ton ? C’est encore une de vos plaisanteries ? Et qu’était-ce donc encore auparavant que cette tirade interminable dans le même ton sur la messe, l’oratorio, l’opéra et je ne sais quoi dans une improvisation sur le double thème de l’« Ave Maria » et d’Anna German, ce qui est déjà une erreur ? Un thème C ? Vous dissertez sur la forme mais n’en avez aucune idée, mon cher ! Seigneur, quel embrouillamini ! Ou bien vous changez sans cesse de ton, ou bien vous restez trop longtemps dans un ton trop lointain et on s’ennuie à mourir. Et puis, apprenez donc que puisque rien de ce que nous pensons, disons, faisons, créons ne peut se passer de forme, ni la pensée ni la musique, ni quoi que ce soit d’autre, il est préférable de la soigner sous peine de la faire paraître informe. Allons, modulez, modulez ! Retour au ton principal, c’est-à-dire à l’"Ave Maria », puis à Anna German, si vous y tenez vraiment ! »
— « Bien, Maître ! » … Même si le texte en est parfois modifié et ressort aussi bien au genre religieux que profane, d’innombrables compositeurs ont produit des « Ave Maria » au cours de l’histoire de la musique classique, des temps les plus anciens à l’époque contemporaine mais il faut alors accoler à ce titre le nom du compositeur pour savoir que ce ne n’est pas de l’air de Gounod que l’on parle. Parmi les plus connus de ces grands musiciens (rangés ici par ordre de leur naissance, pour qu’il y ait une forme), on compte Ockeghem, des Prés, de la Rue, Willaert, Gombert, Arcadelt, Palestrina, Lassus, Parsons, Byrd, Victoria, Caccini6, Gesualdo, Monteverdi, Händel, Fiocco, Pergolèse, Bortnianski, Mozart, Rossini, Schubert, Donizetti, Mendelssohn, Liszt, Verdi, Offenbach, Bruckner, Brahms, Cui, Saint-Saëns, Dvořák, Fauré, Chausson, Leoncavallo, Elgar, Puccini, Mascagni, Rachmaninov, Stravinski, Mompou, Poulenc, Jehan Alain, Piazzolla, Vav...
— « Vous m’avez oublié, là, entre Offenbach et Bruckner. Seigneur, quel voisinage ! Mais bon, cela suffit avec cette manie des listes, c’est ennuyeux, cela ! Modulez, modulez encore ! mais cette fois, ne vous éloignez pas autant, veillez à rester dans les tons voisins ! »
— « Oui, Maître, mais je ne vous oubliais pas, Maître, j’allais justement vous citer » ... Certains de ces compositeurs ont d’ailleurs écrit plusieurs « Ave Maria » – comme les trois vôtres, cher Maître, tous de pures merveilles d’inspiration profondément religieuse, c’est-à-dire, euh, accompagnés à l’orgue et chantés à l’église bien sûr – et ce ne sont pas toujours des pièces indépendantes mais parfois contenues dans un corpus plus large et de tout genre, comme l’« Ave Maria » de Schubert dans un cycle de Lieder (voir ci-après), celui de Verdi à l’acte IV scène II de son opéra Otello, ou celui de Poulenc dans son drame lyrique en trois actes, Le Dialogue des Carmélites, ou encore… ceci pour ne citer cette fois que quelques-uns d’entre eux. Jusqu’à la fin de la Renaissance, il s’agit bien entendu presque uniquement de pièces vocales pour chœur dans le stile antico. C’est surtout à partir du stile moderno, soit, pour choisir une date mnémotechnique bien ronde, à partir de 1600 environ, qu’apparaissent les œuvres comprenant des instruments qui soient voulues comme telles par le compositeur et non des transcriptions. Pour nous en tenir à l’« Ave Maria » de Gounod, il en existe d’innombrables arrangements vocaux et instrumentaux pour à peu près n’importe quel instrument solo, formation chorale, de chambre ou orchestrale. Les chanteurs d'opéra les plus célèbres l’ont mis à leur répertoire et des chœurs en ont fait des centaines d’enregistrements au cours du XXe siècle. Anna German n’échappe pas à cette vogue des arrangements et l’on peut entendre sa voix magnifique empreinte de la plus haute spiritualité sur les orchestrations de style show biz les plus détestables. À la même époque, la musique de variétés et le jazz s’emparent du texte de cette œuvre (tout en s’inspirant parfois de la musique de Bach, comme quelques compositeurs du xixe l’avaient fait) pour en donner leur version personnelle au niveau médiocre qui était le leur, par exemple Aznavour qui en fait un album en 1979, écrivant son propre texte sur une musique de Georges Garvarentz ou, plus proche de nous, Beyoncé (2008). Ceci nous rappelle cependant que Schubert excepté, peu d’œuvres musicales créées à quelle qu’époque que ce soit sur ce texte sacré ou sur un texte profane ont atteint la perfection de l’improvisation de Gounod.
Du reste, ce grand compositeur n’y parvint même pas lui-même. En effet, plus tard dans sa carrière, le succès imprévu de son arrangement incita Gounod à tenter de le reproduire en composant d’autres « Ave Maria » mais qui n'atteignirent jamais la même célébrité que le premier. Le CG 97 datant de 1883 est conçu selon le même principe et se base sur un autre prélude de Bach (BWV 999 pour luth).
 Franz Schubert.
Franz Schubert.
Anna German a aussi chanté l’« Ave Maria » de Schubert mais elle ne l’a malheureusement jamais enregistré. Nous nous rabattons donc sur la belle interprétation suivante qui n’a cependant ni la pureté ni la profondeur que l’on trouve toujours dans la musique religieuse d’Anna.
Franz Schubert, Ave Maria, D. 839, par Barbara Bonney.Bien que ce soit un grave péché musicologique de mettre en relation les « Ave Maria » si différents de Gounod et de Schubert sans prendre la peine de lister leurs ressemblances et leurs différences – ce qui serait très ennuyeux – reconnaissons-leur au moins, en passant seulement, ce point commun qu’aucun des deux n’a été conçu à l’origine comme une œuvre de musique religieuse. Ce que l’on a pris l’habitude d’appeler, en raison de l’incipit du texte, l’« Ave Maria » de Schubert D. 839, est en effet un lied strophique pour chant et piano portant le titre de « Ellens dritter Gesang, Hymne an die Jungfrau », op. 52 n° 6, composé au printemps 1825, publié en avril de l’année suivante chez Artaria à Vienne et créé le 31 janvier 1828 au Musikverein de la même ville, soit après la mort du compositeur. Il s’agit en première intention d’une adaptation tirée d’une œuvre profane, La Dame du lac de Walter Scott, une épopée en vers écrite en 1810 sur un texte de trois strophes commençant et se terminant par les mots Ave Maria , et traduite presque aussitôt en allemand par Adam Storck sous le titre de Fräulein vom See. Le succès de l’œuvre entraîna, très rapidement aussi, un changement de destination ; on lui adapta le texte latin de la prière catholique romaine, la rendant ainsi indépendante des six autres pièces du même opus choisies par Schubert sur les quinze que comprend le texte original de Scott.
Anna German a aussi chanté d’autres « Ave Maria », en particulier celui dont nous donnons le texte ci-dessous du compositeur de musique populaire brésilienne et spécialiste de la samba, Herivelto de Oliveira Martins (1912-1992), également chanteur, parolier et, à l’occasion, acteur. Son « Ave Maria », composé en 1942-1943, commence et finit lui aussi par une citation du prélude de Bach. Le cardinal de Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, qui considérait cette chanson comme une hérésie, a tenté de la faire interdire ou au moins modifier par la censure et son intervention a probablement poussé les arrangeurs de tous poils à en proposer d’autres versions gardant une référence à la musique de Bach et Gounod qui leur apparaissait vraisemblablement comme une garantie de religiosité, ce qui, compte tenu de la genèse de cet air, est de nouveau assez amusant. Du reste, il faut convenir que le résultat n’était pas très enthousiasmant dans sa version originale, surtout lorsque Martins chantait lui-même son œuvre (qu’il a d’ailleurs retouchée par la suite), et bien qu’on lui doive un certain respect pour ce témoignage bienvenu de la vie des pauvres dans les favelas de Rio de Janeiro, on peut regretter qu’il se soit ainsi ouvert à une comparaison peu flatteuse pour lui avec Bach et Gounod en les citant, de même qu’avec Schubert ou la plupart des œuvres des autres grands compositeurs cités sopra. Mais nous sommes là, comme avec Aznavour ou Beyoncé, dans un autre monde que la musique classique à laquelle on essaie néanmoins de la rattacher et la pièce de Martins, à la fois religieuse et profane, se doit de figurer dans cet article parce qu’Anna German l’a chantée, remaniée bien sûr, à plusieurs reprises, notamment au Festival panpolonais d’Olsztyn où son interprétation lui a permis de remporter le premier prix. L’exemple musical que nous proposons ci-dessous fait partie de ces dizaines d’arrangements parfois supérieurs à l’original mais de qualité très variable, et qui sont très différents les uns des autres, avec modification non seulement de la musique mais avec amputation ou permutation des strophes du texte ou parfois même irruption au beau milieu d’une citation intégrale d’une partie de la pièce de Bach et Gounod.
Ave Maria no morro
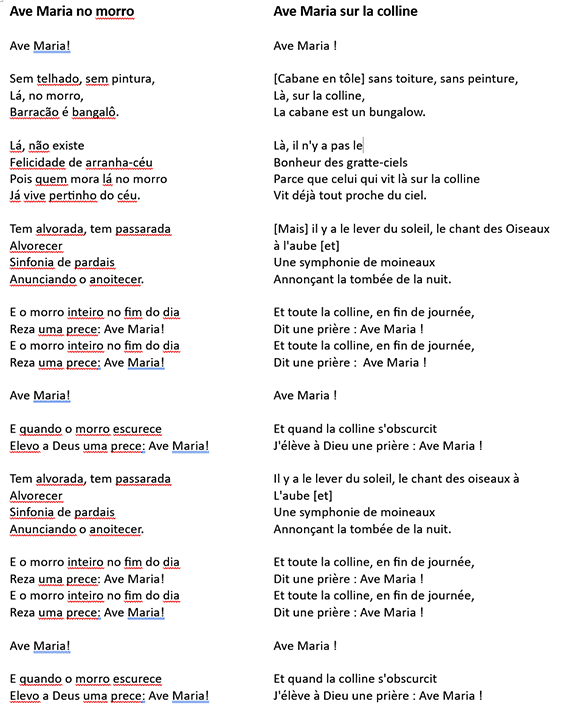
— « Comment ? C’est fini ? Vous vous arrêtez là ? Et votre péroraison, votre cadence finale ? Bon, enfin… mais ce n’est pas parce qu’il ne s’agit que d’une improvisation – ou de variations, et sur un thème ou plusieurs, je n’ai même pas compris cela – que cela vous dispense d’une forme correcte. Pensez-y la prochaine fois si vous voulez qu’on vous publie ! »
![]() François Buhler
François Buhler
25 avril 2025
Notes
1. Marie-Caroline Miolan-Carvalho (Marseille, 31 décembre 1827 - Puys, 10 juillet 1895) est une célèbre soprano colorature française, élève de Duprez dès 1843, d’abord engagée à l’Opéra-Comique en 1850 mais qui débute sa grande carrière en épousant en 1853 le baryton Léon Carvalho qui prend la direction du Théâtre-Lyrique en 1856 et lui offre les premiers rôles qui lui sont refusés à l'Opéra-Comique. Elle crée ainsi toutes les principales héroïnes des opéras de Charles Gounod tout en se faisant avantageusement connaître dans le répertoire mozartien.
2. François Buhler, Cinq Grands Compositeurs bipolaires, Publibook, Paris, 2020, ISBN 978-2-342-16888-4.
3. Même au Concile de Tolède, en 633, on exigeait déjà que le chant « n’obscurcisse pas le texte chanté ».
4. Ce seront là exactement les caractéristiques de la voix d’Anna German !zs/p>
5. Et puis quoi, se croit-on encore le centre du monde comme avant Copernic et Galilée ? Dans d’autres endroits de la Terre, chez les Noirs en général, où qu’ils résident, la religiosité s’exprime de façon exactement contraire, par le bruit, les clameurs, la gesticulation, la danse, etc.
6. On peut toutefois considérer aujourd’hui comme certain que l’attribution de ce morceau à Caccini n’est qu’une mystification, dont on ignore la raison mais qui pourrait être d’échapper ainsi à l’interdiction générale de composer de la musique religieuse catholique en URSS. Cette interdiction était certes plus souple sous Brejnev qu’à l’époque de Staline où il était même interdit de prononcer le mot « Dieu » sous peine de mort ou, ce qui revenait à peu près au même mais avec de plus longues souffrances, de déportation dans un camp. La pièce a été composée en 1970 par le musicien soviétique Vladimir Vavilov « imitant un compositeur ancien anonyme du XVIe siècle », comme il l’indique lui-même dans l’enregistrement qu’il en fait cette année-là chez Melodia, l’unique studio d’enregistrement et donc aussi l’unique label de toute l’Union soviétique à cette époque. Ce n’est cependant qu’après sa mort en 1973 que son « Ave Maria » est attribué à Giulio Caccini (1551-1618), dont ce n’est ni le style, ni surtout l’époque, une attribution qui a vraisemblablement contribué à son formidable succès. On dispose de plus d’une autre preuve, déjà amplement suffisante en elle-même, pour affirmer que jamais Caccini n’a eu quoi que ce soit à voir dans l’affaire : jamais, en effet, un compositeur écrivant dans les dernières années du XVIe ou les premières années du XVIIe siècle n’aurait utilisé que les deux premiers mots, Ave Maria ; il aurait composé l’intégralité du texte.
7. Nous ajoutons pour les lecteurs appréciant la précision analytique que les mots Ave Maria sont accompagnés à chaque fois de la même formule rythmo-mélodique, ce qui confère de plus à l’œuvre un caractère cyclique se superposant à la forme strictement strophique.




 À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.
ISSN 2269-9910.

Vendredi 25 Avril, 2025 2:50

