L'œuvre concertante de Frédéric Chopin
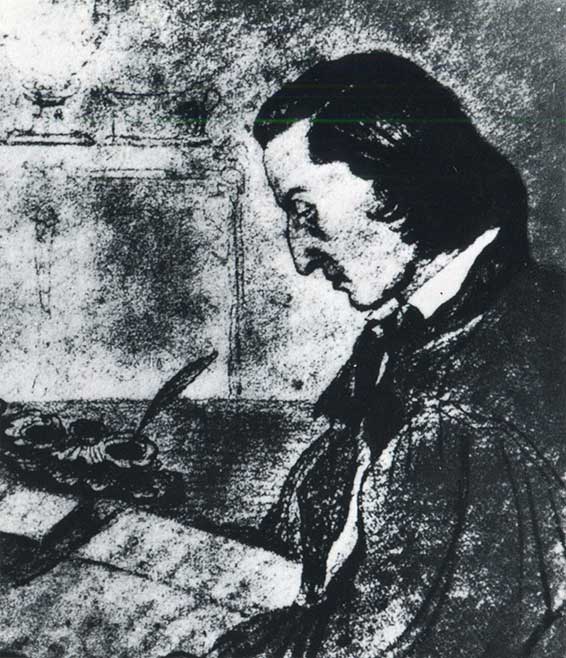
Dans le domaine symphonique également, Chopin n’a laissé qu’une poignée d’œuvres, toutes de nature concertante et dévolues à son instrument de prédilection. Et ses ambitions en la matière se sont vite arrêtées puisque ces quelques œuvres furent toutes écrites entre 1827 et 1830. Après son départ de Varsovie, le compositeur n’y reviendra plus, préférant confier presque exclusivement ses inspirations au seul piano, son ami et complice de tous les instants.
Variations sur Là ci darem la mano, opus 2
Coup de maître d’un musicien de dix-sept ans, ces variations sur le fameux air du Don Giovanni de Mozart furent, on le sait, à l’origine du « Chapeau bas, Messieurs… » de Schumann, lorsque celui-ci en fit la découverte quatre ans plus tard. Dans cette première tentative d’œuvre concertante pour piano et orchestre, le jeune Chopin domine remarquablement son sujet et, avec une imagination parfois étonnante, signe une partition peu ordinaire en référence à un compositeur qu’il chérissait entre tous. Particulièrement remarquables, à cet égard, sont les cinquième et sixième variations, qui portent indiscutablement la marque du génie.
Frédéric Chopin, Variations sur Là ci darem la mano, opus 2, par Kun-Woo Paik et le Warsaw Philharmonic Orchestra, sous la direction d'Antoni Wit.Concerto no 1 en mi mineur, opus 11
Écrit pendant l’été de 1830 et créé en octobre de la même année au cours du dernier concert de Chopin avant son départ définitif de Varsovie, ce concerto no 1 est en fait, chronologiquement, le second.
Construit en trois mouvements, il comporte en son milieu une magnifique romance, marquée larghetto, dans laquelle Chopin exprime secrètement ses sentiments amoureux envers la jeune cantatrice Constance Gladkowska. Le musicien garda lui-même un attachement particulier pour ce mouvement dont l’esprit est proche de celui des nocturnes. « Il est maintenu, disait-il, dans un sentiment romantique tranquille, en partie mélancolique. Il doit faire la même impression que si le regard se reposait sur un paysage devenu cher, qui éveille en notre âme de beaux souvenirs, par exemple sur une belle nuit de printemps éclairée par la lune… ». Grand et beau moment de musique, en effet, qui n’a pas fini d’exercer son ascendant sur les auditeurs. On ne sous-estimera pas pour autant les mérites propres des deux mouvements qui l’encadrent : un allegro maestoso qui porte bien son nom avec son premier thème à l’allure un peu martiale, mais réserve de fort belles échappées mélodiques et lyriques ; et un brillant rondo final, enlevé, capricieux et joyeux, dans lequel passent les accents d’une « cracovienne ».
Frédéric Chopin, Concerto no 1 en mi mineur, opus 11, 1. Allegro Maestoso, 2. Romanze, 3. Rondo, par Yulianna Avdeeva et le Warsaw Philharmonic Orchestra, sous la direction d'Antoni Wit, enregistrement public, concours Chopin, 2010.Concerto no 2 en fa mineur opus 21
Relégué au rang de no 2 par sa publication tardive, ce concerto en fa mineur fut en fait composé en 1828-1829 et Chopin le joua pour la première fois en mars 1830 à Varsovie. S’y succèdent, ici aussi, trois mouvements (maestoso, larghetto, puis allegro vivace), mais on y trouve plus d’accents dramatiques et vigoureux que dans le concerto en mi mineur, de sorte que règne dans cette œuvre une belle dualité entre énergie et sentiment romantique. Dualité frappante dans le vaste premier mouvement qui, avec des interventions de l’orchestre plus marquées que dans l’opus 11, mêle accents violents et touches sentimentales, mais tout autant ou presque par la suite, jusqu’au vigoureux finale qui adopte le rythme caractéristique de la mazurka. Entre-temps, avec le superbe larghetto, un mouvement que Chopin dédia secrètement, comme la romance du concerto no 1, à la belle Constance Gladkowska et qui allait faire les délices de Schumann et de Liszt, on sera passé par une succession de climats tour à tour tendres, passionnés et véhéments, comme si, derrière cette longue cantilène à l’italienne, porteuse d’une merveilleuse confidence amoureuse, Chopin entendait nous faire vivre un rêve d’amour brutalement interrompu par l’explosion de passion et de douleur de la partie médiane. Si rêve il y a, on le doit pour partie, avouons-le, aux admirables ornements, gruppetti et autres traits pianistiques subtils que le musicien avait, déjà à l’époque, intégrés à son langage poétique.
Frédéric Chopin, Concerto no 2, en fa mineur, opus 21, par Maria João Pires et le Royal Philharmonic Orchestra, sous la direction d'André Previn.Autres œuvres concertantes
À côté de la « grande » polonaise brillante opus 22 évoquée plus haut (avec son andante spianato) avec les polonaises pour piano seul, il faut ici faire mention de deux œuvres composées dès 1828 : une certaine Grande fantaisie sur des airs nationaux polonais, opus 13 et, plus réussie, la krakowiak (grand rondo de concert) opus 14. « C’est une pièce de grand brio dans laquelle Chopin, tout imprégné de slavisme, laisse couler de sources la mélodie (teintée de nostalgie dans l’ouverture du morceau) et sa vivacité rythmique (fondée principalement sur les temps d’une Polonaise). »87
Frédéric Chopin, Krakowiak, rondo de concert, en fa majeur, opus 14, par Claudio Arrau et le London Philharmonic Orchestra, sous la direction d'Eliahu Inbal.Notes
87. Tranchefort François-René, Guide de la musique symphonique, Fayard, Paris 2002, p. 173-174.
![]() Michel Rusquet
Michel Rusquet
8 novembre 2020
© musicologie.org




 À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISSN 2269-9910.
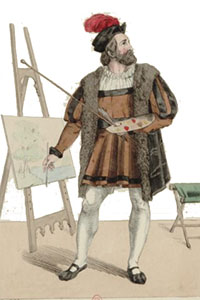
Jeudi 26 Décembre, 2024 14:54

