Der Rosenkavalier / Le Chevalier à la rose (I, II, III)
Opéra en trois actes sur un livret de Hugo von Hofmannsthal
I. Distribution ; II. Notice ; III. Argument ; IV. 1, face 1 et livret (acte I.) ; IV. 2, face 2 et livret (suite acte I.) ; IV. 3, face 3 et livret (fin acte I.) ; IV. 4, face 4 et livret (acte II) ; IV. 5, face 5 et livret (suite acte II.) ; IV. 6, face 6 et livret (fin acte II, acte III) ; IV. 7, face 7 et livret (acte III.) ; IV. 8, face 8 et livret (fin acte III.)
I. Distribution
La maréchale, Princesse de Werdenberg, Elisabeth Schwarzkopf (soprano).
Le comte Octave Rofrano, son jeune cousin et amant, Christa Ludwig (mezzo-soprano).
Le baron Ochs de Lerchenau, cousin de la Maréchale, Otto Edelmann (basse).
Monsieur de Faninal, un riche parvenu, Eberhard Waechter (baryton)
Sophie, sa fille, Teresa Stich-Randatl (soprano).
Marianne Leitmetzerin, duègne de Sophie, Ljuba Welitsch (soprano).
Valzacchi, un intrigant italien, Paul Kuen (ténor).
Annina, sa complice, Kerstin Meyer (contralto).
Le commissaire de police, Franz Bierbach.
Le majordome de la maréchale, Erich Majkut.
Le majordome de Faninal, Gerhard Unger.
Le notaire, Harald Proglhof.
L'aubergiste, Karl Friedrich.
Le ténor italien, Nicolai Gedda
La modiste, Anny Felbermayer.
Le marchand d'animaux, Gerhard Unger.
Trois nobles orphelines, Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Kerstin Meyer.
Quatre laquais, Gerhard Unger, Erich Majkut, Eberhard Waechter, Harald Proglhof.
Quatre garçons, Gerhard Unger, Erich Majkut, Eberhard Waechter, Franz Bierbach.
Philharmonia Orchestra and Chorus (Chef des Chœurs : Wilhelm Pitz,
Répétiteur : Heinrich Schmidt).
Chœurs d'enfants de la Loughton High School for Girls et Bancroft’s School.
Sous la direction de Herbert Von Karajan.
Pathé Marconi / EMI 1957. 2 C 165-00459/62 / PM 648 (4 LP).
II. Notice, par William Mann
Avec Le Chevalier à la Rose, le grand opéra touche à sa fin. Après 1911, année de sa création à Dresde, le vieux monde, qui avait entretenu l’opéra romantique, disparaît dans la boucherie de la guerre de 1914. Pour les survivants, Turandot de Puccini fut la seule œuvre ayant suffisamment de force pour mériter une place dans le répertoire international de l’opéra. Turandot n’est pas une œuvre de 1924, mais un retour à la belle époque d’avant-guerre, aux beaux jours de Caruso, Scotti et Sembrich. Peut-être parce que le public eut l’intuition qu’il s’agissait d’une pièce de musée, Turandot n’a pas obtenu une place très élevée dans le répertoire. Ainsi, pour beaucoup de théâtres et pour leurs publics, ce fut avec Le Chevalier à la Rose que tomba le rideau sur le XIXe siècle.
Pour nous, cet opéra évoque la Belle Époque, en même temps que la Vienne de Marie-Thérèse du milieu du xviiie siècle. Les caractères de la « comédie musicale » d’Hofmannsthal, gaie, légèrement pathétique, et toujours émouvante, ont en eux-mêmes quelque chose de cette extravagance typique des civilisations qui s’acheminent vers leur fin. La gloire de l’Autriche sous les Habsbourg allait durer encore un peu — la décadence n’a pas encore commencé — mais la Maréchale amoureuse, le paysan roué, l’aristocrate parvenu et les intrigants italiens, reflètent l’approche de la fin de la Belle Époque, ainsi que la fin des Habsbourg. Richard Strauss a appuyé sur le symbole en introduisant dans la partition l’anachronique valse viennoise, rythme envoûtant qui fait l’unité de l’œuvre.
Le Chevalier à la Rose marque un tournant dans la carrière de Strauss. Auparavant, dans Salomé et Elektra, il s’était essayé à la psychologie morbide et tortueuse et avait développé progressivement un langage néo-wagnérien. Il accueillit le livret d’Hofmannsthal avec le flot de musique gaie et hédonistique qu’il demandait et il continua plus tard dans ce style et cette veine avec des sujets plus raffinés et subtils. Quelques années après, l’époque du « Spâtro- mantik » prit fin et Strauss se trouva un vieux maître, pas assez moderne ; ses derniers opéras étaient toujours comparés, sans pitié, au Rosenkavalier.
Les comparaisons peuvent nous aider à comprendre l’esprit de Strauss, mais ne nous permettent pas d’affirmer catégoriquement la suprématie d’une œuvre sur les autres. Son génie, peut-on dire, est plus mûr et plus subtil dans Capriccio ; plus lyrique et plus perceptif dans Arabella ; plus grandiose dans Die Frau ohne Schatten, mais il est plus vigoureux et plus captivant dans Le Chevalier, car pour la première fois il ressent le choc de ce dernier style.
Strauss était mûr pour le changement. Après avoir commencé à collaborer avec Hugo von Hofmannsthal à Elektra, il pria le poète de surseoir à leur travail, afin de se consacrer à d’autres sujets dont le climat serait moins horrible que celui de Salomé. Le refus de Hofmannsthal lui permit un fort utile retour en arrière ; Elektra n’aurait pas été cette puissante construction si Strauss avait écrit, dans l’intervalle, Der Rosenkavalier. Et le résultat fut très positif aussi pour Le Chevalier à la Rosepar l’apport (TElektra en tant qu’ex- périence et mûrissement. Mais Strauss connaissait ses possibilités et, après avoir achevé Elektra, il annonça que son prochain opéra serait un opéra mozartien. Ce qui n’était pas tout à fait faux.
Les premières allusions au Chevalier à la Rose se trouvent dans une lettre d’Hofmannsthal du 11 février 1909.
« J’ai passé ici trois après-midi dans le calme, en travaillant à un nouveau scénario pour un « Spieloper », gai, transparent comme une pantomime, donnant prétexte au lyrisme, à l’humour, au badinage, et même à un petit ballet... Deux grands rôles pour un baryton et une jeune fille toute gracieuse habillée en homme, à la Farrar, ou à la Mary Garden. »
Ce n’était qu’un simple projet. Bientôt le ballet disparut et l’action devint plus compliquée, moins mime. Strauss lui-même eut sa part dans le changement et dans l’amélioration de la construction du deuxième acte, qui était au départ une série d’allées et venues inutiles. Il fallait ensuite donner au troisième acte un nouveau dénouement qui conclut mieux, ce qui exigea un grand travail. La partition des deux premiers actes était, en fait, presque imprimée et Strauss n’avait pas encore reçu la fin du livret ! Hofmannsthal mit un grand soin à achever le texte, s’attachant à décrire avec une grande sensibilité les caractères et leur comportement, sensibilité qu’il voulait transmettre totalement à son compositeur. On la retrouve presque dans chaque page du Chevalier à la rose, dans le réalisme et la véracité des actions et dans les paroles des personnages. Les situations ont une dimension autre que dans la réalité, mais ce sont pourtant des réactions humaines, car, pour Hofmannsthal, il n’y a pas de convention dans l’opéra, mais seulement un drame et des personnages. Combien subtil, par exemple, apparaît le jeu des caractères dans le trio du dernier acte, depuis la sortie du Baron jusqu’au dénouement du grand ensemble Hab mir’s gelobt !
Et quelle différence entre cette scène et le premier projet d’Hofmannsthal ! Deux personnages seulement y figuraient : Octave et Ochs. Et après qu’il eût
fini le premier acte, Hofmannsthal pouvait écrire à son collaborateur : « Vous craignez que le jeu ne soit trop subtil. Cela ne me préoccupe guère. Le développement de l’action est simple et facile à comprendre même pour un public peu cultivé : un soupirant vieillissant, gros, fat, arrogant et ayant les faveurs du père est supplanté par un beau jeune homme. » Comme Hans Sachs dans les Maîtres Chanteurs de Wagner, le personnage de la Maréchale ne frappa l’imagination de l’auteur que lorsque le travail était déjà très avancé. La Maréchale ne paraît pas de tout le deuxième acte et de la première partie du troisième. Mais dès son retour majestueux, elle capte l’attention du public au détriment de tous les autres personnages, et bien que le titre de l’ouvrage ait été changé de Ochs en Le Chevalier à la Rose, aucun des personnages ne reste dans la mémoire des spectateurs avec autant d’intensité que celui de Marie- Thérèse.
Hofmannsthal savait ce qu’il faisait. En juin 1910, en effet, il écrivait : « C’est ce personnage que le public, et surtout le public féminin ressentira et c’est avec lui qu’il quittera le théâtre. » Et dans les derniers mois de la composition de l’opéra, il revint souvent sur ce même sujet, soucieux de ce que la musique de Strauss exprime bien ce changement dans l’intensité de l’action survenant en dernière heure.
Ses craintes n’étaient pas fondées. Déjà dans le prélude du premier acte, Strauss avait introduit la saveur et la tendresse des thèmes de la Maréchale. Voici la douce, féminine réponse aux avances d’Octave :

Puis, dans le deuxieme thème, il y a toute la dignité attendrie et la nature aimante de Bichette :
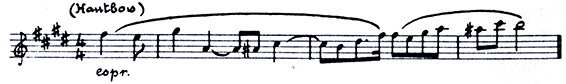
Et plus tard, il termina le prélude avec une mélodie pleine de noblesse et de sincérité qui exprime les sentiments de la Maréchale à la fin de l’acte :
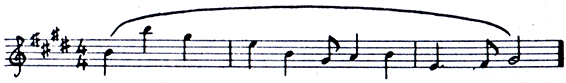
Le drame de la Maréchale commence au moment où elle doit renoncer à son jeune amant à cause d’une jeune fille qui appartient à une nouvelle génération. Cependant, la Maréchale ne doit pas nous apparaître comme une femme
âgée. Strauss était formel sur ce point : « La Maréchale doit être une femme jeune et belle, de trente-deux ans au plus, qui, dans ses instants de tristesse, se sent « une vieillerie » en comparaison d’Octave qui a dix-sept ans. Octave n’est ni le premier, ni le dernier amant de la belle Maréchale, et elle ne doit pas jouer la fin du premier acte sur un ton sentimental et pathétique comme un adieu tragique à la vie, mais avec grâce et dignité, un œil humide et l’autre sec. » La Maréchale est très proche de la Comtesse des Noces de Figaro de Mozart, autre personnage qui est trop souvent interprété, à tort, comme une grand-mère en puissance !
Dans le même essai (datant de 1942) sur Der Rosenkavalier, Strauss précisait son opinion sur le Baron Ochs : « Ochs doit être une sorte de Don Juan paysan, beau, âgé de trente-cinq ans environ, aristocrate (même s’il se comporte plutôt grossièrement), qui sait se tenir convenablement dans le salon de la Maréchale, de telle sorte qu’elle ne soit pas obligée de le faire jeter dehors par ses serviteurs après cinq minutes. Il est intimement prétentieux et vulgaire, mais suffisamment présentable pour être accepté par Faninal. » Strauss avait déjà exprimé ces traits dans le thème qui caractérise Ochs à sa première entrée :

Strauss acheva la partition du Chevalier dans sa nouvelle maison de Garmisch le 26 septembre 1910. Il avait trouvé un thème pendant une partie de cartes, mis une partie de la mise en scène en musique, dans son enthousiasme et écrit l’air du duo final avant que Hofmannsthal n’ait même commencé le troisième acte. Le langage musical est loin d’être aussi compliqué que celui d'Elektra, mais il s’agit d’une œuvre riche, d’une complexité délibérée et d’une grande ampleur; le seul orchestre de scène au rendez-vous de la taverne, au troisième acte, comprend deux flûtes, un hautbois, trois clarinettes, deux bassons, deux cors, trompette, tambour, harmonium, piano et cordes. Il n’est pas surprenant qu’il ait fallu vingt-deux répétitions d’orchestre pour la première qui eut lieu à Dresde le 26 janvier 1911. La distribution fut choisie parmi les effectifs de la compagnie de Dresde qui furent dirigés par Max Reinhardt. Le succès fut immédiat ; on organisa des trains spéciaux de Berlin et d’autres villes voisines pour assister au spectacle. Il n'y eut qu’à Milan que la première fut un fiasco (la jeune Lucrezia Bori y fut un Octave très apprécié) car le public se moqua des valses viennoises. Notons à ce propos que, lorsque Le Chevalier à la Rose fut présenté à Rostock en 1926, la presse locale le salua comme « une nouvelle opérette du Roi de la Valse » !
William MANN
III. Argument, par Max Piquepé
ACTE I.
Après un prélude orchestral, le rideau se lève sur la chambre à coucher de la Maréchale. C’est le matin. Octave fait à sa maîtresse une déclaration d’amour passionnée, toute vibrante de la fougue de l’adolescence, déclaration à laquelle la Maréchale répond avec une tendresse émue et souriante. Ce dialogue, interrompu par un négrillon qui apporte le petit déjeuner, reprend bientôt. La Maréchale, cette nuit, a rêvé de son mari. « Il est loin », dit Octave. « Pour loin qu’il soit, le Maréchal peut aller si vite ! Un jour... ». Ce mot malheureux excite la jalousie d’Octave. Il demande des explications.
Mais une voix se fait entendre dans l’antichambre. C’est le baron Ochs de Lerchenau, un vague cousin de la Maréchale, un rustre qui se pique de connaître les bonnes manières et se prend volontiers pour un Don Juan. Ecartant les laquais qui veulent l’empêcher d’entrer chez la Maréchale, il ouvre la porte de la chambre... et se trouve nez-à-nez avec une ravissante camériste, à qui il fait sur-le-champ un brin de cour. La camériste, on s’en doute, n’est autre qu’Octave, qui avait imaginé ce déguisement pour sortir sans être remarqué. La Maréchale calme la curiosité d’Ochs en lui donnant quelques détails sur la délicieuse enfant qui la sert — « Elle s’appelle Mariandel et vient tout droit de la campagne » — puis le baron explique à sa cousine le but de sa visite si matinale. Il a besoin d’un conseil. Il est sur le point de se marier à Mademoiselle de Faninal, la très jeune fille d’un parvenu viennois, le quel, bien qu’il n’ait pas de sang bleu dans les veines, est extrêmement riche. Selon la coutume, Ochs, avant de se présenter à sa fiancée, doit lui faire remettre une rose d’argent, mais il ne sait à qui confier cette délicate mission. Peut-être la Maréchale pourrait-elle suggérer quelqu’un ? Peut-être pourrait-elle aussi lui prêter son notaire pour la rédaction du contrat ? Pendant cet exposé, Ochs n’a pas quitté des yeux Mariandel-Octave et, chaque fois que celle-ci (ou celui- ci) faisait mine de gagner la porte, il l’a rappelée sous des prétextes divers et en a profité pour lui lancer quelques propos galants. La Maréchale sourit. « Mon cousin semble oublier », dit-elle, « qu’il est fiancé. »
« Faut-il qu’un fiancé soit aveugle ? », répond Ochs. « D’ailleurs, votre Mariandel doit avoir du sang bleu dans les veines », ajoute-t-il, comme pour se justifier. Cette remarque donne une idée à la Maréchale. Elle montre à Ochs le portrait d’Octave, un de ses parents, dit-elle, tout à fait digne de remettre la rose d’argent à la future baronne de Lerchenau. Ochs accepte le candidat de la Maréchale, remarque l’étonnante ressemblance entre Octave et Mariandel, et est ravi que la camériste appartienne, « par la cuisine », à une noble famille. Un majordome fait alors entrer les gens de maison et les quémandeurs qui attendaient dans l’antichambre le « grand lever » de la Maréchale. Octave profite du remue-ménage pour s’enfuir. Paraissent, pêle-mêle, le notaire de la Maréchale, son chef de cuisine, une marchande de modes française, un étudiant, un vendeur d’animaux, deux intrigants italiens, Valzacchi et Annina, une veuve éplorée et ses trois filles, un ténor italien, un flûtiste, puis le coiffeur de la Maréchale. Chacun présente sa requête ou vaque à ses occupations ; le baron entame une discussion avec le notaire, et le ténor chante une romance — interrompue grossièrement par le baron, qui se dispute (déjà) avec l’homme de loi. Tout le monde, bientôt, se retire. Mais Annina et Valzacchi ont eu le temps de proposer leurs services à Ochs, qui leur demande de se renseigner sur la mystérieuse Mariandel. Le baron laisse la rose d’argent à la Maréchale, puis, enfin, prend congé.
Seule, la Maréchale, après quelques sévères réflexions sur son odieux cousin, se laisse aller à de tristes pensées. Le mariage prochain d’Ochs et de la jeune Sophie lui rappelle le sien. Comme elle était jeune alors... et comme elle se sent vieille aujourd’hui. On l’appelait la petite Rézi... Bientôt, elle ne sera plus que la vieille Marie-Thérèse... Une vieille femme.
Le retour d’Octave (qui a abandonné son travesti) ne dissipe pas la mélancolie de la Maréchale. Au contraire. Doucement, elle dit au jeune homme, qui s’en indigne : « Aujourd’hui ou demain, tu me quitteras pour une autre plus jeune que moi. Le temps nous glisse entre les doigts, et nous n’y pouvons rien... Maintenant, laisse-moi seule. » Octave, tristement, se retire, oubliant d’embrasser sa maîtresse. Bouleversée par cet oubli, la Maréchale sonne ses laquais et leur ordonne de rappeler le jeune homme. Mais celui-ci est déjà loin. La Maréchale charge alors son négrillon d’aller porter la rose d’argent chez Octave. « Il saura ce qu’il doit faire. » Puis, seule de nouveau, elle se perd dans une mélancolique rêverie.
ACTE II.
Un salon, chez Faninal. Le grand jour de la présentation de la rose est arrivé. Faninal, comme c’est l’usage, se retire avant l’arrivée du porteur de la rose, laissant sa fille Sophie sous la garde de la duègne Marianne Leitmet- zerin. Celle-ci, postée à une fenêtre, décrit avec enthousiasme et volubilité l’arrivée du Chevalier à la Rose et de sa suite.
Octave parait, somptueusement vêtu. Il s’avance timidement vers Sophie et lui remet la rose d’argent, et il semble aux jeunes gens qu’ils ont déjà vécu ce moment pourtant unique, qu’ils ont déjà connu ce bonheur étrange d’être face à face. Le monde qui les entoure a disparu. Ils sont seuls, rayonnants de jeunesse et de beauté, soudain épris l’un de l’autre, et pour toujours. Un regard a accompli le miracle, un regard les a transportés dans un rêve. Mais la duègne rompt l’enchantement et offre des sièges aux deux jeunes gens. Une conversation s’engage, puis paraît le baron, qu’était allé chercher son futur beau- père. Ochs, suffisant, content de soi, s’adresse avec condescendance à Sophie et l’examine « comme un maquignon qui va acheter un cheval ! », s’exclame cette dernière qui, de plus, trouve Ochs d’une repoussante laideur. Octave assiste, furieux, à la cour grossière qu’Ochs fait à Sophie, sous les regards ravis de Faninal et de la duègne. « Avec moi, comme dans la chanson », dit Ochs à sa fiancée, « pas de nuit trop longue pour toi ! » « Des manières si... directes », murmure Faninal. « Quel honneur pour ma fille ! » Cependant, le notaire étant arrivé, il faut passer aux affaires sérieuses, et Ochs confie Sophie au Chevalier à la Rose.
« Tu peux même lui faire les doux yeux », dit-il à Octave, « car plus tu la dégourdiras, moins j’aurai de peine à la dompter !... »
Ochs, Faninal et leurs suites sortis, Sophie demande à Octave de la secourir. Jamais elle n’épousera le baron. Les deux jeunes gens, avec une touchante gaucherie, s’avouent alors leur amour et se jettent dans les bras l’un de l’autre. Mais les deux Italiens, Valzacchi et Annina, désormais au service du baron, les surprennent en train de s’embrasser. Ils ameutent toute la maison et vont chercher Ochs qui, revenu, prend la chose avec bonhomie. « Mademoiselle vous déteste ! », lui lance Octave. « Cela s’arrangera », réplique Ochs, et il veut entraîner Sophie pour signer le contrat. Octave s’y oppose, jette un défi au baron : « Venez sur le pré ! ». Ochs éclate de rire et siffle ses gens qui accourent, prêts à arracher Sophie à Octave. Le jeune homme alors tire son épée. Ochs est forcé d’en faire autant. Il s’élance sur Octave, qui se fend et fait couler une goutte du précieux sang bleu des Lerchenau ! « Au meurtre ! A l’assassi ! Police ! Police ! », hurle le baron. Scandale. Vacarme. Va-et-vient. Les domestiques d’Ochs vont chercher des pansements, font de la charpie avec les jupons des servantes de Faninal, apportent des fauteuils, des bassines. « Quel jour affreux ! », gémit la duègne. « Sauvez-moi ! », clame Ochs. Fou de rage, Faninal chasse Octave, menace Sophie du couvent si elle n’épouse pas le baron, fait les plus plates excuses à Ochs, puis, un médecin ayant pansé le grand blessé, se retire.*
Resté seul avec ses valets, Ochs lance quelques insultes bien senties à l’adresse d’Octave : « Un damoiseau qui veut jouer au spadassin ! Il faudra bien qu’il en rabatte ! », puis boit un grand verre de vin et retrouve aussitôt sa belle humeur. Cette pouliche indomptée de Sophie fera, au fond, une plaisante épouse. Le baron boit un autre verre et demande qu’on lui prépare un bon lit de plume. Il fredonne sa valse préférée : « Avec moi, pas de nuit trop longue... », et se verse de nouveau à boire. Annina paraît. Elle apporte à Ochs une lettre qu’il lui demande de lire à haute voix.
La lettre est de Mariandel (alias Octave), qui propose à Ochs un rendez- vous pour la nuit suivante. Ochs est au comble de la joie, ce qui ne l’empêche pas de renvoyer la messagère sans lui donner de pourboire. Il se félicite de « la chance des Lerchenau » et entonne une fois de plus sa valse.
ACTE III.
Un salon particulier dans une auberge. Au fond, dans une alcôve, un lit. Une table pour deux. Octave, avec le concours de Valzacchi et d’Annina, a décidé de perdre Ochs aux yeux de Faninal, seul moyen d’empêcher le mariage du baron et de Sophie. C’est à la mise au point — sans paroles — de ce complot que nous assistons pendant le long passage orchestral qui suit le lever du rideau. Derrière des portes secrètes ou sous des trappes, Valzacchi dissimule des individus aux airs patibulaires ; Annina, toute de noir vêtue, se cache derrière une fausse fenêtre. Octave, en Mariandel, surveille les préparatifs, puis sort. Dans une pièce voisine, un petit orchestre joue des valses langoureuses.
Octave-Mariandel reparaît en compagnie du baron, qui renvoie aussitôt l’aubergiste et les garçons, sans leur donner de pourboire. Il offre du vin à Mariandel, qui refuse d’abord, avec une roucoulante coquetterie, veut fuir, aperçoit le lit, et feint les plus grandes alarmes. Bien que la ressemblance entre Octave et Mariandel gêne considérablement Ochs, il n’en fait pas moins une cour pressante à la camériste — à qui la musique, puis le vin semblent donner des idées noires : « Que nous sommes peu de chose ! Rien », soupire-t-elle, « rien ne vaut la peine ! » « Mais si, mais si », affirme le baron, assez mécontent du tour que prennent les événements.
« On passera bientôt, vous et moi ! » — « La chaleur la fait divaguer », murmure Ochs. Soudain, des murs, du plancher, de partout, surgissent des têtes mystérieuses, qui regardent le baron en ricanant, puis disparaissent. Et voici que la fausse fenêtre s’ouvre brusquement et qu’une femme en noir en surgit, un doigt accusateur pointé vers Ochs : « C’est mon mari ! C’est lui ! » Puis quatre enfants, venus on ne sait d’où, se précipitent sur le baron avec des « Papa ! Papa ! Papa ! » à fendre des cœurs de pierre. Tout ce bruit attire les garçons d’auberge et l’aubergiste, qui compatissent avec la prétendue épouse d’Ochs, tandis que Valzacchi prévient Octave-Mariandel, en aparté, qu’il a envoyé chercher Faninal. Le baron n’a qu’un recours : appeler la police.
Mais le Commissaire qui se présente n’est pas bon enfant et, faute de témoins, refuse de croire qu’il a affaire au baron de Lerchenau. « Et qui est cette jeune personne ? », demande-t-il, apercevant Octave-Mariandel. « Ma fiancée, Mademoiselle de Faninal », dit le baron. A peine a-t-il prononcé ces mots que Faninal paraît. « Qui êtes-vous ? », lui demande le Commissaire. « M. de Faninal. » « Alors, Mademoiselle est votre fille ? », « Çà. ma fille ? », s’écrie Faninal indigné. « Ma fille est en bas, dans ma voiture ! » Et il envoie chercher Sophie. « Vous me le paierez », dit-il, hors de lui, à Ochs. Sophie paraît. « Le voilà, ton fiancé ! », lui crie Faninal. « Un joli monsieur ! » Sophie a quelque peine à cacher sa joie. Mais les émotions ne réussissent guère à Faninal, qui s’écroule à demi évanoui et est transporté dans une pièce voisine. Sophie s’empresse auprès de lui. Octave-Mariandel, entraînant le Commissaire dans l’alcôve (à la grande indignation d’Ochs), lui révèle toute l’histoire. Bientôt Sophie revient et, de la part de son père, annonce à Ochs que le mariage est rompu. Fureur d’Ochs.
A cet instant, entre la Maréchale. Un serviteur d’Ochs, la croyant du côté de son maître, était allé la chercher. Après quelques mots aimables au Commissaire, la Maréchale ordonne à Ochs de se retirer. Celui-ci, qui vient de voir Octave (de nouveau en vêtements masculins) sortir de l’alcôve, comprend enfin : « Je ne sais que penser », murmure-t-il à sa cousine. Et celle-ci de répondre : « Si vous êtes un galant homme, ne pensez rien, et partez... La mascarade est terminée. Tout est fini. » « Tout est fini », répète tristement Sophie. « Tout est fini », reprend Ochs de mauvaise grâce.
Vaincu, le baron se retire, sous les railleries d’Annina, qui se fait reconnaître, et au milieu des cris de « ses » enfants, des protestations des laquais, des garçons de l’auberge, du moucheur de chandelles, des cochers, des portiers et de l’aubergiste, qui tous le suivent en présentant leurs notes ou en réclamant leurs pourboires.
Sophie, la Maréchale et Octave restent seuls — Sophie et Octave très embarrassés, la Maréchale émue, mais maîtresse d’elle-même. Elle sait que, pour elle, le moment est venu de laisser aller Octave où le porte son cœur, vers la jeunesse, vers Sophie. « Va la rejoindre », dit-elle doucement à Octave. Sans bien comprendre, Octave obéit, et un admirable trio se déploie alors — la Maréchale renonçant à Octave, Octave exprimant son désarroi et son bonheur, Sophie sa reconnaissance et sa jalousie naissante : « Elle me le donne, et pourtant elle garde quelque chose de lui. » A l’insu des deux jeunes gens, qui poursuivent leur rêve éveillé, la Maréchale se retire. Elle revient peu après, avec le père de Sophie, désormais triomphant : « C’est bien cela, les jeunes gens... », dit Faninal, en tapotant paternellement la joue de Sophie. « Oui. oui », murmure la Maréchale avec un sourire au bord des larmes. Faninal et la Maréchale sortent. Sophie et Octave s’embrassent, puis, à leur tour, sortent. Sans s’en apercevoir, Sophie a laissé tomber son mouchoir. La scène reste vide un instant, puis le négrillon de la Maréchale paraît, cherchant le mouchoir. Il le trouve, le ramasse, et sort en trottinant tandis que le rideau tombe.
Max Piquepé




 À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.
ISSN 2269-9910.
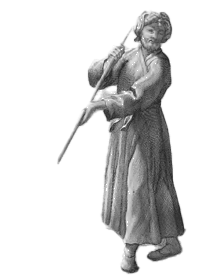
Dimanche 9 Novembre, 2025

