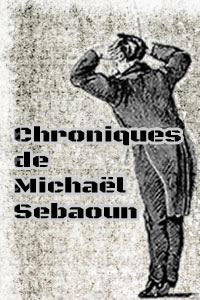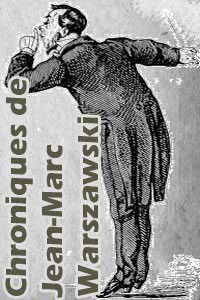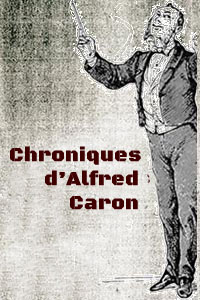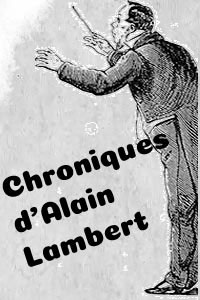Actualités musicales
13 juin 2013

 « Thi is the modern World » : Pour une histoire sociale du rock
« Thi is the modern World » : Pour une histoire sociale du rock
Colloque international, Université Charles-de-Gaulle Lille 3,
13-15 juin 2013, appel à communications.
Institutionnalisée de manière précoce dans les pays anglo-saxons, à la croisée de la musicologie et des cultural studies, l'histoire du rock a longtemps été considérée en France comme un objet d'étude mineur, abandonné aux critiques rock et à la presse spécialisée. De fait, alors que les musicologues, sociologues ou civilisationnistes élargissaient progressivement leur champ de recherche aux musiques « non légitimées », les historiens français n'abordaient le rock que par la marge, par exemple dans le cadre d'une histoire de la jeunesse ou d'une histoire des techniques et de l'industrie du disque.
Le travail pionnier de Bertrand Lemonnier (L'Angleterre des Beatles. Une histoire culturelle des années soixante, Seuil, 1995), fait figure d'exception. La soutenance de thèses en histoire culturelle sur l'histoire du rock, la multiplication des mémoires de Master sur ces thématiques témoignent de l'institutionnalisation progressive du rock au sein de l'Université en général, et des départements d'histoire en particulier.
Les pistes de recherches possibles sont très nombreuses, à la croisée des histoires sociale, culturelle, économique et politique. En effet, si l'histoire du rock passe par l'histoire des courants musicaux, elle ne se limite pas à cela. Le rock est un phénomène socio-musical complexe, qui mérite d'être étudié non seulement pour lui-même, mais comme un révélateur de mutations sociales et culturelles essentielles à la compréhension des sociétés depuis la seconde moitié du XXe siècle. C'est dans cet objectif qu'est organisé ce colloque, qui entend rendre compte de la richesse du champ, dans une perspective internationale et interdisciplinaire.
Ce colloque est ouvert aux chercheur.e.s et doctorant.e.s, travaillant sur l'histoire du rock et des musiques populaires, quelle que soit leur discipline. Une place sera faite également, dans la mesure du possible, aux travaux, apports et témoignages des érudits, des journalistes et des professionnels de la musique.
Le terme « rock » est entendu ici dans son sens le plus large et la période considérée va des années 1950 à nos jours. Les travaux portant sur le jazz, le folk, le rap ou les musiques électroniques pourront éventuellement être retenus, s'il apparaît qu'ils ouvrent des pistes nouvelles pour l'histoire du rock et des musiques populaires.
Le champ géographique n'est pas limité : si une part nécessaire sera faite aux études couvrant les espaces anglo-saxons (Amérique du Nord, Royaume-Uni notamment), les communications portant sur d'autres espaces européens (France, Allemagne, Bénélux, Scandinavie, pays méditerranéens, Europe centrale et orientale) et extra-européens (Afrique, Asie, Amerique du Sud, Océanie) seront particulièrement valorisées.
Les communications, d'une durée de 20 minutes, pourront être prononcées en français ou en anglais. Elles devront porter sur une recherche originale et non publiée.
Sont particulièrement recherchées les communications portant sur les thèmes suivants :
-sources et méthodologies :
- localisation et traitement des archives, sources privées, témoignages oraux, archives sonores et audiovisuelles.
- apport spécifique de la discipline historique, interdisciplinarité, place des journalistes et des professionnels de la musique.
transferts culturels et identités nationales : les communications traitant de l'acculturation (ou non) du rock dans différents espaces et mettant en avant des scènes rock nationales originales seront particulièrement valorisées. Les travaux relevant de l'histoire globale, de l'histoire croisée, de l'histoire connectée et de l'histoire comparée seront également particulièrement bienvenus.
-histoire sociale et économique : histoire des maisons de disque et de l'industrie du disque; histoire des salles de concerts, des clubs, des tournées ; histoire des techniques d'enregistrement, histoire des instruments de musique.
histoire sociale et politique :
- rock et politique : contre-cultures, rock et contestation, rock et jeunesse, rock et 1968, rock et communisme, rock et extrême-droite, censure, religion, politiques publiques du rock.
- gender studies : rock et féminisme, rock et masculinités, rock et sexualités, rock et homosexualités, rock et transgenre/queer...
- postcolonial studies : rock et ethnicité, rock et immigration, rock et cultures noires, rock et islam.
histoire sociale et culturelle :
- histoire des médias : le rock à la radio et à la télévision, la presse rock, la critique rock, le rock au temps d'internet
- cultures populaires, culture de masse, « haute culture » : rock et littérature, rock et cinéma, rock et arts plastiques, rock et bande dessinée, fanclubs, fandoms…
- visual studies : histoire des pochettes de disque, de l'affiche, du vidéo-clip ; histoire de la performance scénique.
Les propositions de communication (Un CV + un projet de communication de 1500 signes maximum), en français ou en anglais, devront être envoyées à Arnaud Baubérot (bauberot@u-pec.fr) et Florence Tamagne (ftamagne@noos.fr) avant le 1 octobre 2012. Le choix des communications sera confirmé pour le 30 octobre 2012.
Comité d'organisation :
Martine Aubry, Lille 3, IRHIS
Arnaud Baubérot, Paris Est-Créteil, CRHEC
Laurent Brassart, Lille 3, IRHIS
Florence Tamagne, Lille 3, IRHIS
Mélanie Traversier, Lille 3, IRHIS
Comité scientifique :
Arnaud Baubérot (historien, Paris Est Créteil).
Philippe Gonin (musicologue, Dijon)
Gérôme Guibert (sociologue, Paris 3).
Olivier Julien (musicologue, Paris 4).
Barbara Lebrun (French Studies, Manchester).
David Looseley (French Studies, Leeds).
Kaspar Maase (Historien, Tübingen)
Pascal Ory (Historien, Paris 1).
Christophe Pirenne (musicologue, Louvain).
Florence Tamagne (historienne, Lille 3).
 New Elizabethans 1953-2013: Nation, Culture, and Modern Identity
New Elizabethans 1953-2013: Nation, Culture, and Modern Identity
13-15 June 2013, Call for Papers
Papers are invited for a major international, interdisciplinary conference to be held at Senate House, London. In the years surrounding the Coronation of Elizabeth II, British political and cultural life was suffused with a language that both prophesized and idealized the potential for a new Elizabethan era. The self-styled new Elizabethans identified an innate national character in the accomplishments of a vanished age. This age was apparently manifest in 'Shakespearean' music, theatre, and poetry -- and characterized by imperial expansion and exploration, a clear sense of social hierarchy, a fierce and heroic spirit of patriotic individualism, and the brave resistance of a mighty little people to larger invading forces.
It is the aim of this conference to explore the informing values and assumptions behind such constructions, to investigate their manifestation in various contexts and forms, and to expose the ways in which they continue to be promoted in contemporary social, cultural, and political definitions of modern identity in relation to Britain and the Commonwealth. Papers are invited from a variety of critical and disciplinary perspectives. Ideally, they will engage with such informing themes as nostalgia, patriotism, heritage, progress, tradition, national character, and/or nation itself.
Possible areas of exploration include (but are certainly not limited to):
- The Festival of Britain
- The Arts Council and cultural policy
- Bloomsbury and Elizabethanism
- Church, Reformation, and devotion
- Jubilee and/or Coronation celebrations
- Shakespeare in a new Elizabethan age
- Music and national tradition
- Satire and subversion
- New Elizabethanism and popular culture
- Writing the state-of-the-nation
- National myth and/or ritual
Confirmed speakers include:
Michael Bogdanov Edward Bond Richard Eyre Michael Hirst
Dr Scott Anthony (History, University of Cambridge)
Professor Arthur Aughey (Politics, University of Ulster)
Professor Stephen Banfield (Music, Bristol University)
Professor Vernon Bogdanor (Institute for Contemporary History, King's College London)
Professor Rob Carson (English Literature, William and Hobart Smith)
Professor Becky Conekin (History, Yale University)Dr Rob Gossedge (English Literature, Cardiff University)
Dr Ankhi Mukherjee (English Literature, University of Oxford)
Professor Helen Phillips (English Literature, Cardiff University)
David Prosser (Stratford Shakespeare Festival of Canada)
Professor Jeffrey Richards (Cultural History, Lancaster University)
Professor Paul Stevens (English Literature, University of Toronto)
Professor Heather Wiebe (Music, University of Virginia)
Professor Richard Wilson (Shakespeare Studies, Kingston University)
Ghislaine Wood (Senior Curator, Victoria and Albert Museum)
Proposals (max. 250 words) for papers of 20 minutes should be sent to the conference organizer, Dr Irene Morra (Cardiff University), at newelizabethanconference@hotmail.com by 15 December 2012.
 A corps et voix :
Repenser le politique au prisme des pratiques musicales et dansées
A corps et voix :
Repenser le politique au prisme des pratiques musicales et dansées
Appel à contribution
Colloque ethnomusiKa, Musée du Quai Branly – Paris, 13 et 14 juin 2013
Les liens entre musique, danse et politique relèvent d'une thématique centrale pour l'anthropologie. La musique et la danse, notamment dans leur dimension performative, représentent des activités génératrices d'expériences sensibles singulières et puissantes pour les individus, qu'ils en soient les producteurs ou les récepteurs. Modes d'action sur le monde générant de nouveaux types de relations, musique et danse seraient en ce sens susceptibles de créer de nouvelles catégories de pensée. L'affaissement des grands paradigmes structuralistes au profit d'une micro-anthropologie relationnelle des rapports sociaux a permis de sublimer la question de l'efficacité de la musique et de la danse, tout en repoussant à l'arrière plan des questionnements plus larges sur leur articulation avec la configuration du pouvoir, des rapports de force et des institutions qui sont centrales dans la question du politique. L'objectif de ces journées d'études est d'interroger l'efficacité politique de la musique et de la danse en considérant à la fois leurs dimensions esthétiques et leurs effets dans le monde social.
Platon avertit que l'on ne peut changer les modes de la musique sans bouleverser les lois fondamentales de l'Etat. La musique et la danse constituent un biais par lequel les catégories dominantes peuvent être affirmées mais également contestées et renégociées. Ces pratiques sont ainsi manipulées en tant qu'espaces privilégiés du politique, que ce soit par des appareils d'Etat coercitifs, par les groupes dominants ou par les groupes subalternes qui les mobilisent comme activités de résistance et d'émancipation. Si les voix, les sons et les gestes dansés représentent des matières privilégiées pour l'incorporation de la hiérarchisation des valeurs produites par les dominants, ils peuvent également être au coeur de techniques de subversion et de détournement des rapports de force. La sémiologie complexe des pratiques telle que musique et danse, qui ne sont pas à proprement parler des langages - alors même que l'anthropologie ne cesse de vouloir les faire parler - nous invite à interroger les multiples couches de sens qu'elles mobilisent. Nous serons particulièrement attentifs aux significations publiques, mais également cachées, internes à certains acteurs, où peut se loger une dimension politique qui n'est pas toujours explicitée.
Qu'est-ce que la musique et la danse peuvent nous apprendre sur la technologie de la domination (Foucault) et sur la technologie des pratiques de résistance (Scott) ? Comment à son tour une analyse de la dimension politique de la musique et de la danse nous renseigne sur la nature de ces activités sociales singulières ?
Nous proposons ici quatre axes dans lesquels les contributions pourront s'inscrire.
I. Politiques culturelles et stratégies politiques de l'identité : l'Etat-Nation face à ses minorités
Dans la création des Etat-Nations, la question de l'appartenance et de l'identité nationale entraine l'apparition d'un nouveau statut : celui de la minorité. Les stratégies politiques peuvent mettre en marge ceux qui ne correspondent pas aux critères et aux normes établies par l'Etat Nation, ils stigmatisent les mémoires, les générations et forment des consciences « minoritaires ». À partir d'exemples ethnographiques, cet axe interrogea le rapport de force entre minorités et Etat-Nations à travers les pratiques musico-chorégraphiques. Dans un contexte contemporain de patrimonialisation intensive, comment les pratiques musicales sontelles formulées, organisées et interprétées aussi bien par les groupes minoritaires, par les élites politiques et par les instances nationales et internationales ? Quelles sont les institutions
– conservatoires, universités, administrateurs culturels - impliqués dans des formes de « traditionalisme d'Etat » ? En quoi les pratiques musicales et dansées sont-elles centrales pour les groupes minoritaires dans les processus de négociation de visibilité et de pouvoir symbolique et politique au sein des communautés nationales ?
II. Investir l'espace : musique, danse et territoire
Les performances musico-chorégraphiques peuvent être utilisées pour construire des catégories sociales, ethniques, de genre, ou encore générationnelles. Les travaux des géographes de la musique explorent également l'inscription des pratiques musicales dans des espaces physiques choisis, organisés et investis de significations. Analyser la performance en tant qu'espace symbolique des relations permet ainsi d'interroger la façon dont le territoire reflète le sens donné aux pratiques musicales et les positionnements de leurs acteurs. En d'autres termes, prendre l'espace physique, c'est prendre position dans l'espace social. À partir d'exemples ethnographiques cet axe interrogera la notion de « lieu » et son investissement par les individus, ouvrant une réflexion sur l'articulation entre musique, danse et territoire. Comment les hommes s'approprient et transforment-ils les territoires par les pratiques musico-chorégraphiques, que ce soit au niveau local, national ou international ?
Comment la musique et la danse contribuent-elles à la définition et à la reconfiguration des espaces privés et publics ?
III. La voix politique : pouvoir de la musique et des mots
La parole chantée semble insuffler à son contenu une efficacité singulière : entonné en groupe, un chant prend une dimension collective qui lui confère une puissance sans pareil. Quand la voix mise en musique se fait porteuse d'un engagement, d'un positionnement politique, elle devient pouvoir mobilisateur : celui des chants révolutionnaires et des hymnes nationaux. La musique peut également exercer une influence particulière sur l'efficacité de la parole politique. Cet axe interrogera donc les spécificités de la parole chantée. Les débats théoriques autour de la pertinence d'une approche sémantique de la musique peuvent ainsi constituer une base de réflexion pertinente pour appréhender les rapports entre musique et langage. Quelles propriétés la parole acquière-t-elle par sa mise en musique ? Comment la mélodisation et la mise en rythme de paroles contribuent-t-elles à leur efficacité ? Comment un genre musical, une chanson ou un individu deviennent-ils la voix d'une cause politique, le représentant de revendications ou d'une identité ? Autant de procédés qui pourront être analysés à travers des exemples ethnographiques précis où le sens de la parole mise en musique peut être autant sublimé que détourné.
IV. Musique et danse : des pratiques politiques efficaces ?
Pourquoi, plus que toute autre activité sociale, la musique et/ou la danse sont-elles toujours au coeur des processus politiques et plus particulièrement des stratégies politiques de l'identité ? De nombreux travaux ethnologiques et ethnomusicologiques ont montré comment ce type de pratiques et d'expériences esthétiques révélait une puissance politique transformatrice et agissait concrètement sur l'organisation sociale des groupes et plus largement des sociétés. Au delà des spécificités propres à chaque terrain, il s'agira d'interroger, de manière générale, la nature même des actes dansés et musicaux et des dynamiques qu'ils génèrent. Emergence d'un modèle relationnel spécifique, propriétés cognitives et émotionnelles particulières, mode de communication propre ou expérience singulière de l'altérité sont autant de caractéristiques possibles (la liste est évidemment ouverte) permettant d'esquisser une réponse théorique à cette question initiale. Enfin, musique et danse peuvent également être appréhendées distinctivement, c'est à dire comme des matériaux qui n'agissent pas sur les mêmes objets, ni de la même manière : quelles en sont alors les différences fondamentales ?
Modalités
Les communications orales auront une durée de 30 min, suivies de 15 min de discussion.
Date limite d'envoi des propositions : 7 février
Résumé de 3 000 signes suivi du nom, affiliation et contact email.
Les propositions sont à envoyer à l'adresse suivante : recherche@festival-ethnomusika.org
Date de rendu de la sélection du comité scientifique : 8 mars
Date d'envoi des communications par les personnes retenues : 20 mai
Maximum de 16 000 signes. Ce texte permettra aux introducteurs et aux modérateurs de préparer leur intervention et facilitera la publication envisagée.
Keynote speaker
Loïc Wacquant (Berkeley University)
Intervenants invités (introduction des sessions et table ronde finale)
Marie-Pierre Gibert (Lyon 2)
Denis Laborde (EHESS)
Rosalía Martínez (Paris 8)
Yves Raibaud (Université de Bordeaux 3)
Loïc Wacquant (Berkeley University)
Comité scientifique
Eftychia Droutsa (Paris-Sorbonne)
Nathalie Gauthard (Université Nice-Sofia Antipolis)
Christine Guillebaud (CREM-CNRS)
Sara Le Ménestrel (CENA-CNRS)
Bernard Lory (INALCO)
Yves Raibaud (Université de Bordeaux)
Qui sommes nous ? S'abonner au bulletin Collaborations éditoriales
| L | M | M | J | V | S | D |
| < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
musicologie.org
56 rue de la Fédération
F - 93100 Montreuil
06 06 61 73 41