Musique populaire et surréalisme
Troisième suite sur Silence d'Or d'André Breton, en continuant de relire Rousseau.
Les textes théoriques concernant la relation entre surréalisme et musique sont rares, à cause de l'anathème fondatrice de Breton, dans un court paragraphe du n°4 de la Révolution Surréaliste du 15 avril 1925, soit à peine six mois après le lancement de la Révolution surréaliste, c'est à dire le mouvement, le bureau d'étude et la revue dont le 1er numéro est daté du 1er décembre 1924.
A ces divers degrés de sensations correspondent des réalisations spirituelles assez précises et assez distinctes pour qu'il me soit permis d'accorder à l'expression plastique une valeur que par contre je ne cesserai de refuser à l'expression musicale, celle-ci de toutes la plus expressément confusionnelle. En effet, les images auditives le cèdent aux images visuelles non seulement en netteté, mais encore en rigueur, et n'en déplaise à quelques mélomanes, elles ne sont pas faites pour fortifier l'idée de grandeur humaine. Que la nuit continue donc à tomber sur l'orchestre, et qu'on me laisse, moi qui cherche encore quelque chose au monde, qu'on me laisse les yeux ouverts, les yeux fermés - il fait grand jour - à ma contemplation silencieuse.
André Breton, Le surréalisme et la peinture. Dans dans « La Révolution Surréaliste » (4), 15 avril 1925, p. 26.
Il fallait citer ce court texte a priori définitif dont la phrase finale reviendra plus tard en échos multiples comme une incantation, occultant les rares tentatives de réconciliation des autres membres du mouvement. Michel Boujut dans le Dictionnaire général du Surréalisme (PUF 1982), cite un opus de Gérard Legrand, Puissances du Jazz, un article de Robert Goffin dans « Jazz s (47), et quelques lettres entre Desnos / Armstrong, Aragon / Ellington, Tzara / Rollins, Césaire / Mingus, Char / Roach...
Mais, en 1944, une revue musicale américaine, Modern Music, pour son numéro de mars, demande à Breton un texte, signé et daté du 24 février, sur la musique et la poésie qu'il publiera en français, sous le titre Silence d'or, avec une première partie modifiée, dans le volume de Poètes d'aujourd'hui chez Seghers, que Jean Louis Bédouin lui consacre en 1950. Et dont le titre seul sera source de contre-sens, comme si Breton ne faisait que reprendre son paragraphe fondateur.
Au contraire, la lecture de Silence d'Or, fondamental par son caractère développé, nous aidera à montrer que l'anathème de 1925 est non seulement levé, mais aussi invalidé, puisque la poésie ne peut se concevoir hors de la musique et de la musicalité. Et quels prolongements possibles sont alors sous-entendus pour rester dans la dimension auditive.
Une introduction qui accepte de remettre en doute : les a priori du poète
La première partie est en fait une longue introduction qui semble répéter l'anathème, tout en s'en distanciant en plusieurs points.
Déjà, dans la première mouture (J'éprouve quelque trouble, j'ai peine à surmonter un vif sentiment d'intrusion à l'idée de m'exprimer dans une revue musicale... Brouillon du texte lisible sur le site André Breton) il semble se demander s'il est bien le plus approprié à traiter de cette question. Dans la version publiée en France, il réitère, en se demandant si « l'extrême spécialisation » n'est pas un obstacle à l'intelligence, se rappelant comment certains propos de Valéry sur la peinture cubiste l'avaient autrefois choqué.
C'est donc du point de vue général de la connaissance qu'il va s'affronter au problème de savoir pourquoi la plupart des « artistes de la langue » sont hostiles à la musique, une réflexion épistémologique en somme, « par delà [ses] réactions personnelles à la musiques ». En s'appuyant sur un texte des Goncourt, qui avouant eux même leur propre surdité (en effet, ils ne sont sensibles qu'à la musique militaire, les pauvres!) et ne font que citer une critique de Gauthier, qui, « préférant le silence à la musique » explique que Balzac, Hugo, Lamartine sont dans le même cas.
Mais que vaut cette généralisation ? A peine fermés les guillemets, Breton cite deux exceptions majuscules pour les Surréalistes: Baudelaire et Mallarmé qui étaient sans doute plus surréalistes, l'un « dans la morale » l'autre « dans la confidence » (voir la liste du premier manifeste) que tous les autres réunis. Puis revenant à ses contemporains, il note que bien peu se montrent vraiment hostiles à la musique, et ne sont qu'indifférents ou complaisamment polis, mais sans se passionner pour elle, ce qui pourrait s'expliquer, conclut-il, par la mainmise d'un certain imposteur qui finit par « abaisser au lieu d'élever tout ce qu'il touche ».
La musique peut aider à résoudre la crise de la poésie, car elles ont une origine commune
Une fois levés les deux obstacles épistémologiques qui expliquent son mal-entendu vis à vis de la musique, sa propre surdité et l'influence néfaste et totalitaire de Cocteau sur cet art, il peut alors réfléchir objectivement, ce qui introduit sa deuxième partie dans le vif du sujet:
L'accueil diamétralement opposé qu'en raison de ma complexion individuelle je réserve à la poésie et à la musique ne m'entraîne cependant pas à me départir de tout jugement objectif en ce qui les concerne. M'en tiendrais-je à la hiérarchie proposée par Hegel, la musique, par rang d'aptitude à exprimer les idées et les émotions, viendrait immédiatement après la poésie et devancerait les arts plastiques. Mais surtout, je suis persuadé que l'antagonisme entre la poésie et la musique qui semble avoir atteint son point culminant pour quelques oreilles d'aujourd'hui, ne doit pas être stérilement déplorée mais doit au contraire être interprété comme indice de refonte nécessaire entre certains principes des deux arts.
Deux choses à noter ici: d'une part, en acceptant la classification hégélienne qui place la musique en dessous de la poésie et au dessus de la peinture, il revient sur ce qu'il avait affirmé dans l'anathème de 1925, et d'autre part, prolongeant dialectiquement ce nouvel acquis, il admet que l'actuel antagonisme entre les deux arts doit déboucher sur une synthèse, « une refonte nécessaire ».
Ce qui ne fait que rappeler cette « faculté unique, originelle, dont on retrouve trace chez le primitif et l'enfant » écrivait-il déjà dans Le Message automatique, (in « Point du Jour »).
la musique et la poésie ont tout à perdre à ne plus se reconnaître une souche et une fin communes dans le chant, à permettre que la bouche d'Orphée s'éloigne chaque jour un peu plus de la lyre de Thrace. Le poète et le musicien dégénéreront s'ils persistent à agir comme si ces deux forces ne devraient jamais plus se retrouver... Il faut vouloir unifier, ré-unifier l'audition, au même degré qu'il faut vouloir unifier, ré-unifier la vision.
Mais il ne peut donner aucune idée de cette réunification de l'audition par manque de connaissances techniques de la composition musicale, invitant ceux qui le peuvent à travailler dans ce sens, et ajoutant que ce qui se passe déjà au niveau du visuel pourrait être transposé à l'auditif. Une fusion qui ne pourra être obtenue « qu'à très haute température émotionnelle », au « point suprême d'incandescence [qui ne peut être atteint] que dans l'expression de l'amour »..
Cette fin de partie appelle deux remarques, d'une part le fait que cet appel à inventer lancé aux musiciens (il ne s'agit donc pas seulement de la musique intérieure comme semble le comprendre la préfacière du texte dans le volume III de la pléiade) et aux lecteurs de langue anglaise n'a pu tomber dans l'oreille de sourds, en 1944, aux USA, quand certains futurs membres de la Beat Génération se rencontraient à New York dans les années be Bop. Nous y reviendrons plus tard.
D'autre part, toute cette idée de faculté originelle unifiée entre musique et poésie à retrouver dans l'expression de l'amour ne peut pas ne pas avoir été plus ou moins inspirée par certains passages de l'Essai sur l'origine des langues de Rousseau qui affirme en titre dès le chapitre II :
Que la première institution de la parole ne vient pas des besoins, mais des passions... [et continue] On nous fait du langage des premiers hommes des langues de géomètres, et nous voyons que ce furent des langues de poètes.
En effet, la faim et la soif n'ont pas besoins de mots, mais de gestes pour s'assouvir, quand l'homme vit encore solitaire. Mais quand le besoin des autres devient un besoin moral de se regrouper, les passions engendrées par ce contact comme l'amour, la haine ou la pitié vont faire naître un langage à la fois parole et chant, imagé et mélodique. Ce qu'il affine à la fin du chapitre IX :
En un mot, dans les climats doux, dans les terrains fertiles, il fallut toute la vivacité des passions agréables pour commencer à faire parler les habitans : les premières langues, filles du plaisir et non du besoin, portèrent longtemps l'enseigne de leur père ; leur accent séducteur ne s'effaça qu'avec les sentimens qui les avaient fait naître, lorsque de nouveaux besoins, introduits parmi les hommes, forcèrent chacun de ne songer qu'à lui-même et de retirer son cœur au-dedans de lui.
Avant de conclure à son évolution néfaste au chapitre XIX :
A mesure que la langue se perfectionnait, la mélodie, en s'imposant de nouvelles règles, perdait insensiblement de son ancienne énergie, et le calcul des intervalles fut substitué à la finesse des inflexions... L'étude de la philosophie et le progrès du raisonnement, ayant perfectionné la grammaire, ôtèrent à la langue ce ton vif et passionné qui l'avait d'abord rendue si chantante... La mélodie étant oubliée, et l'attention du musicien s'étant tournée entièrement vers l'harmonie, tout se dirigea peu à peu sur ce nouvel objet ; les genres, les modes, la gamme, tout reçut des faces nouvelles : ce furent les successions harmoniques qui réglèrent la marche des parties. Cette marche ayant usurpé le nom de mélodie, on ne put méconnaître en effet dans cette nouvelle mélodie les traits de sa mère ; et notre système musical étant ainsi devenu, par degrés, purement harmonique, il n'est pas étonnant que l'accent oral en ait souffert, et que la musique ait perdu pour nous presque toute son énergie... Voilà comment le chant devint, par degrés, un art entièrement séparé de la parole dont il tire son origine ; comment les harmoniques des sons firent oublier les inflexions de la voix ; et comment enfin, bornée à l'effet purement physique du concours des vibrations, la musique se trouva privée des effets moraux qu'elle avait produits quand elle était doublement la voix de la nature.
Des phrases que Breton n'aurait pas reniées et qui complètent assez bien tout ce que son article peut sous-entendre sur cette faculté originelle perdue.
Le vrai poète n'est pas un visionnaire mais un auditif
La troisième partie est consacrée non à la musique proprement dite mais à la musicalité de la poésie qu'il privilégie, en tant que surréaliste, à sa dimension visuelle, retrouvant ici la hiérarchie hégélienne déjà évoquée, et en mettant de côté la musique instrumentale qui seule lui pose problème. Les poètes surréalistes ne jouent que sur la possibilité d'assembler les mots en chaines de sons plus que de sens, et contre la raison étroite si besoin, pour les révéler à la lumière du jour:
La parole intérieure... est absolument inséparable de la musique intérieure... Telle qu'elle est enregistrée par l'écriture automatique, [elle] est assujettie aux mêmes conditions acoustiques de rythme, de hauteur, d'intensité et de timbre que la parole extérieure, quoique à un degré plus faible. En cela elle s'oppose du tout au tout à l'expression de la pensée réfléchie, qui ne garde plus aucun contact organique avec la musique... Mais surtout, l'indépendance de la pensée intérieure par rapport aux obligations sociales et morales auxquelles doit s'astreindre le langage parlé et écrit la met dans la seule nécessité de s'accorder avec la musique intérieure qui ne la quitte pas... Les grands poètes ont été des « auditifs », non des visionnaires. Chez eux la vision, « l'illumination » est, en tout cas, non pas la cause, mais l'effet... selon moi, ces choses n'ont été vues que secondairement, elles ont d'abord été entendues...
On ne peut s'empêcher de repenser à l'extrait du chapitre XIX de l'essai de Rousseau cité plus haut, et qui décrit l'évolution de la langue mélodique évoluant au cours des siècles en langue parlée puis écrite, au fur et à mesure que la grammaire, la philosophie et l'harmonie se développent et séparent la parole de son origine mélodique et passionnée.
L'étude de la philosophie et le progrès du raisonnement, ayant perfectionné la grammaire, ôtèrent à la langue ce ton vif et passionné qui l'avait d'abord rendue si chantante...
Comment Breton, mis au pied du mur par la demande d'un article sur la musique, n'a-t-il pas pu lire cette œuvre mal connue de Rousseau, philosophe décalé dont il partage pas mal de vues en fait?
Enfin, Breton conclut par un appel:
Aux musiciens j'aimerais faire observer qu'en dépit d'une grande incompréhension apparente, les poètes se sont portés loin à leur rencontre sur la seule voie qui s'avère grande et sûre par les temps que nous vivons: celle du retour aux principes. Mais peut être avec eux le manque d'un vocabulaire commun m'empêche-t-il de mesurer leurs pas vers ceux qui pour la faire revivre doivent partager avec eux un peu de terre sonore et vierge.
L'anathème est bien levée, et en ces temps de crise pour la poésie et la musique, retrouver cette terre commune, et la défricher, est bien une amorce de programme révolutionnaire.
Les contre cultures jazz ou rock et le surréalisme
D'abord, il faudrait, à la lecture de ces derniers passages, revenir à l'entretien qu'avait accordé Petr Kral, ancien surréaliste tchèque, dans une émission de France Culture en 2002 consacrée justement au surréalisme et à la musique, dans laquelle il avouait avoir trouvé à l'époque la musique qui lui correspondait chez Monk et chez Rollins. Puis s'interrogeant sur la relation entre automatisme et improvisation, il déclarait que cette dernière, en respectant les règles rythmiques, harmoniques...ne pouvait être comparée à l'écriture automatique qui refuse toutes les règles.
Ce qui n'est pas entièrement vrai, puisque l'automatisme doit retrouver notre parole intérieure, qui pour ne pas être une logorrhée simplement phonique, doit bien s'astreindre à respecter un minimum de règles car, si le son prime sur le sens, les images doivent pouvoir exister, au moins comme effet. Il ne s'agit pas pour les surréalistes de retrouver le bruitisme dada ou le zaoum phonique des futuristes russes. Mais bien de retrouver cette parole des origines et de la faire apparaître dans la langue parlée. En quoi l'improvisation jazz des musiciens cités plus haut correspond assez bien à l'exigence surréaliste, même si la vocalité s'est transmise à l'instrument en devenant purement sonore. Je chante comme un instrument à vent disait Billie Hollyday, réciproque du fait que Louis Armstrong, en inventant l'improvisation individuelle en jazz, donc en inventant le jazz moderne, ne faisait que continuer son expérience de gamin chanteur de rue. C'est aussi lui qui inventa ce mixte entre la voix parlée et la voix instrumentée, le scat.
C'est sans doute pourquoi le free jazz, dans sa volonté de briser toutes les règles et de dépasser toutes les contraintes, est vite devenu trop abstrait pour que les surréalistes puissent y adhérer confirme Petr Kral, ce qui infirme un peu son affirmation sur l'écriture automatique sans règles.
Ensuite, il faudrait se demander si la beat-génération du point de vue des poètes, puis la musique populaire anglo-saxonne des années soixante et soixante dix, du point de vue des musiciens, ne sont pas une double réponse à l'appel, en anglais rappelons le, de Silence d'or ?
En partie au moins, car ces deux contre-cultures sont fortement teintées de contre-culture surréaliste, des contre-cultures blues et jazz, et fortement marquées par une nouvelle technologie (radio, cinéma, disque, télévision...) qui permet à une nouvelle tradition non écrite de se développer, particulièrement autour de l'année 1966 qui voit la disparition de Breton, dans un silence de marbre cette fois.
Qu'on écoute par exemple Célébration of the lizard de Jim Morrison et des Doors, qui démarre comme une ancienne comptine revenue de l'enfance et des âges anciens, les explorations électriques de Jimi Hendrix, les nombreux rêves chantés par Bob Dylan, ou les poèmes de Keith Reid qui semblent prolonger La glace sans tain des Champs Magnétiques de Breton et Soupault, mais ne peuvent s'entendre sans la musique de Procol Harum (comme les poèmes de Pete Brown ne peuvent s'entendre sans la musique de Cream). La poésie s'est fondue avec la musique, à un point d'incandescence qui n'est pas si éloigné de celui de l'amour, comme le voulait Breton.
Ce que confirme cette remarque de Nick Cohn sur les Beattles, dans son A Wopbopaloobop Alopbamboom de 1969 (Titre américain : Rock from the begenning ) :
A partir de 1964 toutefois, sous l'influence des textes de Bob Dylan, leurs paroles à l'origine strictement littérales sont devenues plus étranges, excentriques et surréalistes. Des messages et du sens : soudain, le temps des artistes créatifs était venu... [Dylan] a bousculé presque tout le monde - les Beatles et les Stones, Jimi Hendrix et Cream et les Doors, Donovan et les Byrds - et presque tout ce qui sort de nouveau maintenant puise à sa source. Avec lui, la pop est devenue adulte, il lui a donné un cerveau
[Ed. Allia, p.155 et 202].
Alain Lambert
fevrier 2011
Voir : Musique populaire et contre-culture ; Rousseau et la musique.




À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISSN 2269-9910.
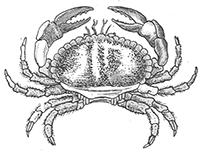
Jeudi 29 Février, 2024

