Norbert Dufourcq (1904-1990)

La musique religieuse française de 1660 a 1789
Extrait de la « Revue Musicale » (223) 1954, p. 89-110 [numéro consacré à « La musique religieuse française des origines à nos jours »].
En une quinzaine de pages, nous ne saurions prétendre condenser un si vaste sujet : d'autant plus que, contrairement à la vraisemblance, cette période, moins connue que celle de la Renaissance, pose quantité de problèmes dont seuls quelques-uns ont trouvé leur solution. Nous nous contenterons de fournir au lecteur des indications générales et de l'orienter, à travers un index surchargé de noms, en ce dédale de formes, d'oeuvres, d'esthétiques qui se peuvent résumer en la subite ascension d'un genre : le grand motet, puis en sa lente et inéluctable décadence. Si la musique reflète une civilisation, la musique religieuse se devrait de symboliser une société en les diverses manifestations de sa foi : une foi qui vient d'être stimulée par les dévots et les mystiques, une foi sans doute ébranlée par les libertins, mais aussitôt vivifiée par saint Vincent de Paul, Madame Acarie et la Société du Saint-Sacrement, une foi qui, depuis les folies de la Régence, ira peu à peu se dissolvant sous les coups et les écrits des philosophes, et que M. de Voltaire finira par saper.
Deux institutions viennent résumer l'histoire de cet ample mouvement, la seconde étant indirectement issue de la première, la seconde encore, en dépit de son titre et de son dessein initial : assurer la survie du grand motet, s'employant à laïciser le genre ou à en extraire — sans idée préconçue s'entend — les germes qui portaient à la prière.
Car si la Chapelle royale a manifestement tenu le premier rôle dans l'histoire de la musique religieuse sous le règne de Louis xiv, elle résume d'abord, puis, institution d' «avant-garde», développe sur un autre plan le programme de maintes maîtrises de Paris ou de la province, de maints chœurs célèbres comme celui de la Sainte-Chapelle du Palais. — elle se double, dès 1725, du Concert spirituel des Tuileries, institution profane qui croît en marge du culte dans le seul propos de fournir aux Parisiens de la musique — celle qu'ils aiment et dont ils ont apprécié au sanctuaire toutes les beautés — les jours où l'Académie (entendez l'Opéra) fait relâche.
Dans l'histoire de ces cent trente années, trois époques apparaissent, très diverses de ton, de qualité et qui en appellent à l'une ou à l'autre de ces institutions, parfois aux deux réunies. De 1660 à 1690, la réorganisation de la Chapelle royale va permettre à deux générations d'artistes de fournir des preuves de leur esprit inventif ou combatif. De cet effort et de ces recherches, une troisième génération récoltera les fruits au sein de la même chapelle (1695-1730). Subitement, l'apparition du Concert spirituel vient modifier l'optique des compositeurs : une musique religieuse de concert prendra place aux côtés de la musique de chapelle. Elle en est issue à l'origine. On comprendra sans peine qu'elle s'en distingue rapidement quitte, plus tard, à s'opposer à elle. Et puisqu'elle ne sert plus un culte, cette musique, vidée de sa substance religieuse, évoluera rapidement vers l'histoire sacrée, l'oratorio, l'ode religieuse, l'ode patriotique. En soixante années, le Concert spirituel a ramené la musique vocale religieuse au rang d'une musique profane : à quoi se sont employées deux générations d'artistes. La première, héritière des plus nobles traditions de la Chapelle royale, s'efforcera, jusqu'à la mort de Rameau (1764), de les servir encore en dehors du temple. La seconde, qui les ignore (1760-1790), ouvre la porte à la médiocrité, parfois même à la trivialité.
De grands noms apparaissent ici ou là qui mènent cet art à son apogée d'abord, — Du Mont, Lully, Charpentier, Delalande, Couperin, Campra, — d'autres, souvent responsables eux-mêmes d'un changement d'orientation, s'efforcent de le retenir en sa chute verticale sans y parvenir toujours : Mondonville, Blanchard, Philidor, Gossec.
Avant d'aborder cette période mouvementée, nous nous devons de conclure cette brève introduction par quelques considérations d'ordre général. La prière chantée à l'église continue d'apparaître sous trois aspects : chaut grégorien, polyphonie, musique concertante. Sans doute cette dernière l'emporte-t-elle sur les deux autres en certains sanctuaires. Déformé par la barre de mesure et la sensible, le chant grégorien, accompagné ou non par le serpent, l'orgue (?), a perdu sa pureté originelle, mais il subsiste. La polyphonie continue d'avoir des adeptes. Les principales maîtrises — ces institutions conservent au même titre que nos modernes conservatoires — permettent à quelques oeuvres de la Renaissance de se survivre, interprètent toujours les pages a cappella de Formé, Moulinié, celles d'un Campra, d'un Mignon. Il est évident pourtant que l'influence exercée par la Chapelle royale, foyer de musique concertante, ne fera que grandir. Aux côtés de l'orgue, les instruments, un à un, font leur entrée au temple : violon, clavecin, flûte, hautbois, trompette et timbales au temps de Lully ; cet appareil instrumental émigre insensiblement de Versailles à Paris, de Paris en province. Musique concertante pourtant ne veut pas dire toujours musique à grand chœur, soliste et grand orchestre ; musique concertante englobe aussi bien le motet pour voix seule et basse continue, dont les premiers recueils (Henry Du Mont ?) remontent à 1652, motets pour 2 voix et basse, pour 3 voix de femmes et basse, pour grand chœur à 5 voix, petit chœur à 4 ou 5 voix. Finalement tout l'arsenal vocal se groupera peu à peu autour du monde instrumental. Mais ce n'est pas parce que cet ensemble trouve à s'acclimater à la Chapelle royale vers 1664 que l'historien se doit de fixer à cette date l'apparition du motet versaillais ; les origines de cette musique vocale sur basse continue, si proche de l'air de Cour d'une part, des grands doubles chœurs d'un Formé, d'un Bouzignac d'autre part, se voilent encore ci trop de mystères ! La prudence s'impose donc à qui voudrait démêler cette histoire complexe... et généraliser. Il va sans dire en outre que Paris et province ne suivront Versailles que tardivement. En veut-on des exemples ? Les instruments de musique ne pénètrent à Notre-Dame qu'au début du xviII e siècle avec Campra, et quatre-vingts ans plus tard les voûtes de Reims résonnent toujours des grands doubles choeurs a cappella de Hardouin !
Le récitatif le d a capo, la symphonie n'ont pas été partout adoptés, d'autant plus que certains de ces éléments, aux yeux des délicats, apparaissent encore entachés d'«impuretés» ultramontaines : l'Italie commence de soulever passions, discussions, querelles, libelles. Comme la musique instrumentale, la musique religieuse nous plonge au coeur du grand problème : France-Italie ; et nous aurons à dire très succinctement comment certains l'ont résolu, les uns partisans convaincus d'un style français, voire gallican, caractérisé par de grands chœurs verticaux et syllabiques, des mélodies fragmentées en menus épisodes harmonisées fort simplement et aboutissant à d'expressives cadences (Lully) ; les autres essentiellement attirés par le récit passionné et humain, par la polyphonie colorée d'altérations, la symphonie aux lignes intriguées (Charpentier) ; les troisièmes travaillant à concilier les goûts (Delalande, Couperin, Campra).
I
A la mort de Mazarin (1661), le jeune Louis xiv prend le pouvoir. Les trente années qui suivent, en dépit des guerres que le monarque doit entreprendre, donnent naissance à un État moderne, absolutiste, centralisé et confié par Louis xiv aux mains expertes de grands bourgeois qui remplacent la «maison» du cardinal italien. En tous les domaines — à l'exception d'un seul : le social — la France, profitant de l'élan qu'un Richelieu puis un Mazarin ont su lui assurer, développe ses richesses : hégémonie politique, économique ; hégémonie de l'esprit; culte du grand, du beau ; amour de la raison. Autour du Roi-Soleil, partout de puissantes personnalités travaillent à l'établissement d'une doctrine à laquelle la musique, pas plus que la peinture, ne saurait échapper. En quelques années, Euterpe va trouver sa voie fondation de l'Académie de danse (1661), publication du Cérémonial des évêques (1662) par François de Harlaye, archevêque de Paris, organisation de la Chapelle royale avec la nomination de ses quatre sous-maîtres (1663, Du Mont, Expilly, Robert, Gobert), fondation de l'Académie de Musique (1669), nomination des quatre organistes de la Chapelle royale (1678, Nivers, Lebègue, Thomelin, Buterne). On le voit, dès 1663, les hommes sont en place, les institutions en marche. Toutes les initiatives prises dans les dix dernières années vont être «canalisées», les lois des nouveaux genres «fixées». Le grand motet dit versaillais est issu de cet effort et symbolise ce mouvement à la Chapelle royale.
On le doit à deux générations d'hommes, les uns organistes (Du Mont, Delalande), les autres violonistes (Lully). Les uns sont des étrangers qui adaptent leur tradition, leurs goûts personnels au goût français (Du Mont, Lully), les autres sont des Italiens qui n'abandonnent que peu de syllabes de leur langue maternelle (Lorenzani, Danielis) ; le troisième groupe a pour représentant un Français qui, après trois ans d'étude à Rome auprès de Carissimi, tente d'incorporer en son discours les signes caractéristiques de l'idiome italien : M. A. Charpentier.
Né à Liège, Henri de Thier, dit Du Mont, devient en 1640 organiste de Saint-Paul de Paris. Organiste de la reine, sous-maître de la Chapelle du roy (1663), compositeur de cette institution (1672), il publie en 1652 ses Cantica Sacra à 2, 3 ou 4 voix et basse, en 1657 ses motets récitatifs, gonflés de lyrisme (Dialogue de anima). Ses vingt grands motets, écrits pour la Chapelle entre 1678 et 1684, ne seront édités qu'après sa mort : psaumes ou hymnes qui groupent, autour du quintette des cordes, des solistes utilisés séparément ou en «petit choeur», des doubles choeurs qui ouvrent ou concluent cette musique concertante, parfois verticale, souvent horizontale, vigoureuse et destinée, en dehors de la liturgie, à «meubler» et commenter l'office auquel assiste la Cour. Composé de courts versets juxtaposés, portant à la méditation et mêlant aux accents dramatiques des prières tout humaines, un nouveau genre est né en France que cultivent au même instant en Italie un Carissimi, dans les Flandres un P. A. Fiocco, à Notre-Dame de Paris où il est nommé en 1653 un Pierre Robert. Ce musicien (...-1699) dont la carrière se développe symétriquement à celles de Du Mont et de Lully, se fait au même instant le spécialiste du motet pour voix seule et basse continue, puis du grand motet à deux choeurs et accompagnement instrumental (il en donne vingt-quatre en 1684), enfin de « motets et élévations » qu'il destine à la Chapelle royale où il a été nommé sous-maître, on l'a dit, en 1663, puis compositeur en 1672.
Du Mont était né en 1610. Robert en 1618. Lully appartient à une autre génération (Florence, 1632). Quelle place exacte — aux côtés de Du Mont, de Robert, voire de Charpentier dont il sera parlé plus loin — a-t-il tenue dans la création de la musique religieuse concertante ? Lui qui semble oublier sa tradition ultramontaine lorsqu'il est appelé à collaborer aux ballets de Cour ou à créer la tragédie lyrique française, aurait-il accepté d'introduire au sanctuaire les éléments symphoniques de la musique italienne d'un Viadana, d'un Cavalli, d'un Carissimi ? Il est de fait que ses premiers motets, d'une si noble expression (cf. le Miserere de 1664 dont le programme tonal est garant d'une variété de couleur que ne connaîtront plus les oeuvres religieuses à venir) sont encore empreints d'un lyrisme tout ultramontain. C'est pour la Chapelle royale qu'il compose, de 1660 à sa mort (1687), onze grands motets pour deux choeurs, basse continue et symphonie (Te Deum, 1677, De Profundis, Quare fremuerunt) et douze petits motets à 2 ou 3 voix et basse continue : mais le verticalisme des choeurs l'emporte peu à peu sur la polyphonie italienne ; les masses vocales ou instrumentales (Plaude laetare, Dies irae) s'imposent à l'esprit du surintendant qui est assez habile pour les imposer à l'admiration du roi... et à la Chapelle royale, dont. il n'a jamais été sous-maître, ni compositeur. La dictature musicale qu'exerce Lully sert autant sa musique religieuse que sa musique profane ; et c'est sans doute pour avoir forcé la main des sous-maîtres de la Chapelle qu'une querelle surgit — qui s'étendra sur plus d'un siècle — entre les surintendants de la Chambre et les sous-maîtres de la Chapelle.
Mais, bien auparavant, la querelle, si l'on ose dire, a éclaté d'un autre côté. Ayant foi en son- étoile, Lully se fait le porte-parole du style français pour lequel il a opté, au point d'engager, fort de toutes les armes dont il dispose, la lutte avec les tenants d'un italianisme qui couve encore, même après la mort de Mazarin, et même si, officiellement, Louis xiv a chassé de son théàtre et de sa chapelle les artistes d'outre-monts. Ceux-ci ont trouvé des répondants auprès de Français passionnés de monodie accompagnée et de madrigalismes, comme le chanoine Ouvrard, maître de musique de la Sainte-Chapelle, l'abbé Nicaise de Dijon, Claude Oudot, maître de musique de l'Académie française et des jésuites, l'abbé Mathieu, curé de Saint-André-des-Arts. Ce dernier fait entendre en son église des oeuvres italiennes ou directement inspirées de Rome, de Venise, aux fervents qui se recrutent nombreux aux bords de la Seine. Cette «chapelle» d'italianisants — qui suscite passions et discussions — doit trouver un surcroît de vie le jour — c'est en 1678 — où un jeune Romain de trente-huit ans, Paolo Lorenzani, nommé maître de musique de la reine, parvient à faire exécuter devant la Cour des pages nombreuses de musique ultramontaine ; durant dix années, son dynamisme aux Théatins de Paris plaidera la cause d'un langage imagé qu'un autre Italien, le Piémontais Danielis, défendra dès 1690 en dirigeant en nombre d'églises parisiennes ses motets à une ou plusieurs voix, basse continue, avec soutien instrumental.
1690. La victoire semble assurée aux conjurés. Depuis trois ans, Lully est mort. Et voici qu'à l'horizon se confirme, en marge de l'art officiel, l'étoile du plus italianisant des Français, un Parisien que Lully a réussi à tenir à l'écart, ce Marc-Antoine Charpentier qui a travaillé trois ans auprès du Romain Carissimi.
Né en 1634, il est de la génération de Lully, de Lorenzani. Au service officiel ou officieux de Mademoiselle de Guise, des jésuites et de la Chapelle du Grand Dauphin, il entrera à la Sainte-Chapelle fort tard (1698), célibataire qu'il est, et après qu'un accident de santé l'eut empêché de se présenter au concours d'un des quartiers de la musique de la Chapelle du roi (1683). Ses motets concertants, ses Histoires sacrées, — ses cantates, ses psaumes, ses hymnes qui, vingt ans avant Couperin, réalisent la fusion des «goûts italiens et français», semblent délivrer la musique française de la chape de plomb que Lully, à la fin de sa vie, lui avait peut-être imposée. L'un des premiers, il écrit de grandes Messes avec chœur, solistes et accompagnement instrumental ; ses Te Deum (l'un date vraisemblablement de 1678) mêlent aux accents héroïques les versets les plus émouvants; ses Leçons de ténèbres évoquent la monodie accompagnée des latins et le récitatif de Monteverdi. Ses motets s'enrichissent de raffinements mélodiques, de souples polyphonies ou de grands choeurs fugués qui leur ouvrent les portes de la Chapelle du Roy, tout en annonçant les plus triomphales envolées de Haendel. Recueillie par son neveu après sa mort (1704), son oeuvre immense, dont la chronologie est encore très douteuse (elle s'étale sans doute sur cinquante années), forme vingt-huit volumes de Mélanges aujourd'hui conservés à la Bibliothèque Nationale.
De tout ce qui vient d'être dit, il appert que la musique religieuse concertante, dont les origines demeurent obscures entre 1640 et 1655, prend soudain son essor — Du Mont, Robert, Lully, Lorenzani, Charpentier, Danielis aidant — entre 1678 et 1690, soit à l'heure même où Louis xiv, définitivement installé à Versailles, décide avec Mansart d'élever près du château une immense chapelle destinée à devenir le symbole et le foyer d'un art officiel, dont la doctrine — architecture, sculpture, peinture, décor autant que musique — tire ses sources de France ainsi que d'Italie1
1
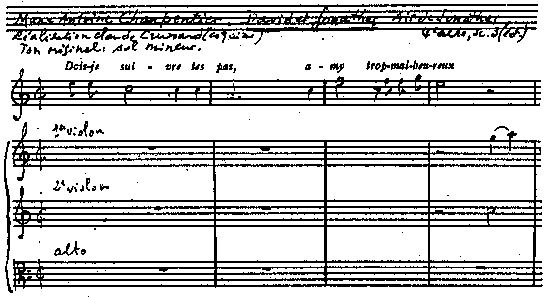 Le récit coupé et déclamé de Jonathas, extrait du David et Jonathas de M.-A. Charpentier.
Le récit coupé et déclamé de Jonathas, extrait du David et Jonathas de M.-A. Charpentier.
2
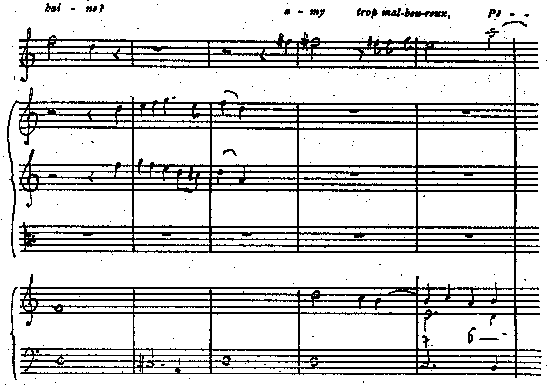 Un fragment de l'émouvante et quintuple polyphonie du dernier verset du De profundis de M.-R. Delalande (Rouart, édit.).
Un fragment de l'émouvante et quintuple polyphonie du dernier verset du De profundis de M.-R. Delalande (Rouart, édit.).
3
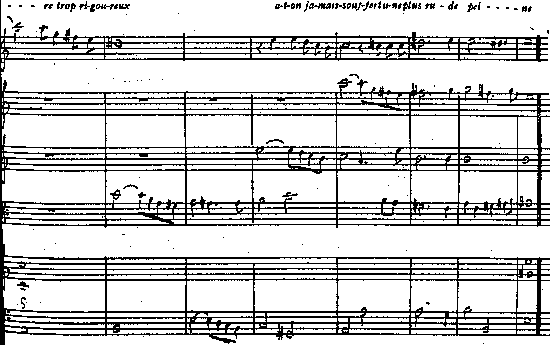 ; Une vocalise de la Troisième leçon de Ténèbres de F. Couperin.
; Une vocalise de la Troisième leçon de Ténèbres de F. Couperin.
II
À ces deux générations de pionniers et de défricheurs doit succéder celle des classiques qui récoltent les eaux de ces différentes sources, qui fixent les grandes règles et imposent la fusion des goûts, puisque Charpentier les y invite : ils assurent l'apogée du grand motet versaillais (1690-1730). Voici d'une part ceux qui assument de porter le flambeau à la Chapelle du Roi, d'autre part ceux qui travaillent en marge de l'institution officielle.
Toute la période est dominée par la puissante, personnalité de Michel Richard Delalande : son oeuvre chevauche, pendant vingt ans, celle de Charpentier (1684-1704) dont il apparaît comme le plus parfait disciple spirituel, même si l'histoire n'a pas encore éclairé les relations que ces deux artistes ont pu entretenir. Musicien qui a joui d'une autorité morale et artistique plus grande même que celle dont Lully se pouvait prévaloir, mais qui ne paraît pas en avoir usé avec autant d'inflexibilité, Delalande, que Chaperon, maître de chapelle de Saint-Germain-l'Auxerrois, commence jeune d'initier à la musique, est organiste de métier, titulaire. de quatre instruments parisiens au moment (1683) où il entre à la Chapelle royale comme sousmaître. De cette charge, il cumule successivement tous les quartiers ; il y ajoute celle du surintendant de la musique de la Chambre, celle de compositeur de la Chapelle (?), de maître et compositeur de la Chambre. On le voit Chambre et Chapelle, Delalande était « souverain » en tous lieux et, partout avec l'investiture, les encouragements et la solide amitié du prince. De 1683 à 1705, il écrit la majeure partie de son oeuvre vocale religieuse : soit, d'une part, quarante grands motets dont l'édition, sur l'ordre de Louis XV, doit être assurée par Colin de Blamont dès 1729, d'autre part, trente-deux autres motets dont certains sont encore inconnus. Monumental édifice qui répond à celui que Charpentier vient d'ériger, qui le complète, sans toutefois le dépasser en qualité. Édifice destiné à commenter et illustrer la messe à laquelle assiste le roi et dont le programme groupe un motet assez court assurant le début du culte jusqu'à la lecture de l.' Évangile, un autre plus long et fastueux conduisant les fidèles à la Consécration. A la suite de l'Élévation, un bref motet pour voix seule et basse continue — Ecce Panis, O Mysterium ineffabile — est confié à, Mlle de La Barre ou à Mlle Couperin, ou à Mlle Anne Rebel (celle qui deviendra la femme de Delalande) ou plus tard à Mlle Delalande, l'une de ses deux filles. En dernier lieu résonne enfin un Domine fac salvum regem qui en appelle à toutes les forces de l'appareil vocal ou instrumental. Ce qui paraît frappant en l'osuvre de Delalande, c'est le désir d'aplanir les controverses qu'a suscitées naguère en France la musique italienne. Pas plus que Charpentier, Delalande n'oublie en ses grands motets (Beati omnes, De Profundis, Beatus vit, Quare f remuerunt, Confitebor, Miserere) les architectures de Lully ou ses récits dramatiques, mais il humanise l'exemple qu'il tient en permanente estimé, il assouplit les contours de la mélodie en des airs d'une remarquable contexture ; il poétise l'enveloppe harmonique qui la doit mettre en valeur ; dans la force ou la tendresse, il ne néglige aucun des arguments qui parlent à l'âme. Nourri des psaumes, il les commente à sa manière pour le roi, sans sacrifier pour autant les thèmes grégoriens qui fécondent maintes de ses compositions (Regina coeli, Sacris .solemniis). Il met un sceau au grand motet versaillais et parachève l'ouvrage dont un Du Mont, un Robert, un Lully ont jeté les fondations. Rien ne nous autorise à penser qu'il ait écrit des Messes concertantes ou des Messes a capella. Pour un grand siècle, le motet versaillais, le motet de Delalande en particulier, supplantant toute musique religieuse au sanctuaire comme au Concert spirituel, déploiera ses ailes sur toutes les maîtrises de France.
Se sentant vieillir et abandonnant certaines de ses charges sous la Régence, Delalande aura la joie de trouver des continuateurs chez ses collègues et disciples. En 1723-1724, Bernier et Campra entrent à la Chapelle royale. Mantais, disciple à Venise de Caldara, chef de choeur et chantre, Bernier a dirigé la maîtrise de Saint-Germain-l'Auxerrois avant d'entrer à la Sainte-Chapelle (1704) comme successeur de Charpentier. Ses motets à 2 et 3 voix, ses cantates, ses psaumes (Miserere), son Confitebor tibi pour ,solistes et grands choeurs avec symphonie témoignent de la virtuosité de sa plume, de la chaleur de sa foi et de la puissance de son esprit. Après une carrière qui l'a mené de Provence à Paris, l'abbé Campra dirige la maîtrise de Notre-Dame de Paris jusqu'en 1702. Son ascension à la Chapelle de Versailles marque le couronnement de sa carrière de musicien religieux, de dramaturge aussi. Grands motets concertants ou motets pour voix seule et basse continue, Messes ou motets polyphoniques, Campra excelle en tous les domaines et continue la tradition de Charpentier et Delalande. Il est permis, en son jardin, de cueillir toutes les fleurs de l'italianisme, d'admirer aussi toutes les couleurs du grand arc-en-ciel français (deux livres de Psaumes à grands choeurs ; cinq de motets).
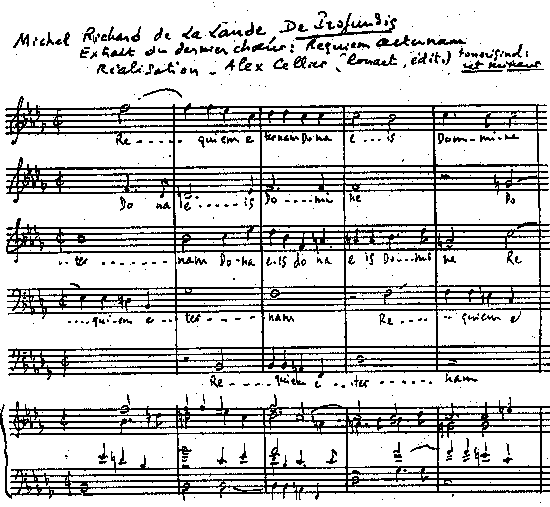
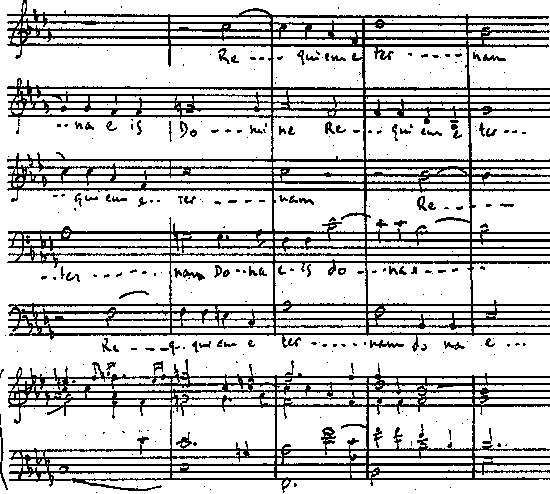
Comme lui, et plus que lui peut-être, Couperin travaille, ainsi qu'il en avertit l'auditeur en l'une de ses préfaces, à réunir les goûts. Distingué très jeune par le roi et nommé avec son appui organiste de la Chapelle en 1693, claveciniste des Enfants de France, il ne se prive pas, en marge de sa musique de clavier, d'écrire de la musique vocale. C'est entre 1703 et 1705 que ses motets pour solistes ou pour 2 et 3 voix et basse continue ont été composés à l'intention de la Chapelle (Laudate Dominum, Adolescentulus sum). D'autres pages, soutenues par les flûtes, les violons, sont destinées à des couvents de femmes (Motet de sainte Suzanne). Couperin sait faire prier avec d'ineffables accents en ses Élévations (O Mysterium ineffabile, Venite exultemus Domino). Ses Leçons de ténèbres pour une ou deux voix et basse continue ont pris pour modèle celles de Charpentier : elles exploitent avec générosité le récitatif passionné des Italiens, et leurs sereines vocalises sur les lettres de l'alphabet hébraïque évoquent avec mystère et à propos les lamentations de tout un peuple : ces pages sublimes et neuves, tout de grâce et de ferveur, s'inscrivent, aux côtés des grandes fresques ou des Leçons de Ténèbres de Delalande, parmi les chefs-d'oeuvre de la musique religieuse française.
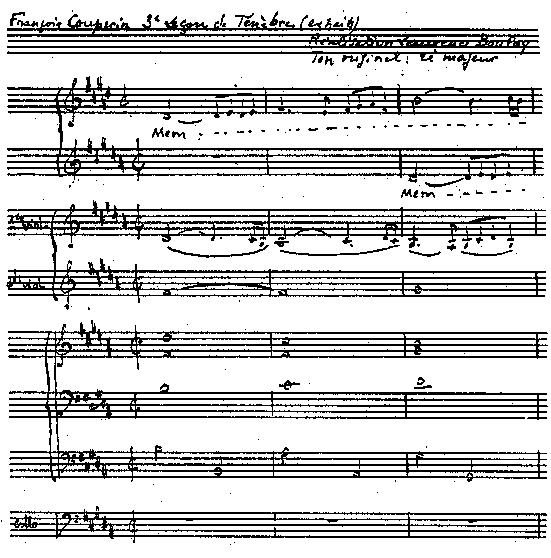
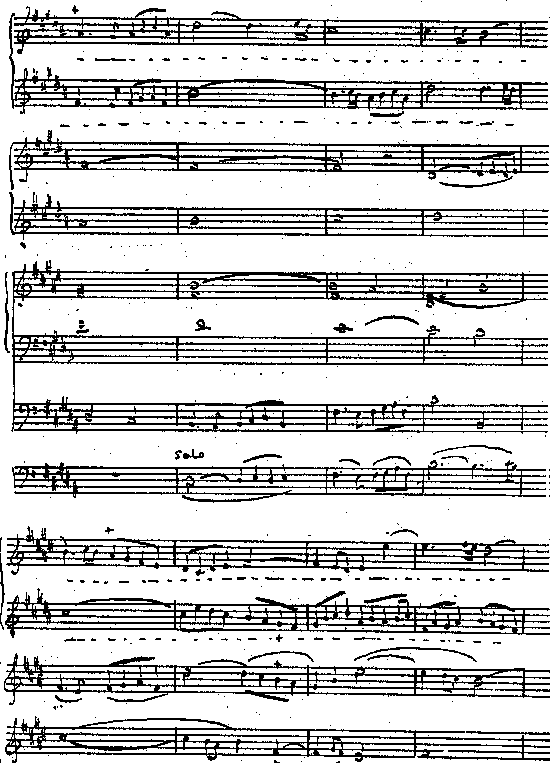
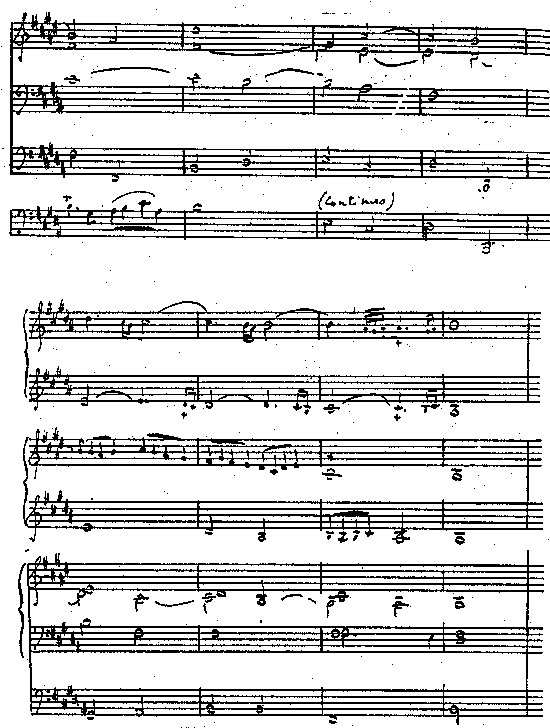
Mais si Versailles donne le ton, Versailles ne résume point l'effort de toutes les maîtrises de France. En marge de l'art officiel, voici les petits maîtres, tenants d'une tradition mi-polyphonique encore, mi-concertante. On aperçoit d'une part les Parisiens, de l'autre ceux qui maintiennent un certain éclat aux cérémonies de la province, ou bien encore qui commencent une carrière dans leur pays natal pour la finir aux bords de la Seine. Ils viennent d'aillèurs de tous les horizons artistiques : les uns élèves de Lully, les autres ayant appris le métier auprès d'un organiste ou d'un compositeur en renom. Élèves de Lully, Pascal Collasse, sous-maître à la Chapelle du Roy (1683), Lallouette, maître de choeur à Saint-Germain-l'Auxerrois, puis à Notre-Dame, écrivent des motets pour la Chapelle du Roy en lesquels l'italianisme fait son apparition (Miserere). On doit au second une Messe Veritas, a cappella, au premier quatre Cantiques spirituels sur les vers. de Racine poèmes qui ont également tenté un Louis Marchand, organiste de la Chapelle royale sous Louis.xiv, auteur d'un livre de motets (1700), un jean-Baptiste Moreau, cet Angevin transplanté à Langres puis à Dijon, qui terminera sa carrière à Saint-Cyr (Messe de Requiem). A Paris, il faudrait encore citer les motets de Clérambault et ceux d' H . Desmarets, le successeur de, Charpentier à la Sainte-Chapelle (1704), ce curieux musicien qui ne dédaignait pas d'écrire pour Goupillet les motets que ce sous-maître de peu de talent sans doute dirigeait sous son propre nom à la Chapelle du Roy.
Desmarets d'ailleurs nous conduit en province (en Lorraine) après un séjour à la Cour d'Espagne. Ici brillent notamment les chefs de choeur du Midi, ceux qui dirigent à Aix, Avignon, Montpellier, Narbonne, Toulouse et qui assurent une certaine continuité musicale à un mouvement — dont l'histoire est encore à reconstituer — et que domine la personnalité originale de l'abbé Campra [note de bas de page : On doit également à Mouret des grands et petits motets.] De Tarascon, jean Gilles, élève de Guillaume Poitevin, passe à Agde, puis à Saint-Étienne de Toulouse, cathédrale métropolitaine dont les voûtes résonnent parfois des sept grands motets avec symphonie qu'il a écrits, ainsi que de la Messe de Requiem dont la célébrité lui vaudra d'être exécutée encore en 1764 aux funérailles de Rameau. Maître de chapelle à Strasbourg, puis (1700) à la cathédrale de Meaux, Sébastien de Brossard révèle aux Alsaciens, comme aux Meldois, le nouveau style concertant par ses deux livres d' Élévations et de Motets (1696-1698), ses Lamentations de Jérémie, ses Leçons de ténèbres. Son Canticum Eucharisticum (1697) pour soli, choeurs et orchestre célèbre la réunion officielle de l'Alsace à la France.
Et voici que subitement, après la disparition de Delalande (1726), Lalouette (1728), Couperin (1733), la forme du grand motet, loin de s'enrichir d'éléments nouveaux, se stabilise en un genre qui s'assure hors de l'église la faveur d'un auditoire de plus en plus nombreux et qui va marquer de son empreinte la création de la première organisation de concerts qui ait fonctionné à Paris : le Concert spirituel.
III
Sur l'initiative d'Anne Danican Philidor, le Concert spirituel fonctionne à la Salle des Suisses du château des Tuileries depuis 1725 [note de bas de page : Dirigé tour à tour par Mouret, l'Académie royale de Musique, Mondonville, Royer, Dauvergne, Gaviniès et Gossec.] Jusqu'en 1791, il organisera, le jour des fêtes religieuses, deux séries de manifestations musicales qui assurent au grand motet une place de choix et qui ne cesseront de stimuler l'ardeur, en ce genre, des continuateurs de Delalande. Les pages de ce dernier— celles aussi de Lully — conservent, pour un demi-siècle, tout leur éclat, et c'est l'ancien sous-maître de la Chapelle royale qui assure le fond du répertoire. C'est lui qui est pris pour modèle par tous ceux qui souhaitent se créer un nom ou qui cherchent le succès. Le motet ne répond plus au libre commentaire d'un psaume. Il adopte, en présence d'un poème, une attitude définitive ; au texte, il adapte toujours même cadre musical ouverture symphonique ou ritournelle, grand choeur, récits, duos, airs accompagnés, grand choeur ; de semblables formules rythmiques, de mêmes figures verticales dans les grands choeurs, d'égales tournures vocalisées dans les airs, on obéit ici et là à une norme qui plaît. Mais il est rare que le texte soit commenté dans un esprit religieux. Manifestement l'esprit change : et derrière l'esprit, la. foi.
1730-1790. Durant ces soixante années de vie musicale religieuse, que de noms connus en France, mais aussi que d'inconnus ! Les uns et les autres ont illustré un temps, une histoire qui s'enveloppe de mystère encore. Pour tenter de l'éclaircir ou d'y mettre un peu d'ordre, nous la subdiviserons en deux parties : la musique religieuse hors du culte, c'est-à-dire au Concert spirituel ; la musique religieuse à l'église : la Chapelle du Roy, Paris, la province.
Entre 1730 et 1789, les programmes du Concert spirituel révèlent une soixantaine d'oeuvres dont aucune ne survit aujourd'hui. Autant de noms vite oubliés dont seuls émergent ceux de quelques artistes comme Rameau, Mondonville, Boismortier, Philidor, Gossec, qui brillent ailleurs. Mais qui s'aviserait de nos jours de ressusciter les grands motets de Philippe Courbois (Quare f remuerunt), Gervais, musicien du Régent, Fr. Pétouille (Confitebor), Guignard, Colin de Blamont (Te Deum), Gomay, l'abbé Gaveau, Madin (Diligam te), L. Lemaire, Chéron, Cordelet, Levasseur, Bethizy (Laudate), Davesne, Lefebvre, Berton, l'abbé Dugué, Desormery, Bonnet ? Rameau, par deux exemples célèbres (In convertendo, Laboravi), s'efforce, au début de sa carrière, à prolonger le genre : la fermeté de son contrepoint permet d'évoquer Bach. Les douze grands motets de Mondonville (que d'airs traités à l'italienne, au milieu de choeurs lullystes !) montent aux nues. Dans cette histoire du motet à son déclin, Boismortier franchit une étape en «farcissant» sa musique concertante de noëls populaires (Fugit nox, 1741) ; Mondonville croit sauver la forme en la remplaçant par l'oratorio ou l'histoire sacrée que Charpentier, rentré de Rome, avait autrefois révélée aux Parisiens. Mais Mondonville n'a pas le souffle de Marc-Antoine (Les Israélites à la montagne d'Horeb, 1758, Les Fureurs de Saül, Les Titans). A la même époque, le Concert spirituel «naturalise» le grand motet : le français remplace le latin. Avec Gossec et Rigel (La Nativité, 1774; La Sortie d'Égypte), l'oratorio recherche l'effet et tombe dans la facilité. On souhaite parfois retenir le motet en sa chute. Philidor s'y essaie en 1755 (Lauda Jérusalem), mais Gossec commente le Dies irae avec une abondance et une éloquence qui vont au détriment de la qualité (1761). A l'ode profane (Philidor : Carmen seculare, 1779), l'oratorio cède la place. Le Samson de Mereaux, sur paroles de Voltaire, ne parvient pas à redresser la situation. Les Te Deum avec leurs versets descriptifs (Judex, Tuba mirum) annoncent déjà l'ode patriotique (Gossec). Lesueur tentera de revaloriser, en ses motets et oratorios, un genre déchu.
De toute cette musique... religieuse, la prière paraît exclue. Trouvet-elle refuge au sanctuaire ?
En dépit du mystère qui voile encore l'histoire de la Chapelle royale après la mort de Campra (1744), il apparaît qu'aucun sous-maître ne puisse ici défendre la qualité. Car voici d'une part des musiciens médiocres, un Madin, plus tard un Gauzargues, de l'autre d'honnêtes ou d'habiles artistes, un Mondonville encore, un Blanchard (son Te Deum entend célébrer Fontenoy). Mais ils ont donné toute leur mesure aux Tuileries et ne peuvent. ici que se répéter : le Magnificat du second, quoique un peu factice, sonne parfois avec éclat. En ses motets, comme, en ses oratorios, François Giroust ne peut que mêler les genres dans les dernières années du règne de Louis XV. Mais la Messe qu'il écrit pour le sacre de Louis xvi, avec ses choeurs de cuivre, fait entendre pour la première fois des accents héroïques ou émouvants qui annoncent le romantisme (Agnus Dei).
Durant ces soixante années, de même que Paris reflète Versailles, de même les grandes maîtrises de province reflètent la Chapelle royale. Musicien de l'Académie française, Dornel cueille quelques gerbes de louange avec ses grands motets au temps de Rameau ; le motet concertant se généralise même dans le vaisseau fort étroit de la Sainte-Chapelle (l'abbé de la Croix, Fanton) ; la maîtrise des Saints-Innocents, toujours confiée à un «batteur» expert, attire l'attention des mélomanes (Bordier) ; à Notre-Dame, Goulet dirige ses productions (Omnes gentes) ; aux Mathurins, de grandes manifestations musicales entendent chaque année célébrer sainte Cécile ; Lesueur, maître de chapelle de la cathédrale (1786), soulève des protestations en faisant précéder l'une de ses Messes d'une grande ouverture symphonique.
Si la tradition demeure, c'est en province peut-être qu'il la faut chercher. Mais l'histoire comparée des grandes maîtrises — à l'exclusion de. quelquesunes —nous apprend que les maîtres de chapelle n'aiment pas à s'attarder en de trop lointains séjours. De l'un à l'autre ils passent, avec l'espoir toujours d'atteindre Paris où... la gloire peut-être les attend. Madin dirige les maîtrises de Tours et de Rouen avant d'accéder à la Chapelle du Roy ; Blanchard celles de Marseille, Toulon, Besançon et Amiens; Duluc passe à Tours, Chartres, Rouen ; Belissen s'implante à Marseille ; l'abbé Toussaint à Dijon; Louis Buée dirige à Dijon, Tours, Coutances; Rey à Marseille et Nantes ; Giroust, avant d'arriver à Versailles, s'est distingué à Orléans. Les indications sont trop pauvres qui pourraient permettre de préciser quel fut le répertoire de chacune de ces «chapelles». Sans doute le grand motet de Delalande et de Lully trouve-t-il à s'acclimater souvent. Mais plus souvent encore — dénué de moyens instrumentaux — le chef doit-il se contenter de programme entier de musique a cappella : tel ce Hardouin, directeur de la maîtrise de Reims de 1748 à 1791, dont nous donnons ici un aperçu de l'oeuvre en témoignage du labeur incessant qu'exigeait d'un artiste conscient de sa responsabilité la conduite de la maîtrise de la métropole du sacre vingt et une Messes avec symphonies, vingt-quatre Messes a cappella, quatre-vingt-onze hymnes, quatre-vingt-cinq motets, des Te Deum, des Magnificat, toutes pages qui nous apprennent que si Hardouin est resté fidèle à la tradition de la polyphonie du xviIe siècle — tout en la simplifiant peut-être — il ne mésestime point les apports de son temps, fait appel aux ressources de l'orchestre, aux grâces du récit ou de l'air...
Au terme de ces remarques, le lecteur est en droit d'attendre quelques réflexions. La musique religieuse chantée dans les églises de France depuis l'avènement de Louis xiv jusqu'à la mort de Louis xvi a-t-elle satisfait les fidèles, a-t-elle favorisé en eux le recueillement ? Si la foi de nos ancêtres tend .à décliner. au cours du xviIIe siècle, la musique qu'ils ouïssent au lieu saint suit-elle la même courbe, ou bien est-elle susceptible de les stimuler encore ? N'est-ce point faire preuve d'étroitesse, voire de sectarisme, que de juger ces grandes compositions avec notre actuelle mentalité? Résurrection du grégorien, résurrection de la polyphonie : notre temps prêche les grands retours. Mais hors du grégorien, ou de Josquin, n'y 'a-t-il point de salut ?
Il n'y a pas, croyons-nous, à s'étonner que la musique religieuse du xviIIe siècle marque une régression sur la précédente quant à la qualité. Sans doute peut-on arguer' de la. frivolité du temps, de la déchristianisation du siècle. Mais ne faut-il pas aussitôt déplorer une technique inférieure et - dès la mort de Rameau et Leclair, ces deux derniers fleurons du xviIe siècle poussés en plein coeur du xviIIe siècle - une inspiration médiocre, des artistes de moindre valeur ? Décadence de la musique religieuse? Soit. Mais aussi décadence de la musique française, à l'instant même où le Concert se voudrait d'assurer la diffusion de la musique.
Paradoxe ou ironie ? N'est-ce point le concert (spirituel) qui aurait tué la musique religieuse? Du jour où les psaumes servent, hors du temple, à de grandes fresques mi-vocales mi-orchestrales, ne viennent-ils pas à se vider de leur contenu ? Et le public désormais, loin de suivre des paroles qu'il murmurait au temple hier encore du fond du coeur, ne se contente-t-il pas, à la Salle des Tuileries, de se laisser prendre au décor dont le musicien se flatte de les entourer ? Saintes écritures autrefois et textes liturgiques, aujourd'hui histoires pieuses et oratorios moralisants : d'un terrain on glisse avec tant d'aisance vers un autre I Plus n'est la peine de saisir le sens des paroles ; le latin se perd. Et du français mis en musique, seuls resteront en mémoire les textes qui frappent, les anecdotes.
De cette décadence, le grand motet n'est-il point le premier responsable ? Et n'est-ce point pour avoir abandonné les cinq oraisons. de l'Ordinaire de la messe que la musique religieuse a perdu sa raison d'être ? En ce cas ne faudrait-il pas citer, à la barre des premiers coupables, les Lully, les Du Mont, les Delalande eux-mêmes, qui ont préféré aux prières liturgiques du saint Sacrifice des prières para-liturgiques2
Appelés à se défendre ici, les maîtres du xviie siècle pourraient user d'armes redoutables. Le saint Sacrifice de la messe est un drame, tout comme le livret que Lully met en musique : ce drame se déroule au milieu de gestes et de prières que la musique peut ennoblir, exalter, commenter. Faut-il rejeter son époque ? Faut-il négliger, à l'Église, ces mille ressorts que la voix et l'instrument offrent au musicien de théâtre? Delalande, en paraphrasant des textes grégoriens, en écrivant des choeurs fugués ou des airs pour solistes, accompagnés, dans la force comme dans la douceur, de toutes les voix de l'orchestre, n'a-t-il pas réalisé, comme personne, une fusion de toutes les syntaxes, de tous les genres, de tous les idiomes, de tous les goûts, de toutes les formes de la prière : collective, individuelle ? Dommage peut-être, il est vrai, qu'il ne se soit pas appliqué à commenter la messe. Pour n'avoir point, auprès du prince, servi la tradition de la Messe polyphonique que Charpentier et Campra avaient pourtant magnifiée, pour avoir couvert le grand motet seul de son nom prestigieux, n'a-t-il pas engagé la musique religieuse sur une route sans issue? Pour avoir négligé l'essentiel, pour avoir sacrifié à un art d'apparat -.sans doute, entraîné par son temps, est-il excusable d'évoquer l'ambiance de la Chapelle-en laquelle il se doit de diriger ses oeuvres - n'a-t-il point contribué à faire dévier un art que seul parmi ses successeurs un grand artiste, doublé d'un grand chrétien, eût pu remettre en son droit chemin ?
L'Église de France — le destin l'a voulu — cherche encore cet indispensable musicien.
Norbert DUFOURCQ.
Notes
1. Nous insérons en ces pages trois exemples de musique religieuse concertante, écrites en marge des prières liturgiques de l'Ordinaire de la messe : 1) le récit coupé et déclamé de Jonathas, extrait du David et Jonathas de M.-A. Charpentier; 2) un fragment de l'émouvante et quintuple polyphonie du dernier verset du De profundis de M.-R. Delalande (Rouart, édit.); 3) une vocalise de la Troisième leçon de Ténèbres de F. Couperin : trois types d'écriture issus de la fusion des goûts italiens et français, des styles religieux et dramatiques.
2. Responsables aussi, certains couvents comme les Feuillants, les Théatins, les religieuses de Longchamp, qui ont donné au X VIIe siècle une large diffusion à la musique religieuse de concert, au détriment de la musique du culte...
3. Nous est-il permis de signaler que nous comptons publier prochainement, en souscription, dans les Documents et Catalogues de la Société Française de Musicologie, un volume intitulé Notes pour servir à une histoire de Michel-Richard Delalande, établies d'après les papiers d'André Tessier, suivies de documents inédits et du Catalogue thématique de l'oeuvre (1 300 thèmes), publiés par les élèves du Séminaire d'histoire du Conservatoire National de Musique (Marcelle Benoit, Marie Robert, Sylvie Spycket, Odile Vivier), sous la direction de Norbert Dufourcq ?




 À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISSN 2269-9910.

Samedi 4 Octobre, 2025

