Chanter toujours : Plain-chant et religion villageoisedans la France moderne (xvie-xixe siècle)
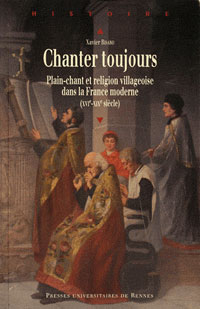 Bisaro Xavier, Chanter toujours : Plain-chant et religion villageoise dans la France moderne (XVIe-XIXe siècle). « Histoire », Presses Universitaires de Rennes, 2010 [247 p. ; ISBN 978-2-7535-1095-1 ; 18 €].
Bisaro Xavier, Chanter toujours : Plain-chant et religion villageoise dans la France moderne (XVIe-XIXe siècle). « Histoire », Presses Universitaires de Rennes, 2010 [247 p. ; ISBN 978-2-7535-1095-1 ; 18 €].
Ce livre s'adresse à celles et ceux qui ont de la curiosité pour la pratique du plain-chant — et l'organisation de cette pratique — sous l'Ancien Régime, la tourmente révolutionnaire et « la fin du monde » au xixe siècle. Tout cela est dans un titre pleinement justifié.
Les admirables travaux menés à Clermont-Ferrant autour de l'équipe de Bernard Dompier pourraient faire penser qu'on avait fait un bon tour du propriétaire, sinon de la question des maîtres de chapelle vaguants à la recherche de meilleures conditions de travail et de rémunération, et des enfants de chœur des maîtrises, techniciens des offices, logés, nourris, blanchis et enseignés, rémunérés pour leurs services pour constituer une cagnotte de sortie, dont il faut aussi assurer l'avenir d'après la mue, par des placements en apprentissages ou des bourses d'études.
C'est oublier qu'il y a aussi une église rurale qui ne peut se permettre un tel déboursement pour la dignité liturgique, mais aussi des fidèles, qui tout autant que ceux des églises prospères des villes, tiennent à de beaux offices.
Ce livre s'adresse donc aussi aux lecteurs intéressés par l'histoire de la vie rurale.
Xavier Bissaro nous raconte donc, à partir d'une abondante documentation essentiellement transversale (on n'écrit pas sur ce qui est évident dans le quotidien), comment les villages tentent d'attirer les chantres, par des avantages tels le logement, ou l'octroi d'activités commerciales, des maîtres d'école pouvant enseigner le plain-chant. Comment les villageois s'organisent eux-mêmes pour trouver de bonnes voix aptes chanter ce latin qu'on ne connaît que phonétiquement. Combien accéder au lutrin est gratifiant et source de jalousies et de querelles.
Tout cela porté par un long mouvement de laïcisation qui pourra aboutir a des offices sans prêtre, à des oppositions entre chantres et clergé, et en fin de compte au discrédit des chantres, dignitaires sans foi, célébrés pour leur aptitude à la paillardise.
Personnellement, je suis curieux de ce que furent les vieilles pierres, de comment c'est là et pourquoi. Les villages anciens et leurs monuments, les églises séculaires me font toujours méditer, non pas religieusement, mais historiquement. Sans aucun doute, ce livre fait parler les archives, mais aussi les vieilles pierres, et enrichit considérablement l'imagination, pour redonner vie en pensée à ces lieux aujourd'hui un peu endormis par le temps.
Ce livre est limpidement écrit, mais il est un livre de recherche référentiel, qui demande de l'attention. Parfait pour la plage l'été, où il y a tant d'ennui vague et de temps à écumer.





À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISSN 2269-9910.

Mercredi 21 Février, 2024

