Duo Tal & Groethuysen : Brahms, Concerto pour piano n° 1, 20 Ländler de Schubert
 Johannes Brahms, Arrangements pour piano à 4 mains : Concerto
pour piano n°1 en ré mineur opus 15 ; 20 Ländler D 366 / 814 de
Franz Schubert. Duo Yaara Tal & Andreas Groethuysen. Sony Classical 2011.
Johannes Brahms, Arrangements pour piano à 4 mains : Concerto
pour piano n°1 en ré mineur opus 15 ; 20 Ländler D 366 / 814 de
Franz Schubert. Duo Yaara Tal & Andreas Groethuysen. Sony Classical 2011.
Johannes Brahms, Concerto pour piano en ré mineur, opus 15 (1854-1859), adapté pour piano à 4 mains par le compositeur.
Enregistré dans les studios de la SWR à Stuttgart, les 22-24 octobre 2009.
Le concerto pour piano de Johannes Brahms a été joué en première audition publique à Hanovre le 30 mars 1858 dans une ambiance assez froide. Sa création le 22 janvier 1859 au Gewandhaus de Leipzig, avec Brahms en personne au piano et Joachim au pupitre, fut un désastre. Les choses ont bien changé. D'abord du temps même de Brahms, en partie grâce à Clara Schumann qui s'est employée à jouer et à populariser les œuvres du compositeur, mais aussi parce que le goût évolue. Aujourd'hui, les mélomanes ont les oreilles bien disposées aux somptueux thèmes de cette œuvre, se grisent volontiers aux déferlements du piano et à ses langueurs interminables...
plage 1-3. I. Maestoso, II. adagio, III. Rondo.
Primo
 Secondo
Secondo
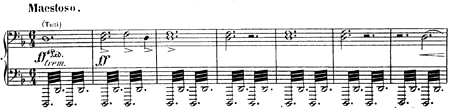
Le second mouvement, Adagio, s'annonce comme un choral recueilli dans lequel vont venir batailler les lueurs mélodiques d'un touchant thème au profond romantisme, cela réussit à éclaircir l'horizon sans toutefois le dégager. Le mouvement se pianissime dans un rappel des trémolos des premières mesures de l'œuvre. Mais là ils étaient triomphants, ils sont ici mourants.
Primo
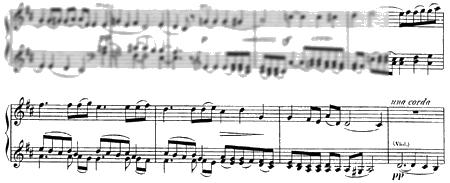
Et quelques mesures plus loin, à nouveau...
primo

Cascade chromatique pour la tension dramatique qui échoue dans l'infini du choral... Le développement chez Brahms est un chemin qui mène souvent à la résignation.

Mais là c'est majestueux...
primo
 secondo
secondo
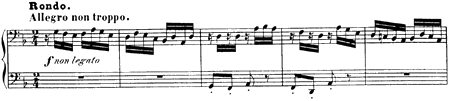
Je n'apprécie pas trop ce qui se donne comme musique de chambre quand elle est trop chambrée, enfin quand on sent les tentures lourdes, les pièces sombres, le xixe siècle, le confort qui se donne à lui-même en spectacle conformiste. Pas à cause des murs et des rideaux tirés, mais à cause du refuge factice, de l'autoconfinement, de la société avec laquelle on doit savoir vivre, artistes compris. Pour moi, l'art est un confinement, certes, mais qui exprime le monde, qui dit l'agitation de l'autre côté des murs et des fenêtres closes et abritées, mais qui fouille aussi les affects. C'est pourquoi le grand théâtre de Shakespeare, Racine, Molière, Goldoni, Gati, tout en étant enfermé dans la cage de scène me semble si moderne et respirable. Il en dit et en montre plus, au-delà des cloisons, pendrillons, cintres, décors, sur la vie en vrai, déclamation à l'ancienne comprise à l'occasion, que les gesticulations du théâtre de boulevard sensé coller à l'actualité réaliste de ce que nous sommes... Alors, le piano à quatre mains, grand symbole de la chose, et que c'est délicieux de se déchiffrer cette œuvre charmante entre deux bons mots et un doigt de liqueur, ne m'attire pas spontanément. Cela doit me sembler manquer de théâtralité.
 Yaara Tal
et Andreas Groethuysen. Photo Michael Leis.
Yaara Tal
et Andreas Groethuysen. Photo Michael Leis.
Pourtant le duo (à quatre mains ou à deux pianos) formé par Yaara Tal et Andreas Groethuysen, depuis Munich en Bavière où ils habitent, a une grande et belle renommée dans toute l'Allemagne (moins que l'Oktoberfest quand même), ce que l'on comprend à l'écoute de ce disque. Avec ça, une imposante discographie chez Sony, en exclusivité depuis plus de vingt ans. Y. Tal & A. Groethuysen ont un immense répertoire où tous les grands noms du piano classique et romantique son convoqués, mais encore bien entendu Jean-Sébastien Bach, des moins connus comme George Onslow ou Théodore Gouvy et dans une moindre mesure des œuvres plus contemporaines.
New York, Hong Kong ou Londres les ont entendus, Paris aussi, où ils se sont produits, invités par Radio France, le 15 janvier 2011 au 104, à l'occasion de la sortie de ce CD.
 15
janvier 2011, Paris, le 104. Andreas Groethuysen, Yaara Tal avec le Münchener Vokalquartett, formé par des solistes
du chœur de la radio de Bavière : Barbara Fleckenstein (soprano), Barbara Müller (alto), Bernhard Schneider (ténor),
Michael Mantaj (basse). Au programme les Ländler de Schubert / Brahms,
mais aussi les Liebeslieder-Walzer et Neue Liebeslieder-Walzer de Brahms, et 5 valses d'Ignaz Friedman.
15
janvier 2011, Paris, le 104. Andreas Groethuysen, Yaara Tal avec le Münchener Vokalquartett, formé par des solistes
du chœur de la radio de Bavière : Barbara Fleckenstein (soprano), Barbara Müller (alto), Bernhard Schneider (ténor),
Michael Mantaj (basse). Au programme les Ländler de Schubert / Brahms,
mais aussi les Liebeslieder-Walzer et Neue Liebeslieder-Walzer de Brahms, et 5 valses d'Ignaz Friedman.
Une œuvre comme le Concerto de Brahms, plus romantique tu meurs, à quatre mains, où s'ammoncellent les nuances, le rubatto, des notes retenues, et autres maniérismes du style, avec en prime des difficultés rythmiques sérieuses, met en avant l'admirable travail d'ensemble à deux têtes et quatre mains.
Certes, à une époque où la musique ne s'enregistrait pas mécaniquement, les réductions pour piano à deux ou quatre mains, permettaient de faire entendre et circuler les œuvres d'orchestre. Mais on aurait tort de penser, qu'il ne s'agit que de réduction, où d'un autre point de vue, d'un piano qui deviendrait symphonique. Il y a un grand intérêt musical et sonore purement pianistique, qui réside dans l'utilisation simultanée de toute la tessiture du piano, ce que ne peuvent faire deux mains aussi agiles seraient-elles.
Frantz Schubert a composé les 17 Ländler D 366 pour piano à deux mains entre 1816 et 1824, tout au moins les n° 4 et 17 sont-ils datés de juillet 1824 à Zelès en Hongrie. Cette même année il a composé les Ländler D. 814 pour piano à quatre mains, avec comme n° 1, une réécriture du dernier Ländler (le 17e) du D. 366. En 1869, Johannes Brahms a donc en quelque sorte, systématisé la démarche de Franz Schubert en recomposant pour piano à quatre mains les 16 numéros précédents.Ce sont des pièces courtes avec deux reprise, pensées comme une œuvre d'un tenant, un voyage ininterrompu a travers des paysages ou des impressions différentes. Ainsi selon les tonalités et le caractères, les morceaux sont enchaînés sans transition ou avec une respiration.
Le premier est le plus mignon...
... n'est-ce pas ?Voilà de quoi écouter d'une autre oreille, où il faudrait peut-être en avoir quatre.
04. Ländler (D. 366) n° 1, en la majeur ; 05. Ländler (D. 366) n° 2, en la majeur ; 06. Ländler (D. 366) n° 3, en la majeur ; 07. Ländler (D. 366) n° 4, en la mineur / la majeur ; 08. Ländler (D. 366) n° 5, en do majeur / la mineur ; 09. Ländler (D. 366) n° 6, en do majeur ; 10. Ländler (D. 366) n° 7, en sol majeur ; 11. Ländler (D. 366) n° 8, en ré majeur ; 12. Ländler (D. 366) n° 9, en si majeur ; 13. Ländler (D. 366) n° 10, en si mineur ; 14. Ländler (D. 366) n° 11, en si majeur ; 15. Ländler (D. 366) n° 12, mi bémol mineur ; 16. Ländler (D. 366) n° 13, ré bémol majeur / si bémol mineur ; 17. Ländler (D. 366) n° 14, re bémol majeur ; 18. Ländler (D. 366) n° 15, la bémol majeur / ré bémol majeur ; 19. Ländler (D. 366) n° 16, la bémol majeur ; 20. Ländler (D. 814) n° 1, mi bémol majeur (n° 17, D.366) ; 21. Ländler (D. 814) n° 2, la bémol majeur ; 22. Ländler (D. 814) n° 3, mi bémol majeur ; 23.Ländler (D. 814) n° 4, la bémol majeur
Jean-Marc Warszawski
8 février 2011




 À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISNN 2269-9910.


