Maîtrises et chapelles Aux XVIIe et XVIIIe siècle
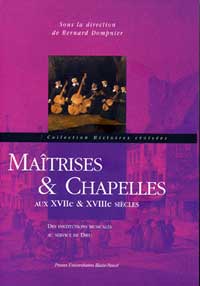 Maîtrises et chapelles Aux XVIIe et XVIIIe siècle : Des institutions musicales au service de Dieu (sous la direction de Bernard Dompnier).
Collection Histoires croisées Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2003.
Maîtrises et chapelles Aux XVIIe et XVIIIe siècle : Des institutions musicales au service de Dieu (sous la direction de Bernard Dompnier).
Collection Histoires croisées Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2003.
La récente découverte d'une importante collection de partitions (700 numéros) dans une annexe de la cathédrale du Puy-en-Velay a intéressé Bernard Dompnier, historien à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Il a entre autres organisé un colloque qui a été tenu du 25 au 27 octobre 2001 au Puy-en-Velay : Les maîtrises capitulaires aux XVIIe et XVIIIe siècles. Des institutions entre service d'église et stratégies sociales. Le présent livre rassemble les communications qui y ont été prononcées par :
Frédéric Billiet ; Christophe Cazade ; Florence Chappée ; Galliano Ciliberti ; Nathalie Da Silva ; Gilles Deregnaucourt ; Nicole Desgranges ; Bernard Dompnier ; Marie-Bernadette Dufourcet ; Jean Duron ; Georges Escoffier ; Thierry Favier ; Bernard Girard ; Stéphane Gomis ; Sylvie Granger ; Jean-Louis Jam ; Jean-Luc Le Cam ; Christophe Leduc ; Philippe Lescat ; Philippe Loupès ; Oscar Mazin ; Frédéric Meyer ; Maris-Claire Mussat ; Simona Negruzzo ; François Reynaud ; Joseph Scherpereel.
Les mots maîtrise ou psallette font aujourd'hui penser à des institutions qui sont à la fois école et ensemble de chant-choral. On les associe alors assez facilement aux fastes liturgiques qu'on connaît de l'ancien régime. Encouragé par la propagation du point de vue des créateurs de la Schola Cantorum au XIXe siècle, on croira sans peine que les maîtrises constituaient aussi et en quelque sorte les conservatoires de musique de l'ancien régime, dont la Révolution aurait fermé les portes en 1790-1792 ; d'autant que le passage par les maîtrises semble avoir été une constante dans les biographies des musiciens du passé, comme l'est aujourd'hui le passage par le Conservatoire. Mais c'est là une traduction littérale passé-présent peut-être trompeuse en partie.
L'ouvrage fait apparaître une institution ecclésiastique originale, fondamentale pour le culte, inhérente à l'organisation de l'église, mais aussi pratique : partout on forme, on entretient, on emploie des enfants de chœur placés sous la direction d'un maître : ils sont des professionnels de l'office, indispensables au spectacle liturgique. Le principe est général, les pratiques sont pragmatiques et diversifiées.
L'enfant de chœur ou petit vicaire est recruté vers l'âge de 7-8 ans par annonce publique, par le bouche-à-oreille, par connaissance, plutôt dans le milieu de l'artisanat. Entrer dans le monde ecclésiastique est certainement une opportunité. Le clergé est une puissance sociale, politique et économique.
Le nouveau petit vicaire rejoint une communauté copiée sur le régime claustral qui compte de deux à dix membres, douze exceptionnellement, nombre pair en raison de la répartition symétrique de part et d'autre de l'autel lors des offices. Il est hébergé, nourri, soigné, habillé avec attention et qualité. Le maître de musique, parfois secondé par un maître de grammaire, lui enseigne le nécessaire pour assurer les offices religieux : catéchisme, latin, chant, musique, voire à toucher un instrument, à composer. Il participe à tous les offices, aux processions, messes de fondation, inhumations, à toutes les manifestations liturgiques publiques. Il est rémunéré et on lui assure un débouché ou une formation supplémentaire quand il devient adulte après une dizaine d'années de service.
Telle est la perfection que peuvent parfois atteindre quelques maîtrises, particulièrement celles de grands et riches chapitres.
La maître des enfants (maître de chant, de choeur etc.) sous la responsabilité d'un chanoine, organise la vie, dirige l'enseignement et les prestations des enfants de chœur, il gère la maisonnée qu'il partage avec les enfants. Il peut être secondé par son épouse. Il compose, copie (et fait copier), achète les musiques. Il a en charge la direction musicale. Peu d'entre eux servent longtemps à un même poste, parce que les relations avec les chanoines sont souvent tatillonnes, qu'on cherche un meilleur emploi, une ville de moindre cherté, une église plus prestigieuse, des élèves privés ou du travail supplémentaire au cabaret ou aux concerts.
L'extrême vaguance des maîtres reste assez énigmatique dans la mesure où; elle est un phénomène massif et constant.
Les 26 études publiées dans ce livre forment un riche panorama contrasté. Panorama car la présence des enfants de chœur est à de rares exceptions partout manifeste. Contraste parce que les revenus financiers, les moyens consentis, les choix, les milieux sociaux, les besoins liturgiques sont inégaux d'un chapitre à l'autre.
L'intérêt du recueil ne repose pas sur une synthèse qu'on en pourrait faire. L'histoire réelle se manifeste par les spécificités que les historiens et musicologues réunis ont parfaitement mis à jour à partir d'un éventail documentaire issu des activités capitulaires comprenant en premier lieu des comptes, des contrats, mais aussi des délibérations, des mémoires, des échanges de lettres, des livres écrits par des aîtres de musique. De ce point de vue, le sous-intitulé du colloque : «Des institutions entre service d'église et stratégies sociales» nous semble bien plus judicieux que le sous-titre du livre qui en est issu : «Des institutions musicales au service de Dieu».
L'essentiel des études sont centrées sur l'exposition d'archives relatives à des chapitres, localisés : Clermont, Cambrai, Amiens, Maubeuge, Dol-de-Bretagne, Champaux, Saint-Pierre d'Angers, Saint-Quentin, Paris, Annecy, Cavaillon, Saint-Jean de Maurienne, Die. S'ils se recoupent à la transversale, les angles d'attaque, dans les limites - bien entendu, ce que peuvent délivrer les archives, sont différents.
Cinq grandes sections rythment l'ouvrage : le recrutement et vie des maîtrises ; les petites maîtrises ; les maîtrises urbaines ; les pratiques musicales et la liturgie ; des comparaisons avec d'autres pays. L'écriture soignée montre que la prose universitaire n'est pas nécessairement sèche et revêche, et malgré quelques redondances d'une communication à l'autre pour honorer en quelque sorte la loi du genre, la lecture est d'autant plus agréable qu'elle est instructive.
On établit ici le quotidien d'une maîtrise, ou ses évolutions dans le temps, là on s'attache aux activités du maître, à l'image qu'il laisse à la littérature, aux dictionnaires et aux dictons, ou à la condition des enfants ; ici aux conflits et violences qui peuvent se produire dans une maîtrise, mais aussi entre le maître et les chanoines. On s'intéresse au recrutement des enfant à Paris ou à la spécificité des communautés de prêtres associés et des chapitres des «Dames nobles». On met en avant les relations avec le politique où; on révèle comment des airs à la mode de vaudevilles font scandale à l'office. On évoque évidemment le maître de musique Annibal Gantez et son livre autobiographique L'Entretien des musiciens paru en 1643 qui constitue une source inestimable, y compris pour son langage assez cru. On tente des tableaux de recensement statistique sur les maîtres de musique.
On comprend que les archives sont plus bavardes sur les questions d'organisation que sur le quotidien artistique et pédagogique : on tient des comptes, on rémunère, on reçoit des plaintes, et on règle les conflits, on signe des contrats. On en garde des rapports et des traces écrites.
Pour se faire une représentation de ces sujets moins documentés (chroniqués), on étudie alors les livres de cérémonial, tant mieux si plusieurs projets sont en concurrence, cela fait parler l'histoire et dit en contrepoint les pratiques réelles ; on inventorie les fonds de partitions conservées, on y porte analyse, on cherche les témoignages laissés au livre ou à l'échange épistolaire. On peut être assez intrigué par le fait qu'on trouve peu de littérature musicale spécifique aux voix d'enfants. Il faut aussi noter en passant qu'une grande maîtrise de 10 à 12 enfants emploie 1 anfant par âge entre 7/8 ans et 17 ans.
Le livre est conclut par une visite aux pratiques hors de nos frontières : Italie, Espagne, Portugal, Allemagne. Les études de cette dernière partie sont moins précisément localisées, moins circonstanciées et ont tendance à considérer les maîtrises bien au-delà de la communauté des enfants de chœur et du maître de musique, avec la volonté au résultat parfois impressionnant de traiter du sujet au complet, sur d'assez vastes étendues tant chronologiques et géographiques que problématiques.
A plusieurs reprises, les auteurs insistent sur le caractère, voire le statut professionnel des maîtrises, lesquelles au fond seraient le corps technique du spectacle liturgique, secondant les officiants et palliant à leurs défaillances.
Ce faisant, on suppose des lacunes dans la formation des prêtres ou l'impossibilité de trouver des qualifications dans un corps social pourtant extrêmement nombreux. Pourquoi combler les déficits par l'adjonction d'un service d'enfants de chœur, plutôt que de promouvoir des formations spécialisées de prêtres comme on le fait dans les séminaires italiens ?
Il est difficile d'admettre qu'on dépense tant sur la longue durée et des vastes aires géographique pour s'assurer du seul appoint technique d'enfants. On peut y ajouter leur voix d'ange, mais il faut d'abord qu'on ait décidé que les anges ont une voix et que celle-ci est une voix d'enfant. On peut supposer que l'image de l'enfant de chœur a pour les religieux de profondes racines symboliques. Peut-être est-ce par ailleurs pour les prêtres, interdits de procréation en raison du célibat et de l'abstinence sexuelle, une manière de participer à la reproduction de la civilisation, d'être pères au sens complet du mot. Il y a peut-être des raisons plus terre à terre, comme celle de justifier de la bonne utilisation des impôts perçus, de remplir une mission de d'éducation.
L'incessant chassé-croisé des maîtres de chant, qui sont des professionnels et non pas des prêtres, finit par donner l'impression que le clergé tient à externaliser les maîtrises, qui tout en ayant la décence religieuse ne sont pas pleinement intégrées à l'église.
Quelle sont les conséquences, (y en a t-il ?) de la déchristianisation, repérée, particulièrement par l'historien des mentalités Michel Vovelle, surtout au Sud de la France. Celle-ci est repérable par la raréfaction des demandes de messes de souvenir dans les testaments, donc d'offices, donc de revenus, donc en besoin en services de maîtrises.
Concernant l'important « turn-over » des maîtres, les auteurs emploient souvent le mot « vicariant » qui nous semble impropre. Ce terme indique la substitution (de fonction). Or la situation d'un maître remplaçant un autre maître n'est pasd de caractère vicariant. La vue qui informe sur la froideur d'une surface lisse est vicariante par rapport au toucher. Nous préférons l'idée de vaguance, comme on l'emploie avec les clercs vaguants.
Ces remarques naissent de l'intérêt même de l'ouvrage qui nous semble au plus haut point utile, clair et pratique pour la connaissance en histoire de la musique.
A consulter également :
La maîtrise de la cathédrale de Reims des origines à Henri Hardouin XIII°-XVIII° siècles. Bibliothèque Municipale / Médiathèque cathédrale de Reims, 15 septembre / 15 novembre 2003. FFCB. Musiques et patrimoines, Mois du patrimoine écrit 2003 [103 p. 7 €.].
Jean-Marc Warszawski
8 mars 2004




À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISSN 2269-9910.

Dimanche 10 Mars, 2024

