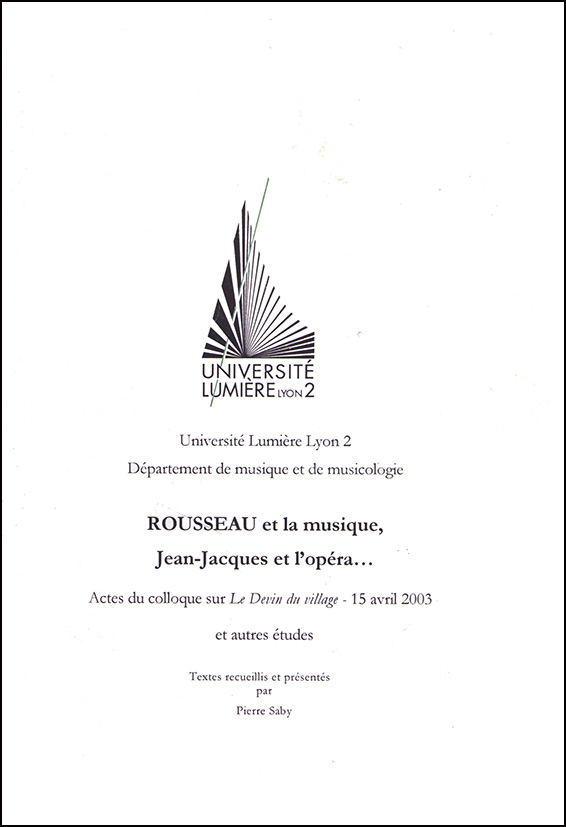Rousseau et la musique, Jean-Jacques et l'opéra
SABY PIERRE (ed.), Rousseau et la musique, Jean-Jacques et l'opéra. Publication du Département de musique et musicologie, Université Lumière Lyon 2, septembre 2006 [actes du colloque sur Le Devin du village, 15 avril 2003 ; 226 p. ; ill. ; 20 €] .
Jean-Jacques Rousseau a développé et théorisé une critique sociale sur un front extrêmement large, par la diversité des sujets, mais encore celle des approches, y compris introspectives, et ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un engagement politique.
De sorte, il ne s'est pas attiré que des amis, d'autant qu'il était lui-même prompt à la polémique et à la fâcherie. Il est apparu, aux yeux d'un certain nombre de ses contemporains, comme un personnage provocant, voire scandaleux... Mais pour les révolutionnaires, il fut considéré comme le philosophe du peuple. La Convention ordonna en 1793, 15 ans après sa mort, le dépôt de ses cendres au Panthéon.
On l'a bien entendu attaqué sur ce qui apparaissait comme des « maillons faibles », sa vie privée, sa manière de s'habiller, l'abandon d'enfant, mais aussi sa prétention à vouloir parler de musique, un art, où dit-on, il n'entendait pas grand-chose.
Aujourd'hui, on sait qu'il est un penseur essentiel de notre histoire philosophique, sociale et politique. Sa pensée est là, incontournable et demeure une source prospective. On lui prête même une vertu qu'il n'a peut-être pas eue, la paternité du romantisme.
Mais, dans le milieu des musicologues, au domaine des sous-entendus et des biens entendus, si on se réfère souvent à lui, à ses écrits polémiques ou à son dictionnaire de musique, on n'évite pas le haussement d'épaules, le demi-sourire qui en dit long, la petite réflexion en marge ou entre parenthèses, pour souligner l'inconsistance, l'incohérence, la mauvaise foi de Jean-Jacques en musique.
Pourtant, Jean-Jacques Rousseau aborde les questions musicales en philosophe de sa philosophie, au même titre que le feront plus tard Nietszche, Adorno ou Jankélévitch, lesquels ne provoquent pas de signes d'un mépris convenu.
De cette philosophie, découle pour la musique, une théorie esthétique, une vision sociale, un engagement politique. Et là, Rousseau est tout aussi génial qu'il l'est dans les autres domaines, même s'il est techniquement, un musicien moyen, et qu'il ne dispose que des connaissances disponibles à son époque.
Pour mettre les actes au diapason des paroles, il a écrit le livret et composé la musique d'un petit opéra, un divertissement : « Le Devin du village ». Présenté à la cour, le « Devin » eut un immense succès, et fut programmé, jusqu'à la Restauration, pratiquement sans interruption, à l'Opéra de Paris.
C'est une œuvre simple, sans grands moyens, mais d'une magnifique élégance et pureté.
Cette œuvre qui fit date, inscrite dans la démarche philosophique d'un des penseurs la plus marquants de notre histoire, mais encore notre réflexion, méritaient bien un colloque, dont on nous offre aujourd'hui les actes.
Ceux-ci abordent le sujet dans une ampleur et des ramifications conséquentes, de manière claire et pédagogique, facilement abordable pour les non-spécialistes.
Jean-Marc Warszawski
20 janvier 2007
Table des matières
PIERRE SABY, Jean-Jacque Rousseau et la musique de son temps, p. 5-21
GÉRARD LE VOT, Rousseau et les musiques antique et médiévale, p. 23-69
CLAUDE DAUPHIN, L'idée de génie de Rousseau : entre l'inspiration et l'ouvrage du « Devin », p. 71-96
MICHAEL O'DEA, « Le Devin du village » dans les Dialogues de Jean-Jacques Rousseau, p. 97-115
PIERRE SABY, Le « non-devin » de Jean-Jacques Rousseau : une figure pour la contestation de l'opéra français, p. 117-140
OLIVIER BARA, La réception du « Devin du village » sous la Restauration, ou comment Rousseau fut chassé de l'Opéra, p. 141-171
RAPHAËLLE LEGRAND, Les « Amours de Bastien et Bastienne » de Marie-Justine Favard et Harny de Guerville : parodie ou éloge du « Devin du village de Jean-Jacques Rousseau ? p. 220-194
Bibliographie ; sources ; ouvrages et études postérieures à 1800, p. 195-213
Index, p. 215-221.




 À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISSN 2269-9910.

Jeudi 7 Mars, 2024