Structures sonores de l'humanisme en France
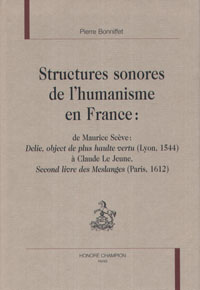 BONNIFFET PIERRE, Structures sonores de l'humanisme en France : De Maurice scève, Delie, object de plus haulte vertu (Lyon 1544) à Claude Le Jeune, Second livre des Meslanges (Paris, 1612).« Bibliothèque littéraire de la Renaissance », Honoré Champion, Paris 2005. [2200 p., ISBN 2-7453-1 143-3. 133 €].
BONNIFFET PIERRE, Structures sonores de l'humanisme en France : De Maurice scève, Delie, object de plus haulte vertu (Lyon 1544) à Claude Le Jeune, Second livre des Meslanges (Paris, 1612).« Bibliothèque littéraire de la Renaissance », Honoré Champion, Paris 2005. [2200 p., ISBN 2-7453-1 143-3. 133 €].
D'emblée, ce livre se présente de manière impressionnante : par l'élégante austérité de sa couverture, par son épaisseur, par son éditeur attaché à la tradition universitaire. Mais encore, par son titre, qui évoque une érudition rare, voire obscure, par le fait qu'il est issu d'une thèse d'État, la dernière — dit-on, a avoir été soutenue : ce diplôme hautement honorifique n'étant accessible qu'aux prétendants s'y étant inscrits avant sa suppression, dans les années 1985.
On pourrait hésiter à ouvrir un tel ouvrage, par crainte d'y trouver un genre universitaire déjà combattu au XIIIe siècle par Abélard, qui parlait d'arbre feuillu et resplendissant, mais sans fruit, ou de verbiage magnifique, mais renseignant fort peu.
Évidemment, écrire cela, c'est écrire que tel n'est pas le cas. Bien que ne cédant en rien à l'académisme imposé par la tradition du genre, ce livre est rédigé avec distinction, sans jargon ni sous- ou bien entendus à décrypter. Peut-être même peut-on discerner une certaine préciosité élégante et un goût pour les mots rares, lesquels, par-ci, par-là, émaillent le texte. Dans le fond, écrire sur la langue poétique peut donner envie de la prouver.
Le propos est donc clair, transparent ; l'érudition, soutenue et foisonnante, n'a pas d'autre prétention que celle de soutenir la réflexion.
Fait assez rare dans les travaux universitaires d'aujourd'hui, l'auteur est engagé, ose, avec parfois humour, des jugements et prospectives personnels. Autrement dit, on entend très fort le « je » qui a beaucoup à dire, derrière le « nous » collectif.
Il reste que ce n'est pas un livre « facile », par le sujet, sa concision, sa technicité, et peut-être comme le dit l'auteur, parce que souvent, les préjugés masquent les évidences.
La thèse centrale est celle-ci : la poésie et la musique, leur unification en chanson, sont des choses qui sonnent. Elles sont avant tout des objets sonores, des totalités concrètes. Une chanson, écrit Pierre Bonniffet, ce sont des phonèmes, une musique et son chant, qui se donnent comme un tout unifié. On nous invite donc plutôt que de « sauter à la rime pour se rincer l'œil et lire pour comprendre » la poésie, de « lire pour entendre ». Parce « c'est bien en effet la prononciation qui était au cœur du débat sur la création poétique et non pas l'écrit, ni même l'orthographe » [p. 76]
Cette thèse est traversée par un précepte méthodologique issu de la scholastique humaniste, la trinité « invention, disposition, élocution », pour le créateur, et en sens inverse pour l'auditeur. On dispose au départ d'un matériau, ou de l'inspiration (divine), il faut le formaliser (le disposer et en disposer) pour en faire une œuvre qui ne se révélera que par sa diffusion (élocution).
La période étudiée est comprise entre la publication en 1544, de « Delie, object de plus haulte vertu », long texte poétique sur l'absence, de Maurice Scève, poète lyonnais, admiré pour son art, et discuté pour son obscurité, et la publication, en 1612, du « Second livre des Meslanges » de Claude Le Jeune, le maître de musique d'Henri IV.
Ce livre analyse donc, du point de vue de leurs effets sonores, la poésie, la musique et aussi leur unification par la chanson. Pour rassurer les littéraires comme les musiciens, on portera attention au fait que l'auteur, chercheur au CNRS, sur le français ancien, a enseigné au département de musicologie de Paris IV, et chante le répertoire qui est ici étudié.
On peut considérer cet ouvrage, comme la justification des nombreuses transcriptions modernes de chansons de l'époque dite humaniste, réalisées par l'auteur. Ce dernier se donne pour but de retrouver la pureté initiale d'interprétation de ces chansons.
Nous ne partageons pas ce point de vue, qui doit être pourtant essentiel, aux motivations de Pierre Bonniffet. Nous ne pensons pas que l'histoire puisse être reconstruite, mais encore que cette notion de « pureté originale » est un préjugé fort, propre à notre civilisation, avatar en histoire de l'essentialisme, toujours une construction perpétuelle a postiori.
Il reste que cette motivation, celle de se rapprocher, dans le temps, de cette supposée pureté originelle, à conduit l'auteur à accomplir un remarquable travail d'historien, puisqu'il a recherché, à partir du témoignage des grammairiens, des grands témoins du temps, des humanistes eux-mêmes, à savoir comment on pouvait entendre poésie et musique, plutôt que de discuter, à partir des traités de musique, la place de telle ou telle note. C'est ainsi que sont mis à contribution Théodore de Bèze, Étienne Dolet, ou Pontus de Tyard etc. et surtout Marsile Ficin, parce que :
« C'est par l'hédonisme vocal exempt de tout remord dont il fait preuve, que Ficin innove, et qu'il influe sur la musique : son idée du phénomène sonore enrichit à la fois l'acte du musicien et celui de l'interprète, car il ne décrit pas la nature du son uniquement en termes arithmétiques, sa place dans la gamme seulement en termes de géométrie, ni le mode de sa transmission en termes mécaniques : l'intenzionalità, base de la connivence [...] entre en jeu, et c'est pourquoi le chant est si souvent invoqué à l'appui de sa théorie sonore ».[ p. 300]
L'auteur ne recherche pas la vérité formelle ou intemporelle, que ces témoignages pourraient fournir (il n'y a donc pas de pureté originelle), mais se place dans la dynamique des mentalités, ou de l «'air du temps » des grands penseurs humanistes. Il s'agit donc bien d'une manière moderne de faire de l'histoire.
Loin d'une « mise en contexte » chère aux histoires de la musique, il est bien question ici des dynamiques mêmes du contexte qui élaborent l'histoire et n'en est sont pas qu'un décor. Cela entraîne un type de questionnement du document ancien, dont on ne recherche pas le simple témoignage formel, mais les conditions pratiques et opérations idéologiques qui conditionnent son élaboration, et donc le sens de son contenu.
C'est cela qui donne bien des richesses à ce livre, émaillé d'une grande quantité de remarques destinées à encadrer le monde possible de la pensée et des évidences de l'époque, et donc en retour, notre manière de les aborder.
Si Pierre Bonniffet va parfois chercher très loin ses justifications, il est aussi rappelé à l'ordre par la nécessaire réalisation pratique. Peut-être sommes nous en présence d'un grand traité d'esthétique de la chanson du second XVIe siècle, et donc en effet, de la pureté originelle, qu'aucun artiste, c'est connu, ne respecte.
Jean-Marc Warszawski
20 juin 2007





À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISSN 2269-9910.

Jeudi 7 Mars, 2024

