« Je voudrais, dit Franz...»Grande Fantaisie d'un wanderer
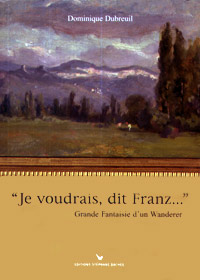 DUBREUIL DOMINIQUE, « Je voudrais, dit Franz...» : Grande Fantaisie d'un wandere. Éditions Stéphane Bachès, Lyon 2004.
DUBREUIL DOMINIQUE, « Je voudrais, dit Franz...» : Grande Fantaisie d'un wandere. Éditions Stéphane Bachès, Lyon 2004.
Dominique Dubreuil tente de nous livrer ici des archives à l'accès des plus difficiles, dont seule la poésie semble capable de casser les secrets. Il faut bien cela, pour rendre compte de ce qui a pu être le dernier délire de Franz Schubert, son dernier Voyage d'hiver. Comme un écho littéraire à sa musique.
C'est bien là, le dernier et posthume délire de Franz. Son premier médecin, un butor, le lui avait dit : « vos exaltations sont des signes avant-coureurs »... Mais de quoi ?
Erik Satie, nous l'a appris, « tous les malheurs viennent de la musique ». Mais Franz, instinctivement, sans pouvoir connaître Satie et n'ayant certainement pas encore lu Goethe, a peur du Roi des aulnes, le voleur d'enfants. Il écrit à son père que son professeur de musique manigance de terribles choses. La musique aurait-elle donc perdu Franz dans un voyage infini ?
On comprend alors l'importance du « sémaphore éolien musical », destiné à transmettre la musique, invention dont il est, on le remarque, assez fier. Quelle bonne idée pour faire voyager la musique sans bouger, en étant enfermé même, enfermé dans sa tête même, de livrer les œuvres à la dramatisation du vent, d'utiliser cette invention militaire française pour appeler les nations à la concorde. Car la première œuvre diffusée par « Sémaphore éolien musical » doit être un appel à la concorde.
Le lecteur inattentif risquerait à tort d'attribuer l'invention du « Sémaphore éolien musical » à la fécondité, à la virtuosité poétique de la plume de l'auteur (si indiscutable, qu'on pourrait arrêter là le dévoilement). Ce lecteur inattentif, mettra en avant, qu'aucun des biographes de Franz, parmi eux les plus autorisés, n'a porté la moindre attention à cette invention. Pourtant, celle-ci est vraiment à l'honneur du compositeur qui offre à l'humanité un instrument utile et pacifique, transforme la musique en voyage et par là, Franz lui-même en voyageur infini.
Le voyage est fluidité, écoulement, flot, égouttement, infiltration, érosion, transport. Fluidité de toute cette eau qui imbibe chaque page du livre. N'y a-t-il meilleure analogie poétique à la musique que l'eau ?
Thierry Escaich n'évoque-t-il pas « le ruissellement des eaux natales de l'univers » pour présenter son :« Exultet » ?
Certes, les savant rétorqueront système stellaire, harmonie des sphères, intervalles parfaits, et Dieu qui compte sur ses doigts. Mais que disent les nombres à propos de la Jeune fille et la mort ?
Justement, Franz se renseigne auprès de ses amis : la mort est-elle masculine ou féminine ? Question secondaire pour le biologiste, mais essentielle pour le poète. Là, il faut couper la poire en deux. Germanique, elle est un homme ; latine elle est une femme. C'est avec la latine qu'il se promène longuement à la campagne. Mais, déjà en voyage sur le Styx, il crie, il renonce, et le passeur l'exauce. Mais revient-on vraiment de parmi les morts ?
Parfois, quand il fait très froid, cette eau devient concrète, se solidifie, devient glace, elle est alors hiver.
On sait comment, la première audition qu'il donna du « Voyage d'hiver », aurait laissé ses amis de glace. Il leur aurait semblé que ce voyage était trop sombre,. Ils auraient ignoré que Franz était déjà en chemin.
Les choses ne se sont en effet pas très bien passées. C'est Vogl (oiseau en allemand) qui chanta le Voyage (était-ce vraiment la création du Voyage d'hiver ?). Soucieux d'unifier sa musique et la nature, Franz avait disposé sur scène un arbre (un tilleul ?), un bac de glace et un oiseau (Vogel en allemand) en cage... Les problèmes ont éclaté quand Franz a disposé les cubes de glace sur les cordes du piano, car le propriétaire du lieu a craint le pire pour son matériel. Pauvre ignorant qui ne pouvait comprendre qu'il assistait à une invention musicale majeure, appelée de nos jours le « piano préparé ».
On considère (à tort), que John Cage (Käfig en allemand) est l'inventeur du piano préparé. Mais il faut s'avouer qu'il est un petit garçon en culottes courtes à côté de Franz. C'est un piano d'écolier qu'il prépare, avec ses gommes, crayons, bouts de papier, règles etc. Franz, avec ses glaçons, y fait entrer la nature concrétisée. À la fin du concert, Franz ouvre la cage, et libère l'oiseau. Mais on ne peut pas dire qu'il eut avant Olivier Messiaen le goût pour l'ornitologie musicale.
Franz écrit d'ailleurs : « Je cherchais du regard les oiseaux maritimes qu'on voit sur les remparts de la ville ou qui vont se percher sur les mâts des navires dans le port. J'avais appris qu'un voyageur étranger, très savant, était arrivé pour tenter de saisir le sens de ces cris, de ces plaintes, de ces triomphes aussi quand le vent semble emporter sans pitié ces mouettes alors que tout est calculé par les oiseaux de la trajectoire, infiniment mieux qu'aucun musicien ne saurait le gouverner dans sa partition. »
Avant d'entamer le grand voyage, accompagnant le char mortuaire du despote, un tsar, dit l'histoire, peut-être Beethoven dirait une autre histoire, il est un temps, serveur dans un restaurant ou se rencontrent Goethe et Beethoven, ses idoles. Mais à la caisse, n'est-ce pas le Commandeur de pierre qui compte les jours si comptés ?
Voilà pour les choses triviales. On notera, pour l'aspect plus relevé, une lettre reçue par Franz dont le contenu est tout à fait juste : « ... je pense que l'histoire dont vous allez lire les grandes lignes est par essence poétique : puisque vous êtes, j'en suis certain après avoir déchiffré certaines de vos partitions, un véritable musicien, vous ne pouvez qu'arriver à devenir vous aussi le conducteur de ce récit, avec cette magie que communiquent les sons lorsqu'ils sont réinventés par quelqu'un de votre talent. Mieux : je suis persuadé que reconnaissant dans mon ébauche de poème certains traits qui pourront vous émouvoir, vous n'aurez pas de peine à compléter en vous glissant dans mon œuvre ce que j'ai laissé seulement à l'état de suggestion »
Le compositeur Pascal Dussapin présente ainsi ses conférences au Collège de France : « Composer n'est pas démontrer. Composer, c'est inventer des impulsions et des flux. C'est comme l'eau d'une rivière. Composer, c'est inventer des chemins de traverse, des éloignements, des distances. C'est comme fuir et s'enfuir toujours. Mais composer, c'est long. Et lent. Très lent. Très, très long et lent... Ça n'avance jamais. C'est parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. La question paradoxale, ça n'est pas d'achever mais comment ne pas finir. Composer, c'est ne jamais finir. Ça prendrait beaucoup trop de temps de finir, c'est-à-dire tout notre temps. Et pour autant, nous n'aurions jamais fini. »
Franz écrit à son ami Jochen : « Tu te rappelles que jadis mon père voulait que je m'adonne à un métier d'artisan, « d'un noble artisanat qui te rapprochera du pouvoir d'un dieu antique », disait-il. Je ne lui ai certes pas obéi, je ne suis pas devenu le confectionneur d'horloges et de montres qu'il rêvait d'avoir comme fils. Mais s'il était encore avec nous, je pourrais lui montrer ce modèle inouï que l'obéissance au Voyageur m'a conduit à inventer. « Chacun occupe dans le Temps sa place, tu dois aider chacun à trouver cela », me disait-il aussi quand il croyait que je deviendrais cet artisan. Je contourne, je retarde, j'anticipe, je suspends chaque fragment de ce temps, qui ne pèse pas plus que l'aile du papillon, que le grain de sable. Et j'évite la chute dans l'obscurité, aux bornes du pays où l'on ne compte plus les heures. Combien d'années me laissera encore le Voyageur, je l'ignore, et peut-être son décret à lui, qui a seul véritablement pouvoir d'arrêter qui ou quoi que ce soit, est-il déjà revêtu de sa signature ? J'aurai déjà vécu suffisamment pour une minuscule victoire. Et tu en témoigneras, me le promets-tu bien ? »
Un bon moment de livre dans les paysages fantastiques du romantisme.
Jean-Marc Warszawski
10 avril 2007





À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISSN 2269-9910.

Mercredi 6 Mars, 2024

