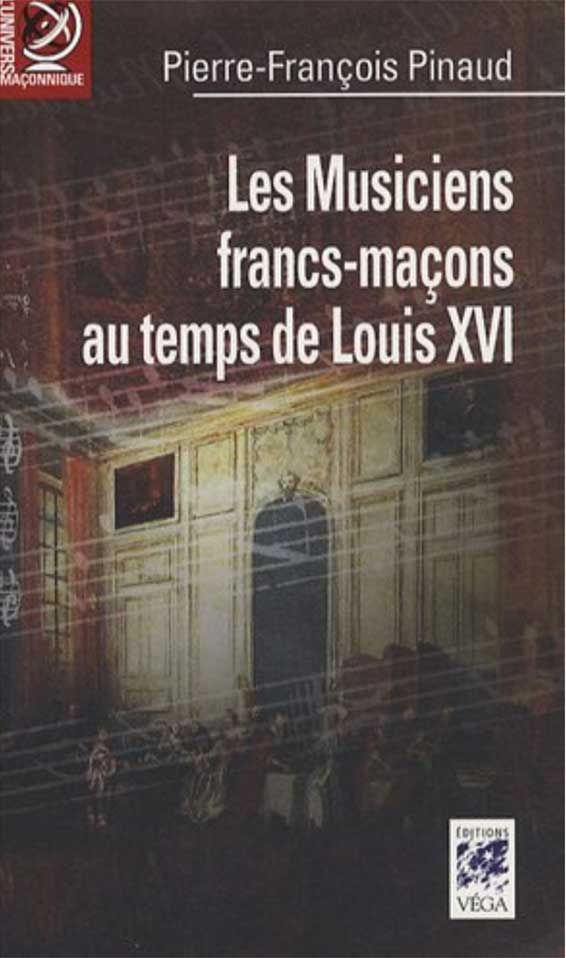Les Musiciens francs-maçons au temps de Louis XVI
Pinaud Pierre-François, Les Musiciens francs-maçons au temps de Louis XVI (De Paris à Versailles : histoire et dictionnaire biographique). « L'Univers maçonnique », Éditions Véga, Paris 2009 [347 p. ; ISBN 978-2-85829-526-5 ; 20 €].
Avec un sujet serré – les musiciens francs-maçons, et une étroite limite temporelle – le règne de Louis XVI, ce livre, contre toute attente, n'est pas un exercice d'érudition marginale sur un épiphénomène.
À partir de cet objet d'étude assez singulier, Pierre-François Pinaud met en mouvement toute la sociabilité musicale du moment, au moins entre Paris et Versailles, ce qui n'est pas rien.
Contrairement à la province, les musiciens de la capitale et du siège royal, semblent s'être massivement ralliés à la franc-maçonnerie, y ont pris un certain pouvoir, et s'y sont organisés, anticipant sur la solidarité syndicale.
S'ils n'en sont pas le centre de la vie musical, les frères musiciens, pas des moindres, en sont-ils, au moins, au centre.
On évoque l'inertie d'une cour versaillaise empâtée dans ses traditions, et d'un Paris dynamique en effervescence, où la vie de salon est au centre de la création musicale. Un décalage avec la province, où les musiciens sont tenus à l'écart de la bonne société.
On s'attache — l'auteur est un historien spécialiste des finances publiques, à mettre en lumière les sources de financement, pour la création, et donc pour les musiciens, ce qui est essentiel, et pourtant rarement traité. En tout cas, cela ne fait pas partie du questionnaire courant des biographies des musiciens.
Toujours à la recherche de la vie réelle qui fut celle des musiciens, on lit encore avec intérêt ce que furent les dynasties de musiciens, leur alliances et relations familiales, et encore, ce que fut la présence des musiciens étrangers en France, et inversement, les musiciens français à l'étranger, tout en relativisant le goût cosmopolite des Lumières au regard de la réalité.
Livre d'histoire et dictionnaire, l'auteur a eu l'heureuse méthode, de séparer les deux, en présentant en quelque sorte, une première partie « rédigée », et une seconde partie documentaire, le dictionnaire, où sont présentés les notices sur les 342 musiciens recensés.
Cette manière de faire n'est pas anodine, elle s'inscrit dans l'effort historiographique de l'École des Annales, et de la célèbre 4e section de l'École Pratique des Hautes Études, menacé par la culture wikipédienne, elle-même portée par un retour en puissance du positivisme formel.
Nous nous retrouvons en Kant, quand ce dernier, dans son « Anthropologie du point de vue pragmatique » écrit qu'il y a
« [...] les géants de l'érudition, qui en sont aussi les cyclopes, car il leur manque un œil : celui de la vraie philosophie qui permet à la raison d'utiliser opportunément cette masse de savoir historique qui pourrait charger cent chameaux. »1
Une suite est annoncée, pour ce qui concerne la période de l'empire. Espérons que là aussi, la franc-maçonnerie des musiciens soit un échantillon représentatif et pertinent de la vie musicale en général.
Jean-Marc Warszawski
3 novembre
2009
_______
1. Kant Emmanuel (1724-1804), Anthropologie du point de vue pragmatique (traduit de l'allemand par Michel Foucault). « Bibliothèque des textes philosophiques », Vrin, Paris 1964, p. 90.
À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISSN 2269-9910.