Le Mouvement Scholiste de Paris à Lyon
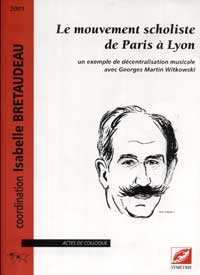 Isabelle Bretauneau (coordination), Le Mouvement Scholiste de Paris à Lyon : un exemple de décentralisation musicale avec Georges Martin Witkowski.Éditions Symétries, Lyon 2005.
Isabelle Bretauneau (coordination), Le Mouvement Scholiste de Paris à Lyon : un exemple de décentralisation musicale avec Georges Martin Witkowski.Éditions Symétries, Lyon 2005.
Pour commémorer le centenaire de leur institution créée en 1903, les animateurs de la Schola cantorum de Lyon ont entre autres organisé un colloque, dont les Éditions Symétrie ont récemment publié les actes.
Ce colloque est ambitieux à deux titres. D'abord l'intitulé nous révèle qu'on n'a pas l'intention de se cantonner à la chronique locale de la fondation d'une chorale en 1903 et d'un orchestre symphonique en 1905, mais de s'attacher à de plus vastes perspectives qui sont celles de la personnalité du fondateur, le compositeur et chef d'orchestre Georges Martin Witkowski, du mouvement scholiste et de la décentralisation.
Sujet ambitieux parce que l'idée de décentralisation pointe vers un politique complexe, ambigu aux contours mal définis. En 1900, la décentralisation ne se pense pas comme en 1789 quand la commune devient la cellule de base de la République, ni comme dans les années 1960 quand, sous le ministère d'André Malraux on décide de décentraliser la culture.
Le mouvement scholiste quant-à lui, initié par Charles Bordes en 1895 pour promouvoir une musique religieuse de qualité selon lui, est un mouvement de société dans lequel sont impliqués, évidemment, les affaires du culte et de musique, mais également la politique, les questions de pédagogie musicale, la concurrence avec le Conservatoire, la personnalité de Vincent d'Indy, mais aussi les grandes visions esthétiques du temps.
Aux étendues du sujet annoncé s'ajoute la diversité et la richesse des angles d'attaque adoptés dans les douze articles formant l'ouvrage.
A tout seigneur tout honneur. La figure de Georges Martin Witkowski né en Algérie en 1867 inaugure le livre. La mère, Blanche Witkowska est la fille d'un officier polonais reconverti en professeur de piano à Angers. Le Père, officier dans les Hussards disparaît en 1869. On rejoint le grand-père pianiste à Angers. Blanche Wiktowska devient professeur de chant et se remarie avec l'organiste de la cathédrale de Rennes. Ce sont là les premiers professeurs de Georges Martin Witkowski. Puis il fait successivement le Prytanée militaire de La Flèche, Sain-Cyr et Saumur avant d'être affecté à Lyon en 1891. Il compose depuis plusieurs années, et cherche conseil auprès de Vincent d'Indy qui dirige sa première symphonie en 1760 à la Société nationale de musique. Ses œuvres sont alors régulièrement créées par des interprètes de qualité en France et à l'étranger. En 1902 il fonde à Lyon la Schola cantorum inspirée du modèle parisien. Il donne le premier concert en 1903 avec 200 choristes. En 1905, assuré par des soutiens politiques et financiers, il fonde la Société des grands Concerts. Il démissionne de l'armée en 1906. En 1907 il fait bâtir la salle de concerts dite Salle Rameau qui reste en service jusqu'en 1975. Il s'installe à Paladru, un village du Dauphiné dont il est élu maire en 1919. Il est passionné par le jardinage, l'apiculture et la culture des Glaïeuls. Édouart Herriot, maire de Lyon depuis 1905 le nomme à la tête du Conservatoire en 1924. Il meurt en 1943. Son œuvre d'organisateur et de chef d'orchestre est continuée par son fils Jean jusqu'en 1953.
Il est un compositeur indépendant, selon ses propres termes. Il n'est issu ni du Conservatoire ni directement de la Schola cantorum, même si son beau-père - l'organiste, est en relation avec deux des fondateurs de l'Institution, Charles Bordes et Alexandre Guilmant. Il se montre dans un premier temps attaché à la musique orchestrale pure et à la forme cyclique, c'est à dire à des œuvres conçues en plusieurs mouvements contrastés mais unis par une unité ou une résurgence thématique. C'est là un sujet de discorde entre l'esthétique d'Indyste se réclamant de César Franck et le reste du monde musical. Mais Witkowski ne s'enferme pas, ses œuvres sont appréciées, sinon son écriture, par un large éventail de ses collègues et critiques, y compris Debussy, farouche opposant à l'esthétique de la Schola. Il est influencé par l'impressionnisme et le symbolisme dont on lira avec intérêt comment cela peut être mis en écriture musicale. Habile mais peu téméraire quant au langage harmonique, imprégné de romantisme, il utilise toutefois des éléments non tonaux, comme les modes liturgiques, ou pousse son harmonie au profit de complexités contrapuntiques. Son œuvre ... relaie et porte en elle les interrogations des musiciens de son époque sur les limites du langage tonal ou plutôt - ce qui est en fait la même chose - sur son renouvellement à la fois structurel, thématique, harmonique, métrique et rythmique. Dans sa voie personnelle, Witkowski répond par l'intégration de couleurs, de processus syntaxiques et de techniques d'écriture. Il ajoute, au risque - diront certains - de dissoudre et de nuire par trop d'empilements [p. 186].
Un tour d'horizon du répertoire interprété par la Schola cantorum et l'indication des divers ensembles vocaux importants ayant existé à la même époque sont complétés d'un catalogue des concerts donnés à partir du 29 avril 1903 par la Société des grands concerts, dirigée par Georges Martin Witkowski. Ainsi est illustrée son activité d'organisateur et de chef d'orchestre. On note dans les années précédant la première guerre mondiale un mouvement de diversification du répertoire, qui se concrétise dans les décennies suivantes par de nombreuses premières auditions et la prestation d'artistes de premier plan. Le contexte musical lyonnais est complété par une histoire de sa maison d'opéra et de la réception des œuvres qui y sont données. Rebaptisée Schola Witkowski, La Schola cantorum reste associée à l'Orchestre des grands concerts jusqu'à sa transformation en Orchestre national de Lyon en 1974.
Le scholisme est évoqué par un article consacré plus à la célèbre école de musique parisienne qu'au mouvement choral lui-même qui n'est d'ailleurs pas fédéré, et par une réflexion sur le régionalisme, peut-être plus spécifique à Vincent d'Indy qu'au scholisme lui-même. Quant à la problématique de la décentralisation, elle est diffuse dans l'ensemble de l'ouvrage et surtout comprise comme la possibilité d'organiser ailleurs que dans la capitale une vie musicale de grande qualité. Ainsi comprend-on les pages dédiées à l'œuvre de Joseph Guy Ropartz à Nancy qui est une parallèle à celle de Martin Witkowski à Lyon.
Il est notoire que Vincent d'Indy était opposé à l'enseignement de l'harmonie à la Schola cantorum au profit unique du contrepoint. Cela peut paraître curieux et explique les efforts pour transformer cette curiosité en figure de rhétorique. Or, c'est une réalité attestée par les élèves de Vincent d'Indy qui consultaient les traités d'harmonie en cachette. Cela ne remet pas en cause l'excellence et la modernité de l'enseignement assuré par l'établissement.
Il reste que nous ne sommes pas convaincus de la filiation établie entre Georges Martin Witkowski, le mouvement scholiste (y a t-il un mouvement scholiste ?) et les idées de Vincent d'Indy (de Maurras) sur la décentralisation. Ce qui nous semble être décrit est la volonté des autorités lyonnaises, mais aussi nancéennes, comme celles de toutes les grandes villes, d'imiter Paris, voire de réussir mieux le modèle : Lyon est une capitale. A sa tête, Édouard Herriot est opposé aux idées de Maurras (et de d'Indy). Il prend la défense de Dreyfus, il fonde la section lyonnaise de la Ligue des Droits de l'Hommes, il est Antimunichois, s'abstient dans le vote des pleins-pouvoirs à Pétain, refuse de collaborer, il est déporté en 1944. Tel est le milieu dans lequel Witkowski évolue, même s'il n'en partage pas les vues.
Un important cahier de photographies agrémente le livre ainsi qu'un catalogue des œuvres par ordre alphabétique et hiérarchique.
Jean-Marc Warszawski
5 mars 2005
Les articles
- Georges Martin Witkowski (1867-1943) : l'homme et l'œuvre (Bertrand Pouradier Duteil)
- Le régionalisme comme élément esthétique du mouvement scholiste : sources historiques, aspects esthétiques (Philippe Gonin)
- La Schola, une pédagogie nouvelle pour la musique (Fabien Michel)
- Les survivances impressionnistes et symbolistes dans l'œuvre de Witkowski (Muriel Joubert)
- La Princesse lointaine (1934) de Georges Martin Witkowski : l'éclairage du mythe par la psychanalyse et sa mise en œuvre dans les Stances de Joffroy Rudel (Henri Gonnard)
- Le répertoire choral à la Schola et autour de la Schola (1903-1953) (Bernadette Lespinard)
- La gestion de l'énergie dans la Sonate pour violon et piano de Georges Martin Witkowski : premier mouvement, exposition (Denis Le Touzé)
- Le Lyonnais et le Flamand, aspects d'une amitié (Damien Top)
- Le Quatuor en mi de Georges Martin Witkowski (Isabelle Bretaudeau)
- Joseph Guy Ropartz à Nancy (1894-1919), un exemple de décentralisaton musicale (Mathieu Ferey & Benoît Menut)
- L'Opéra de Lyon à la charnière de deux siècles (Gérard Corneloup)
- Interprètes, chefs et créations : « idiomatismes » de la vie musicale lyonnaise (Gérard Streletski)
- Catalogue des œuvres musicales de Georges Martin Witkowski (Isabelle Bretaudeau)
- Catalogue « hiérarchique » des œuvres musicales de Georges Martin Witkowski (Ivan Witkowski & Henri Pouradier Duteil).
Notes en marge
Comprendre n'est pas réhabiliter.
Le dernier tiers du XIXe siècle connaît en France trois événements politiques majeurs. La défaite militaire devant l'Allemagne, la Commune de Paris (et celles des grands centres urbains, comme Lyon), puis l'affaire Dreyfuss. Dans les réactions aux deux premiers événements on perçoit le nationalisme, une complexité des rapports français à la musique allemande, et un regain de ferveur religieuse, en partie expiatoire. Ainsi, patriotisme et romantisme s'emparent ou intègrent un engouement médiéviste qui se développe depuis le milieu du siècle, en témoignent les œuvres de Walter Scott ou de Victor Hugo (Notre-Dame de Paris), Prosper Mérimée, président de la commission des Monuments Historiques en 1837, l'œuvre de restauration de Viollet-le-Duc, la célébration 14e centenaire du baptême de Clovis Reims en 1896 etc. La Création de la Schola cantorum à l'église Saint-Gervais par un Charles Bordes s'inscrit naturellement dans ce cadre. Et c'est tout naturellement que l'école qui surgit rapidement est intégrée à l'Institut catholique.
Mais Vincent d'Indy apporte des orientations particulières, comme le régionalisme qu'on rapproche peut-être trop rapidement du recyclage des musiques (et littératures orales) populaires tel qu'il se pratique un peu partout à cette époque (en 1897, Charles Bordes collecte les vieux chants basques). Je pense plutôt que pour cet aristocrate catholique traditionaliste il s'agit plus d'un retour aux sources, au sang et aux racines qu'un réinvestissement patrimonial et populaire. Son antisémitisme, sa xénophobie et sa participation à la Ligue de la patrie française aux côtés de quelques intellectuels comme François Coppée, Frédéric Mistral et surtout Charles Maurras, sa collaboration à l'«Occident» d'Adrien Mithouard, renforce notre idée qu'il convient de considérer une composante d'Indyste au phénomène Scholiste. Cela ne doit pas être étranger à la scission de 1935 avec le départ des d'Indystes comme Guy de Lioncourt qui fondèrent alors l'école César Franck. D'autant que l'Église condamne les idées de Charles Maurras en 1926. Il ne faut pas perdre de vue que la Schola cantorum (l'école) est intégrée à la section des Beaux-Arts de l'Institut catholique de Paris.
Dans ce cadre, l'idée de décentralisation est certainement proche de celle du corporatisme d'état défendue par Maurras (c'est l'Église qui doit organiser la pays) mais encore celle de l'archéologue et historien Maurice Bouvier-Ajam (1914-1984) qui prévoyait d'attribuer des pouvoirs législatifs aux corporations. Ministre de Pétain, Bouvier-Ajam contacte Guy de Lioncourt pour envisager la création d'une corporation des musiciens. Lioncourt est déjà président d'une fantomatique union des musiciens. Le projet est sans suite.




À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISNN 2269-9910.

Mercredi 21 Février, 2024

