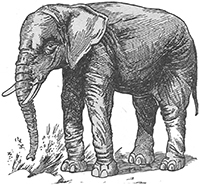Jaques-Dalcroze Émile [Jaques Émile]
1685-1950
![Jaques-Dalcroze Émile [Jaques Émile]
1685-1950](jaques_dalcroze.jpg)
Né à Vienne 6 juillet 1865, mort à Genève 1er juillet 1950.
Sa famille est originaire des environs de Neuchâtel en Suisse. Son père est représentant en horlogerie pour des fabriques suisses. En 1875 la famille s'installe à Genève.
En 1881 il compose une opérette, La Soubrette (perdu). A l'université il étudie les lettres et suit les cours du Conservatoire. Il fonde un orchestre qu'il nomme Musigena.
En 1884, il gagne Paris. Attiré par l'art dramatique, il étudie la diction, mais aussi la musique avec Marmontel, Fauré et Delibes. Il y compose un opéra-comique, Riquet à la houpe (non créé).
En 1886, il obtient un poste de second chef d'orchestre au Théâtre des Nouveautés d'Alger, dirigé par Adler, un compositeur originaire de Suisse. L'année suivante il compose L'Ecolier François Villon (non créé). Le Théâtre fait faillite, il part en tournée avec la troupe.
Pour éviter la confusion avec le compositeur français émile Jaques, il adopte le patronyme Jaques-Dalcroze, empruntant ainsi à son ami Raymond Dalcroze.
En 1887, il accompagne son père à Vienne. Il est admis au Conservatoire où il étudie l'orgue, le piano et la composition avec Anton Bruckner, Robert Fuchs et Graedener
En 1889, il est à Paris. Il y rencontre Mathis Lussy (1828-1910). D'origine suisse, Mathis Lussy est à Paris depuis 1846. Il a abandonné ses études de médecine au profit de la musique. Professeur de piano au monastère de Picpus, il est également un théoricien. En 1902 il retourne en Suisse, ratifié de la légion d'honneur. Cette rencontre est décisive pour émile Jaques-Dalcroze.
Les écrits de Mathys Lussy
Exercices de piano. Benoit, Paris 1863
Exercices de mécanisme. Heugel, Paris 1878
Traité de l'expression musicale. Berger-Levrault & Fischbaker, Paris 1874 ; 8e édition 1904 ; traduction en anglais, Londres 1885 ; traduction en allemand, Leipzig 1886 ; traduction en russe, saint-Petersbourg 1888]
Histoire de la notation musicale (avec E. David). Imprimerie nationale, Paris 1882
Chabanon précurseur de Hanslick. Dans «Gazette Musicale de la Suisse Romande», 7 mai 1896
Le rythme musical. Heugel &. Fischbaker, Paris 1883 ; 4e édition 1911
L'anacrouse dans la musique moderne. Heugel, Paris 1903
La sonate pathétique de L. van Beethoven, op. 13, Rythmée et annotée par Mathis Lussy (édité par A. Dechevrens). Costallat, Paris 1912.
De retour à Genève, Jaques-Dalcroze est nommé professeur de solfège et d'harmonie au Conservatoire. Il crée en 1893 sa suite lyrique, La Veillée, à la Société de chant du Conservatoire. C'est le début de la composition d'une série de Chansons romandes dont plusieurs ont un succès durable. Créées à L'Athénée de Genève, elles sont données en tournées hebdomadaires pour aider son père alors en difficultés financières. Elles sont aussi produites à l'Exposition Universelle de 1896 à Genève.
Il compose une musique pour un festival sur un poème de Daniel Baud-Bovy, celle d'une Revue pour collecter des fonds destinés à la restauration du clocher de la cathédrale Saint-Pierre.
En 1899 il compose son opéra Sancho Pansa, créé à Strasbourg. La même année, il épouse Nina Faliero (1878-1948), une cantatrice italienne. En 1900 il compose Jeu du Feuillu, et en 1903 la musique pour les festivités du centenaire de l'entrée du canton de Vaud dans la confédération.
C'est aussi en 1903 qu'il commence à mettre en œuvre ses idées sur la pédagogie du rythme musical. Pour lui, le rythme musical n'est qu'un aspect du rythme corporel en général. Il met au point une série d'exercices corporels, la gymnastique rythmique, destinés à combattre l'arythmie musicale. Il rencontre un grand succès, et sa méthode est adoptée par les Conservatoires de Bâle et de Zurich. Il organise des démonstrations dans plusieurs villes européennes.
En 1906 il commence sa coopération avec le scénographe Adolphe Appia (1862-1928) (qui travaillera plus tard avec Toscanini pour les opéras de Wagner). La même année il crée à l'Opéra de Paris, Le Bonhomme Jadis, et Tragédies d'amour à Neuchâtel ; en 1908 Les Jumeaux de Bergame, au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Sa femme chante dans ces deux dernières productions.
En 1909, son fils Gabriel naît.
En 1910, il fonde, grâce aux frères Dohrn, à Hellerau, près de Dresde en Allemagne un institut destiNé à son enseignement. En 1912, l'Institut Dalcroze de Hellerau organise des fêtes scolaires qui connaissent un immense succès international. On y fait des démontrations de gymnastique rythmique, mais encore on y donne des pièces du répertoire, comme l' Orphée de Gluck, dans des décors d'Appia.
En 1912 on crée un Institut Jaques-Dalcroze à Saint-Petersbourg. Sa méthode est également introduite au Conservatoire de Stockholm par Bror Beckman (1866-1929). La gymnastique rythmique connaît alors et durablement un grand engouement et dépassera de loin les simples objectifs de pédagogie musicale initiaux.
En juin 1914, il participe (avec son épouse) aux festivités de la célébration du centenaire de la libération genevoise par les troupes confédérées (Les Fêtes de juin). Peu de temps après, il signe une protestation contre la destruction de la cathédrale de Reims et de la bibliothèque de Louvain par les troupes allemandes lors de la première guerre mondiale. Il est interdit en Allemagne, Hellerau est fermé. En 1915, un Institut Jaques-Dalcroze ouvre ses portes à Genève.
En 1918, l'Institut de Genève présente son premier spectacle sur un texte de Jacques Chenevière et une musique d'Émile Jaques-Dalcroze, Les premiers souvenirs. En 1923, il réalise la Fête de la Jeunesse et de la Joie (oeuvre dans laquelle sa femme chante). Il crée un Institut à Paris.
En 1925 il est citoyen d'honneur de Genève. L'année suivante s'ouvre le premier Congrès international sur le rythme à L'Institut Jaques-Dalcroze de Genève. En 1927 il participe à un Congrès sur la pédagogie musicale à Francfort.
Influencé par son séjour algérois, où l'essentialité du rythme semble lui être révélée, il a l'idée de réformer les cours de solfèges, et met au point une méthode, l'eurythmie, afin que les jeunes élèves représentent simultanément les valeurs des notes et les intervalles de temps par des mouvements des pieds, des bras et du corps. Idées du temps qui vont confirmer le temps, dans un essentialisme des origines, de la danse devenue musique, ou de la fusion du corps et de la musique, de la fusion musique et gymnastique, le mouvement de libération du corps et du culte du sport, mais aussi des utopies sociales, d'ordre et de mouvement, de beauté et de discipline collective, parallèlement à la fusion du corps et de l'esprit.




Catalogue des œuvres
Œuvres musicales
(1895 (vers 1895), La Suisse est belle, 15 variations pour orchestre
1883, La Soubrette, opéra-comique sur un livret de Ph. Monnier
1883, Riquet à la Houppe, opérette sur un livret de Y. Plessis, Foetisch, Lausanne 1883
1888 (opus 6), Par les Bois, pièce en 3 tableaux sur un texte de Ph. Monnier, Doblinger, Wien 1888
1890, L'Ecolier, pièce en 2 actes sur un texte de Ph. Monnier,
1891 (opus 10), 3 Pièces enfantines pour piano, K & S, Leipzig 1891
1891 (opus 10), 6 esquisses pour piano K & S, Leipzig 1891
1891 (opus 9), Suite pour violoncelle et piano, K & S, Meipzig 1891
1892 (opus 14), 6 Lieder, K & S, Leipzig 1892
1892 (opus 15), 6 Lieder, K & S, Leipzig 1892
1892 (opus 16) Rondo scherzando pour violon et piano, K & S, Leipzig 1892
1892 (opus 36), La Veillée, cantate sur un texte d'é. Jaques-Dalcroze & Jeanne Thoiry, Foetisch Lausanne 1892
1892 (opus 8 n° 2), Nocturne pour piano, K & S, Leipzig 1892
1893, Le Violon maudit, opéra comique sur un livret de A. Puthier et émile Jaques-Dalcroze
1894 (opus 1)12 Mélodies pour chant et piano, Rouart Lerolle, Paris 1894
1894 (opus 11), Canzonetta pour piano, Rouart Lerolle, Paris 1894
1894 (opus 11), Sonatine en sol pour piano, Jobert, 1894
1894 (opus 7), 2 Feuillets d'album pour piano, Rouart Lerolle, Paris 1894
1894, Berceuse pour violon et piano, Rouart Lerolle, Paris 1894
1894, Janie, idylle musicale en trois actes sur un texte de Ph. Godet, K & S, Leipzig 1894
1894, Trois pièces mignonnes pour piano, Rouart Lerolle, Paris 894
1894, Valse badine pour piano, Rouart Lerolle, Paris 1894
1895 (opus 3), Impromptu scherzetto pour piano, Rouart Lerolle, Paris 1895
1896, Le Poème alpestre, Musique de fête en 3 actes pour solistes, choeur et orchestre sur un texte de D. Baud-Bovy, Foetisch, Lausanne 1896
1897, Sancho Pança, Comédie lyrique sur un livret de Y. Plessis, Jobert, Paris 1897 [une suite de ballets et est extraite]
1898, Des chanson (26 Lieder), accompagnement de piano, 1898
1898, Respect pour nous, opérette sur un livret d' émile Jaques-Dalcroze
1899 (opus 27), Romance pour violon et piano op. 27, Enoch, Paris 1899
1899 (opus 28), Berceuse pour violon et piano , Enoch, Paris 1899
1899 (opus 33), chanson populaires Romandes (2 volumes) op. 33, Foetisch, Lausanne 1899
1899 (opus 34) Premières rondes enfantines (16 Lieder), Foetisch, Lausanne 1899
1899 (opus 39), Au Siècle nouveau, cantate sur un texte d'é. Jaques Dalcroze, pour chœur mixte, chœur d'enfants et orgue, Foetisch, Lausanne, 1892
1899, 6 Danses romandes pour piano, Foetisch, Lausanne 1899
1899, Coucou sur un texte d'E. Jaques-Dalcroze pour choeur mixte, Foetisch, Lausanne 1899
1899, Le petit Mousse pour choeur mixte a cappella, Foetisch, Lausanne 1899
1900 (opus 15), Nouvelles rondes (15 Lieder), Foetisch, Lausanne 1900
1900 (opus 43), Le Jeu du feuillu, Musique de fête pour solistes, choeur et orchestre sur un texte d'émile Jaques-Dalcroze, Foetisch, Lausanne 1900
1901 (opus 40), chanson religieuses (3 volumes de 12 Lieder), Foetisch, Lausanne 1901
1902 (opus 41), chanson de l'Alpe, Foetisch, Lausanne 1902
1902 (opus 42), chanson d'enfants (12 Lieder), Foetisch, Lausanne ebda. 1902
1902 (opus 44), 3 Morceaux pour piano, Alsbach, Amsterdam 1902
1902 (opus 45), 3 Morceaux pour piano, Alsbach, Amsterdam 1902
1902 (opus 46), 3 Morceaux pour piano, Alsbach, Amsterdam 1902
1902 (opus 47), Polka enharmonique pour piano, Alsbach, Amsterdam 1902
1902 (opus 48), 3 Morceaux pour violon et piano, Alsbach, Amsterdam 1902
1902 (opus 49), Nocturne pour violon et piano, Alsbach, Amsterdam 1902
1902 (opus 53), Fantasia appassionata pour violon et piano, Alsbach, Amsterdam 1902
1902 (opus 58), 6 chanson de gestes, Foetisch, Lausanne 1902
1902, Concerto en ut mineur pour violon et orchestre, Alsbach, Amsterdam 1902
1902, La Mort du printemps sur un texte d'E. Jaques-Dalcroze pour soprano, piano ou orchestre, Foetisch, Lausanne, 1902
1902, Larmes, pièce lyrique soprano, piano et alto ou violoncelle, Foetisch, Lausanne, 1902
1902, Paysage sentimental sur un texte d'H. Duchosal, pièce lyrique pour soprano et piano ou orchestre à cordes, Foetisch, Lausanne, 1902
1902, Prélude pour piano, Siècle Musical, Genève 1902
1903 (opus 5), 6 Miniatures pour piano, Jobert, Paris 1903
1903 (opus 55), Le Festival vaudois, Musique de fête pour solistes, choeur et orchestre sur un texte d'émile Jaques-Dalcroze, Foetisch, Lausanne 1903
1903 (opus 56), Les chanson du coeur qui vole, Foetisch, Lausanne 1903
1903 (opus 57), Les Propos du père David la Jeunesse, chanson, Foetisch, Lausanne 1903
1903 (vers 1903-1905) (opus 66); Tableaux romands pour orchestre, (manuscrit)
1903, 6 petites Pièces pour piano (Transcriptions abrégées et simplifiées de la Sérenade pour quatuor à cordes), Foetisch, Lausanne 1899
1904 (opus 63-35), chanson de route (3 volumes), Foetisch, Lausanne 1904
1905 (opus 54), 10 Scènes d'enfants, chanpons, Foetisch, Lausanne 1905
1905 (opus 60), 1 0 nouvelles chanson avec gestes, Foetisch, Lausanne 1905
1905 (opus 61), Sérénade en six parties, quatuor à cordes, Foetisch Lausanne 1905
1905 (opus 67), 6 Bagatelles pour piano, Foetisch, Lausanne 1905
1905 (opus 75), Fleurs de mai (3 Lieder)Foetisch, Lausanne 1905
1905, 6 chanson napolitaines, Foetisch, Lausanne 1905
1906, 10 Miniatures pour piano, Foetisch, Lausanne 1906
1906, 3 Bluettes pour piano à 4 mains, Foetisch, Lausanne 1906
1906, 3 Esquisses pour violoncelle et piano, Foetisch, Lausanne 1906
1906, 3 Pièces faciles pour piano, Foetisch, Lausanne 1906
1906, Andante cantabile et rondo pour violon, violoncelle et piano, Foetisch, Lausanne 1906
1906, Canzone et allegro scherzando pour flûte, violon et piano, Foetisch, Lausanne 1906
1906, Fantaisie-Ballet pour piano à 4 mains, Foetisch, Lausanne 1906
1906, Le bel oiseau, cantate sur un texte d'é. Jaques Dalcroze pour chant, flûte et piano, Foetisch, Lausanne, 1906
1906, Le Bonhomme jadis, opéra-comique sur un livret de F. Mohain, Heugel, Paris 1906
1906, Petites Danses très faciles pour piano à 4 mains, Foetisch, Lausanne 1906
1906, Sonatine en sol majeur pour piano, Foetisch, Lausanne 1906
1906, 3 Historiettes pour violon et piano, Foetisch, Lausanne 1906
1906, 6 Miniatures pour piano, Foetisch, Lausanne 1906
1907, Idylles et chanson, Heugel, Paris 1907
1908, Les Jumeaux de Bergame, arlequinade dur un livret de M. Léna, Arlequinade, Heugel, Paris 1908
1909, chanson rustiques, Heugel, Paris 1909
1911, Poème, Concerto en fa mineur pour violon et orchestre, Simrock, Berlin 1911
1911, Suite de danses en la majeur pour orchestre, Simrock, Berlin 1911
1912, Chorlieder ohne Worte in Tanzform pour choeur mixte et piano, Simrock, Berlin 1912
1912, Echo et Narcisse, Musique de fête pour solistes, choeur et orchestre sur un texte de J. Chenevière
1913, 10 Lieder, Simrock, Berlin 1913
1913, 12 Danses pour piano, imrock, Berlin 1913
1913, 3 kleine Tänze pour piano, Rather, Leipzig 1913
1914 (vers 1914) I mpressions tragiques pour orchestre [manuscrit, Bibiothèque publique et universitaire de Genève]
1914, Psaume pour choeur mixte a cappella, Foetisch, Lausanne 1914
1914, La Fête de juin, pièce patriotique en 4 actes pour solistes, choeur et orchestre sur un texte de D. Baud-Bovy et A. Malche, Foetisch, Lausanne 1914
1916, Trois marches militaires pour piano, Heugel, Paris 1916
1918, Children's Songs pour piano, Augener, London 1918
1918, Les premiers Souvenirs, musiques de fête pour solistes, choeur et orchestre sur des textes de J. Chenevière et E. Jaques-Dalcroze) Heugel, paris 1918
1919, 10 Duos, chant et piano, Henn, Genève 1919
1919, 12 Rondes et ballades françaises, Henn, Genève 1919
1919, Chantons, dansons, chant et piano, Heugel, Paris 1919
1919, 8 chanson sur des etxte d'H. Spiess, Sonor, Genève
1920, Les helles Vacances, musique de fête pour solistes, choeur et orchestre sur un texte de P. Girard, Augener, London 1920
1920, Rythmes de danse 24 pièces brèves en 2 suites pour piano Heugel, Paris 1920
1922, En Famille (15 Lieder), Foetisch, Lausanne 1922
1922, Holà, Jean-Pierre pour choeur d'hommes, Foetisch, Lausanne 1922
1922, Rythmes de dance, quatuor à cordes, Heugel, Paris 1922
1923, La Cigale et la fourmi, Divertissement pour chant et piano sur un texte de M. Grange, Foetisch, Lausanne 1923
1923, La Fête de la jeunesse et de la joie, musique de fête pour solistes, choeur et orchestre sur un texte de Ch. Chenevière, E. Jaques-Dalcroze et P. Girard, Foetisch, Lausanne 1923
1924, 12 Nouvelettes et caprices , Senart, Augener, London 1924
1924, 3 Ballades françaises sur des texte de Paul Fort, Heugel, Paris 1924
1924, Echo du dancing pour violon, violoncelle et piano, Senart, Paris 1924
1924, Le coeur qui chante (12 Lieder), Senart, Paris 1925
1924, Le Coeur simple (8 Lieder), Heugel, Paris 1924
1924, Musique pour faire danser pour piano, Rouart Lerolle, Paris 1924
1924, Rythmes délaissés, 4 morceaux pour violoncelle et piano, Senart, Paris 1924
1924, 4 Danses frivoles pour violon et piano, Senart, Paris 1924,
1925, L'amour qui danse (12 Lieder), Senart, Paris 1925
1928, 12 Petites Images pour enfants pour piano, Au Grand Passage, Genève 1928
1928, 6 chanson pour Yvette, Heugel, Paris 1928
1928, Notre Pays, musiques de fête pour solistes, choeur et orchestre 1928
1928, Notre petite Vie à nous (24 chansons d'enfants et jeux), Au Grand Passage, Genève 1928
1928, Polka des boutons d'or pour piano (Ballet des narcisses), Heugel, Paris 1928
1929, Le Laboureur et ses enfants, Divertissement pour chant et piano sur un texte de M. Grange, Foetisch, Lausanne1929
1930, 6 chanson animées pour les enfants, Heugel, Paris 1930
1930, Jardin d'enfants, 12 petits jeux rythmiques pour piano, Heugel, Paris 1930
1931, 12 Ariettes et refrains, Heugel, Paris 1931
1931, 8 petits Dialogues, Heugel, Paris 1931
1931, Bourles et chanson de Romandie, Heugel, Paris 1931
1931, Les vieux et la vieille pour piano, Heugel, Paris. 1931
1932, La Nursery (chansons d'enfants), Delachaux & Niestlé, Neuchâtel 1932
1932, Le Jardin des mioches (7 chansons d'enfants), Delachaux & Niestlé, Neuchâtel 1932
1932, Le petit Roi qui pleure, conte musical en 3 actes sur un livret d'émile Jaques-Dalcroze, Henn, Genève 1954
1933, 3 rondos joyeux pour la danse pour piano, Heugel, Paris 1933
1933, Le Savetier et le financier, Divertissement pour chant et piano sur un texte de M. Grange, Foetisch, Lausanne, 1933
1934, 6 chanson du cru, Foetisch, Lausanne 1934
1934, Le joli Jeu des saisons, musique de fête pour solistes, choeur et orchestre sur un texte d' E. Jaques- Dalcroze, Henn, Genf 1934
1935, 12 chanson de gosses, Heugel, Paris 1935
1935, Au printemps fleuri, chanson, Foetisch, Lausanne 1935
1935, Ces bonnes Dames, Divertissement pour chant et piano sur un texte de M. Grange, Foetisch, Lausanne 1935
1935, Figurines, portraits et caractères pour piano, Heugel, Paris 1935
1935, Musique en zig-zags, 12 pièces pour piano, Senart, Paris 1935
1935, Notre Genève (16 Lieder), Henn, Genève 1935.
1935, Riguet à la Houpe, Divertissement pour chant et piano sur un texte de M. Grange, Foetisch, Lausanne 1935
1936, Entrons dans la Ronde (12 chansons d'enfants), Leduc, Paris 1936
1937, Des Jeux, des rondes, des chanson (18 chandsons d'enfants), Lemoine, Paris 1937
1937, Elle et lui (12 Lieder), Siècle Musical, Genève 1937
1937, Les trois Âges (18 chansons d'enfants), Leduc, Paris 1937
1937, Pour leurs petits doigts, 8 pièces expressives pour piano, Siècle Musical, Genève 1937
1938, chanson de la Nuit d'été pour choeur d'hommes, Henn, Genève 1938
1938, Chanson des Montagnards pour choeur d'hommes, Henn, Genève 1938
1938, Chanson en bleu et en rose, Leduc, Paris 1939
1938, On danse, on chant, on s'amuse (Kinderlieder), Heugel, Paris 1938
1940, 14 chanson du temps de guerre, Siècle Musical, Genève 1940
1941, 6 Danses romandes pour orchestre, Henn, Genève 1941
1941, Noël est revenu, Foetisch, Lausanne 1941
1985, Chez nous (21 Lieder)0, accompagnement de piano, Foetisch, Lausanne 1895
sd. (opus 17), Menuet pour piano op. 17, Janin, Lyon
sd. (opus 2), Romance pour violon et piano, Lerolle, Paris
sd. (opus 2a), Romance pour piano, Rouart Lerolle, Paris
sd. (opus 2b), Chant mélancolique pour piano, Rouart Lerolle, Paris
sd. (opus 2b), Chant mélancolique pour violon et piano, Lerolle, Paris
sd. 1 Lied, Alsbach, Amsterdam
sd. plusieurs quatuors à cordes
sd.(opus 8, n° 3), Valse caprice pour piano, Janin, Lyon
sd., 12 chanson dans le style populaire, Senart, Paris
sd., 2 Lieder, Simrock, Berlin
sd., 3 Nouvelettes pour flûte et piano, K & S, Leipzig
sd., 39 Lieder, Foetisch, Genève
sd., 6 chanson de route pour éclaireurs, J. Chester, London
sd., 7 Rhythmic Dances pour piano, Williams, London
sd., 8 Lieder, Rouart Lerolle, Paris
sd., Dans le août américain pour piano, Heugel, Paris
sd., Danse des lavandières pour piano (Album pour la jeunesse), Janin, Lyon
sd., Genève chante, extraits de diverse œuvres, pour choeur mixte et orchestre, Foetisch, Lausanne
sd., Le joli Bleu du lac pour choeur d'hommes, Heugel, Paris
sd., On sent qu'on aime son pays pour choeur mixte et choeur d'hommes, Siècle Musal, Genève
sd., Pièces pittoresques
sd., Quatuor à cordes en mi mineur, Enoch, Paris
sd., Souvenir du dancing pour piano, Heugel, Paris
sd., Suite de ballet en Fa majeur pour orchestre, Durant, Paris
sd., 1 Lied, Henn, Genève
sd., 1 Lied, Heugel, Paris
sd., 1 Lied, Siècle Musical, Genève
Méthodes, exercices
1913, 12 kleine melodische et rhythmische Studien, pour le piano, Simrock, Berlin 1913
1913, 16 plastische Studien, pour le piano, Simrock, Berlin
1920, 20 Caprices and Rhythmic Studies pour le piano, Augener, London 1920
1923, 50 Etudes miniatures de métrique et rythmique pour le piano, Senart, Paris 1923
sd., 10 mehrstimmen Gesange. ohne Worte zu plastischen Studien, Simrock, Berlin
sd., 3 Vocalises, Heugel, Paris
sd., 6 Exercises pratiques d'intonation, Foetisch, Lausanne
sd., 6 Jeux rythmiques pour enfants et adolescents pour le piano, Heugel, Paris
sd., 6 petites Pièces en rythmes alternés pour piano, Foetisch, Lausanne
sd., Esquisses rythmiques pour piano, Foetisch, Lausanne
sd., Exercises de disordination pour le piano, Enoch, Paris
sd., La jolie musique, jeux et exercises pour les tout petits (chant), Huguenin, Le Locle
sd., Marches rythmigues, chant et piano, Foetisch, Lausanne
sd., Métrique et rythmique, 200 études pour piano, Lemoine, Paris
sd., Moderne Tonleiterschule (avec R. Ruynemann), Chester, London
sd., Petites Pièces de piano avec instruments à percussion, Enoch, Paris
sd., Rythmes de chant et de danse, piano et chantHeugel, Paris o. J., Heugel. -
Écrits
Vorschläge zur Reform des musicalischen Schulunterrichts. Gealto Hugurich, 1905.
La Rythmique (2 volumes). Foetisch, Lausanne 1903 ; 1918
La portée musicale. Foetisch, Lausanne, sd.
Les gammes et les tonalités, le phrasé et les nuances (3 volumes), Foetisch, Lausanne 1907
La Bonne Chanson. Dans «Gazette Musicale de la Suisse Romande», Genève, 1er novembre 1894
La plastique animée. Foetisch, Lausanne
La respiration et l'innervation musculaire. Foetisch, Lausanne 1907
The Eurythmics of Jaques-Dalcroze. Constable & Company, London 1912
Le rythme, la musique et l'éducation, Paris 1920 ; 1935 [ Rhythmus, Musik et Erziehung. Benno Schwabe, Basel 1922]
Souvenirs, Notes et critiques. Attinger, Neuchâtel 1942
La Musique et nous. Notes de notre double vie, Perret-Gentil, Genève 1945
Notes bariolées. Jeheber, Genève 1948
Bibliographie
Bachmann Franz, Jaques-Dalcroze et seine Bestrebungen : eine Kulturstudie. Dans « Die Musik » (43), 1912, p. 13 et suivantes.
Bekker Paul, Die Dalcroze-Schule in Hellerau. Brandstetter, Leipzig 1912 [tiré à part d'un article du Frankfurter Zeitung du 21 juin 1912].
Berchtold Alfred, Emile Jaques-Dalcroze et son temps. L'Âge d'Homme, Lausanne 2000.
Bode Rudolf, E. Jaques- Dalcroze. Dans « Zeitschrift für Musik » (111), 1950, p. 421
——, Das rhythmische Problem und die Methode Jaques-Dalcroze. Dans « Singen, Sprechen, Musik der Leipziger Bugra », Dürr, Leipzig 1914.
Boepple Paul, Der Rhythmus als Erziehungsmittel pour das Leben et die Kunst : Sechs Vorträge von E. Jaques-Dalcroze zur Begründung seiner Methode der rhythmischen Gymnastik. Helbing & Lichtenhahn, Basel 1907.
Brève chronologie de la vie et de l'œuvre d'Emile Jaques-Dalcroze. Union internationale des professeurs de la rythmique Jaques-Dalcroze, Genève 1958.
BRUNET-LECOMTE HéLÈNE, Jaques-Dalcroze : sa vie, son œuvre. Jeheber, Genève ; Paris, 1950.
DESTRANGES LOUIS-AUGUSTIN, Une comédie lyrique française. Sanche d'Emile Jacques-Dalcroze. Genève 1897
Die Schulfeste der Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze Dresden-Hellerau. E. Diederichs, Jena 1912
Dohrn Wolf, Die Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze. Dresden 1912
émile Jaques-Dalcroze, le compositeur, le créateur de la rythmique. La Baconnière, Neuchâtel 1965
Feudel Elfriede, Die Geschichte der Bildungsanstalt Hellerau. Dans « Zeitschrift Zs. Rhythmische Erziehung » (III/IV) Berlin 1956, p. 3 et suivantes.
——, Rhythmische Erziehung. Möseler, Wolfenbüttel 1956 (2e édition).
Seidl Arthur, Die Hellerauer Schulfeste et die Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze. Dans « Deutsche Musikbücherei » (II), Bosse, Regensburg 1928.
Storck Karl, Jaques-Dalcroze. Seine Stellung und Aufgabe in unserer Zeit. Greiner & Pfeiffer, Stuttgart 1912.
Tappolet Willy, E. Jaques- Dalcroze 1865-1950. Dans « Schweizerische Musikzeitung » (90), 1950, p. 433.
Wolonsky Serge, Erinnerungen. Dans « La Tribune de Genève » 25 juillet 1950.
Discographie
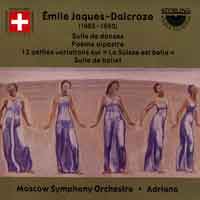 Émile Jaques Dalcroze,
Suites de danse,
Poème alpestre,
13 petites variations sur«La Suisse est belle»,
Suite de ballet, Orchestre Symphonique de Moscou, Adroano, dir.
Émile Jaques Dalcroze,
Suites de danse,
Poème alpestre,
13 petites variations sur«La Suisse est belle»,
Suite de ballet, Orchestre Symphonique de Moscou, Adroano, dir.
Enregistré à Moscou en août 2003
Sterling CDS-1057-2 [notice]
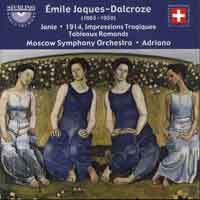 Émile Jaques Dalcroze,
Janie (Idylle musicale en trois actes),
1914, Impressions tragiques,
Tableaux Romands,
Orchestre Symphonique de Moscou,
Adriano, dir.,
Enregistré en août 2004,
Sterling, CDS-1065-2 [notice ]
Émile Jaques Dalcroze,
Janie (Idylle musicale en trois actes),
1914, Impressions tragiques,
Tableaux Romands,
Orchestre Symphonique de Moscou,
Adriano, dir.,
Enregistré en août 2004,
Sterling, CDS-1065-2 [notice ]
Jean-Marc Warszawski
15 juillet 2005
Ajout de discographie et petites corrections du catalogue : 2 août 2005.
 À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41
ISSN 2269-9910.
Dimanche 28 Décembre, 2025