Brille, brille, mon étoile !
« Brille, brille, mon étoile ! » est sans conteste une des romances russes les plus connues, en Russie comme à l’étranger. La voici dans sa forme originale, la plus simple et telle qu’elle est chantée par Anna German : les trois strophes sont des quatrains transformés en sizains par la répétition des deux derniers vers de chaque strophe et le dernier vers reprend le premier.
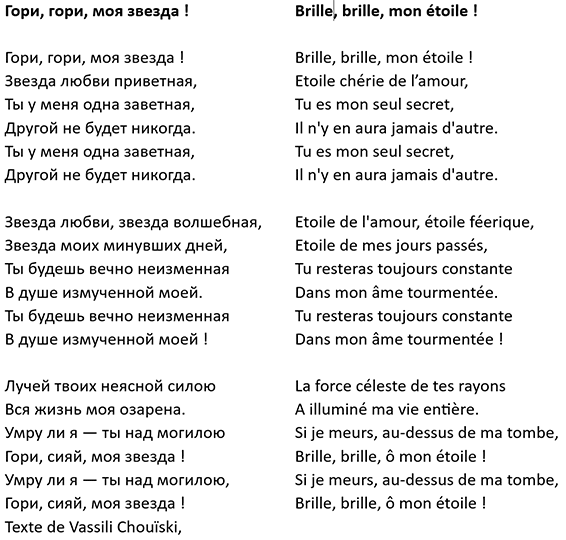
Texte de Vassili Tchouevski, musique de Piotr Boulakhov
Brille, brille, mon étoile ! Anna German, 1977 ? Anna German. Photographie © PAP/Janusz Uklejewski.
Anna German. Photographie © PAP/Janusz Uklejewski.
Ci-dessous une variante qui ne garde de la version précédente que le quatrain initial et la phrase conclusive de deux vers, les quatrains suivants étant nouveaux et dépourvus de répétition.
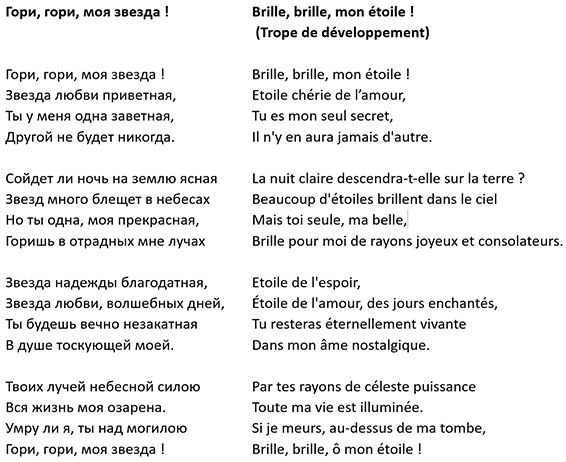
On peut mesurer la popularité de « Brille, brille, mon étoile ! » au nombre d’arrangements qui en ont été faits et des légendes qui l’enÀA l’origine, il s’agit certainement uniquement de « l‘étoile de l’amour » car le texte paraît sans équivoque, mais son incroyable succès la fera prêter le flanc à une double récupération politique au début du xxe siècle après une période où on lui prêtera une très importante signification astronomique au milieu du xixe siècle, à l’époque même de sa création.
Cette admirable chanson existe en effet depuis soixante-dix ans avant la révolution d’Octobre. On considère aujourd’hui comme un fait à peu près certain qu’elle a été écrite à la fin de 1846 et publiée pour la première fois en 1868. On peut résumer comme suit ce que l’on sait de sa genèse. Au mois de janvier 1847 a lieu le 700e anniversaire de Moscou et, à l’approche de Noël 1846, on s’y prépare en organisant divers événements parmi lesquels des concours de création artistique. Quelque temps auparavant, le 31 août 1846, l'astronome français Urbain Le Verrier avait conclu ses recherches sur les planètes commencées en 1844 en découvrant par le calcul Neptune, huitième planète du système solaire, une découverte confirmée dans la nuit du 23 au 24 septembre 1846 par l’Allemand Johann Gottfried Galle à l’Observatoire de Berlin qui se fonde sur les calculs de Le Verrier pour savoir où pointer son télescope1. À l’occasion de la préparation du 700e, un étudiant de la faculté de droit de l'université de Moscou, Vladimir Tchouevski, prend part au concours (sans succès apparemment puisqu’il n’en subsiste aucune trace officielle) et écrit le texte qui célébrerait donc soit l’étoile de Noël, soit la planète Neptune. Bien qu’on ignore tout de la vie de Tchouevski, on sait cependant qu’il devient par la suite l’un des principaux et des meilleurs auteurs de textes de romances de son époque, qu’il se lie avec le compositeur Dubuque avec lequel il écrit de nombreux recueils et qu’il collabore avec Piotr Petrovitch Boulakhov (Moscou, 1822 – Kouskovo, 2 décembre 1855)2, une personnalité aussi célèbre et presque aussi mystérieuse que la sienne. Ce que l’on sait de la vie de ce dernier tient donc aussi en peu de mots. Fils, frère et père de grands chanteurs d’opéra, ce remarquable compositeur dont Franz Liszt transcrira plusieurs œuvres écrit un très grand nombre de romances (une centaine environ mais on ne peut en donner le chiffre exact car d’une part on confond encore nombre d’entre elles avec celles de son frère Pavel (1824-1875), ténor d’opéra, qui portait les mêmes initiales (en russe on se contente souvent de limiter le prénom et le patronyme à leurs initiales au lieu d’écrire le prénom en toutes lettres comme on le fait chez nous) et d’autre part une partie de sa production a été détruite dans l’incendie de sa maison au cours des années 1870). Parmi celles qui ont survécu, les plus célèbres sont В минуту жизни трудную (« Dans un moment difficile de la vie »), en 1856, sur la célèbre « Prière » de 1839 de Mikhaïl Lermontov que plus d’une centaine de compositeurs russes ont mises en musique, Выхожу один я на дорогу (« Je vais seul sur la route »)3, Тройка мчится, тройка скачет » (« La troïka se précipite, la troïka galope »), Колокольчики мои (« Mes petites cloches »), Нет, не люблю я вас (« Non, je ne t'aime pas »), Не пробуждай воспоминанья (« Ne réveille pas les souvenirs ») , Вот на пути село большое (« Il y a un grand village sur le chemin »), etc. Piotr Boulakhov est aussi connu pour les vicissitudes de sa vie : paralytique, il voit ses biens et de nombreux manuscrits disparaître dans l’incendie mentionné supra. Recueilli par le comte Cheremetev, il passe les dernières années dans son domaine de Kouskovo.
В минуту жизни трудную (« Dans un moment difficile de la vie »), par Nadezhda Obukhova (1886-1961).C’est à la révolution que Brille, brille, mon étoile acquiert une signification politique. Avant de devenir célèbre parmi les « Rouges », elle a un immense succès chez les « Blancs » et des rumeurs circulent parmi leur intelligentsia qui prétendent que le texte en est dû à leur chef, l'amiral Koltchak. Cette affirmation reposait sur divers fondements qui, pris tous ensemble, paraissaient convaincants alors qu’il ne s’agissait que de pures inventions : des compositeurs émigrés affirmaient avoir vu l'autographe de l'amiral sur la partition de la romance ; d’autre part, on savait que Koltchak, océanographe et géographe polaire, dirigeait ses expéditions dans le cercle arctique en suivant l'étoile polaire et l’on croyait même qu’avant d'être fusillé par le « Rouges » le 7 février 1920 à Irkoutsk, il avait longuement regardé l'étoile polaire et chanté « Brille, brille, mon étoile », sa romance préférée ; enfin, on lui attribuait des talents musicaux et l’on prétendait qu’il jouait admirablement du piano et avait souvent interprété cette romance. Mais ceux qui croyaient naïvement à cette attribution se trompaient lourdement, Koltchak n'avait rien à voir avec cette romance. Cependant, on ne l’entendit jamais protester contre cette affirmation, peut-être parce qu’elle servait la propagande des Blancs auxquels elle servait de chant de ralliement. Mais les légendes sont des créations immortelles qui renaissent incessamment sous d’autres formes à peine a-t-on démontré leur fausseté : on attribua alors le texte à deux autres célébrités littéraires (on ne prête qu’aux riches) appartenant eux aussi au parti des « Blancs » , Ivan Bounine (Voronej, 10 / 22 octobre 1870 – Paris, 8 novembre 1953), lauréat du prix Nobel de littérature en 1933 et au mari d’Anna Akhmatova, Nikolaï Stepanovitch Goumiliov (Kronstadt, 3 avril 1886 - près de Saint-Pétersbourg, exécuté le 16 août 1921).
Puis vient l’époque des Rouges et l’étoile blanche devient l’étoile rouge qui aura le succès que l’on sait dans tous les pays communistes de la planète. Mais c’est surtout dès le début de la Première Guerre mondiale que commence la grande vague de popularité de la romance. Le chanteur d’opéra, d’opérette et auteur-compositeur de romances Vladimir Alexandrovitch Sabinine (de son vrai nom Sobakine, 23 mai 1885- Leningrad, 12 mai 1930) s'enrôle comme volontaire et combat sur le front dans le régiment des hussards d'Alexandrie. Il retouche légèrement le texte de la romance et en fait son propre arrangement (i. e. l’arrangement cité sopra), le premier que l’on connaisse même si des dizaines d’autres suivront. Dans son interprétation, l'« étoile chérie » représente toujours la patrie, mais il s’agit cette fois de celle des vainqueurs. Sabinine chante la romance modifiée dès 1914 devant des assemblées de soldats qui l’adoptent aussitôt comme symbole de leur lutte, de sorte que les combattants des deux camps s’entretuent pendant quelque temps au son de ce qui est grosso modo la même chanson. En 1915, des disques de l'enregistrement de Sabinine apparaissent dans les magasins de musique et la vogue de cette romance s’étend dans tout le pays. Le succès en est tel que l'interprétation « académique » de cette romance reste, aujourd’hui encore, basée sur cet arrangement. La victoire des révolutionnaires et la mort de Koltchak en 1920 consacre ce changement d’attribution. Le nouveau gouvernement décide cependant dans un premier temps d’interdire la chanson parce que l’on se souvient de son passé de romance de la Garde blanche. Mais sa popularité ne cessant de s’étendre comme chant patriotique des révolutionnaires, son interdiction reste lettre morte et la romance est interprétée publiquement par des coryphées de l’art du chant tels qu'Ivan Kozlovski et Sergueï Lemechev.
Гори, гори, моя звезда ! / Brille, brille, mon étoile !, par Dmitri Hvorostovsky, 2007.![]() François Buhler
François Buhler
15 mars 2025
1. En fait, la planète Neptune avait été découverte deux siècles plus tôt, le 28 décembre 1612, par Galilée, comme le démontrent ses dessins astronomiques. Mais il la répertoria comme une étoile de magnitude 8. L’ayant de nouveau aperçue un mois plus tard, le 28 janvier 1613, il constata même qu'elle avait bougé par rapport à une étoile voisine, ce qui aurait dû suffire à lui faire conclure qu’il ne pouvait s’agir d’une étoile. Mais il n’en tira aucune conclusion et, comme il n'en reparla plus par la suite, il ne peut être crédité de sa découverte. Le commun continuant à confondre les étoiles et les planètes, on peut supposer que le terme d’« étoile » de la romance a été choisi parce qu’il était beaucoup plus poétique que celui de planète et que la différence, toute scientifique, n’importait à personne dans un concours artistique.
2. Concernant Tchouevski et Boulakhov, voir François Buhler, Prélude au siècle d’or de la poésie et de la musique russes, Paris, 2022, Publibook, ISBN 978-2-342-35864-3.
3. Il existe cependant aussi une romance de même titre et du même poète dont on attribue la musique composée en 1861 à Elizaveta Chachina. Il est très possible qu’il y ait là un exemple de cette confusion générale sur les œuvres de Piotr Boulakhov dont nous parlons. S’il existe bien deux musiques différentes sur ce texte, on ne sait à qui attribuer celle qu’Anna a chanté.




 À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.
ISSN 2269-9910.

Mercredi 5 Novembre, 2025

