La messe à coucher dehors de Bernard Cavanna
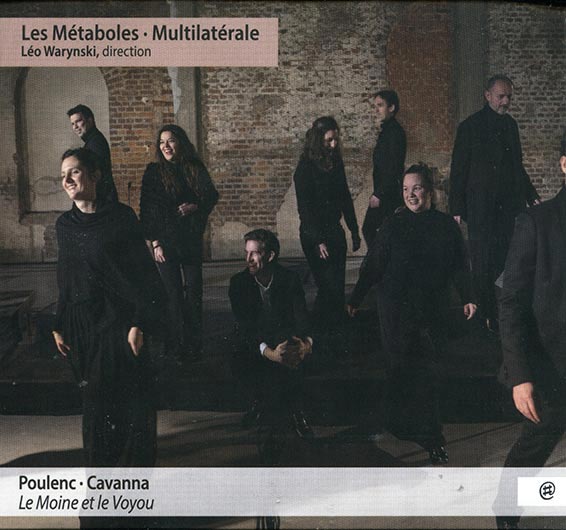
Les Métaboles, Multilatérale, sous la direction de Léo Warynski, Le moine et le voyou : Francis Poulenc, Un soir de neige, cantate profane, Quatre motets pour un temps de pénitence, Exultate Deo, motet pour les fêtes solennelles ; Bernard Cavanna, Messe, un jour ordinaire. Nomad Music 2022 (NMM 113).
Enregistré en mai 2022, Arsenal, Cité de la musique de Metz.
Messe, un jour ordinaire de Bernard Cavanna passe pour une de ses œuvres les plus abouties, mais également pour une pièce majeure du répertoire contemporain.
Cette œuvre a été commanditée par le ministère de la Culture, mais c’est un long métrage documentaire de Jean-Michel Carré, Galères de femmes, sept portraits de femmes tentant de se réinsérer après avoir été emprisonnées à Fleury Mérogis, qui a été, en 1993, la Révélation pour le compositeur. Particulièrement la séquence consacrée à Laurence, toxicomane, atteinte du sida, à la recherche désespérée d’un logement (elle est morte d'une overdose au cours du tournage).
Messe, un jour ordinaire, pour solistes, double chœur et ensemble instrumental de 10 à 25 instruments (dont 3 accordéons) a été créée au Festival Musica de Strasbourg de 1994, avec Terence Roberson (ténor), Isa Lagarde (soprano), l’ensemble Les Jeunes Solistes, sous direction de Rachid Safir. La version révisée a été créée à La Rochelle en avril 1996, avec Terence Roberson (ténor), Isa Lagarde (soprano), Peggy Bouvret (soprano), l’ensemble vocal de l'Abbaye-aux-Dames, sous la direction de Michel Laplénie, l’ensemble Ars Nova, sous la direction de Philippe Nahon. Deux ans plus tard est paru un enregistrement (MFA 1998) pour trio avec accordéon, avec Noémie Schindler (violon), Christophe Roy (violoncelle) et Pascal Contet (accordéon).
Pour fêter le 30e anniversaire de la création, voici Messe, un jour ordinaire encédée par Noëmi Schindler (violon), Isabelle Lagarde (soprano), Émilie Rose Bry (soprano), Kiup Lee (ténor), les ensembles Les Métaboles et Multilatérale, sous la direction de Léo Warynski.
Messe, un jour ordinaire n’est pas une messe, mais une scène dramatique ou se croisent et s’opposent en effet l’ordinaire de l’office religieux, ici réduit aux Kyrie, Gloria, Credo, et les prières (demandes), reprises du film de Jean-Michel Carré, que Laurence adresse à ses interlocuteurs de l’association caritative. Un jour ordinaire pour une femme en déshérence ayant besoin d’aide, contre une messe basique. Une confrontation propice aux possibilités expressives qui va au-delà de l’opposition thématique classique, qui n’en est pas vraiment une.
Ne nous arrêtons pas à l’effet comique superficiel qui surgit de ce conflit surréaliste, ce serait mettre beaucoup d’énergie pour une galéjade entre olives est anisette, ni même à l’apparente provocation. Nous sommes de la même génération que Bernard Cavanna, en mieux espérons-le, une génération qui a cultivé cet art au plus haut niveau à en être blasée. On est plutôt ici dans l’art de l’absurde qui en dit tant plus que de longs discours. De ce fait, on revient à une pratique du grand classicisme français où le livret, à l’opéra, avait une importance primordiale, d’autant qu’il n’y a ici aucune action pour soutenir la compréhension, on raconte, on raconte même une inaction.
C’est à la fin du Kyrie, dans l’apparat théâtral de l’office que la prière des plus terre à terre de Laurence apparaît : Ça vous dérange si je fume ? Pour Bernard Cavanna, Laurence est l’élément perturbateur qui fait tomber la messe en quenouille. Mais nous imaginons quelque chose de plus hégélien, que la messe porte en elle-même l'invitation à l’hystérisation, la répétition des mêmes formules, les mélismes sur les syllabes, la désarticulation des mots, l’obsession répétitive sur les syllabes, comme dans des comptines enfantines, les analogies assonantes... Il ne faut pas trop pousser pour que cela devienne risible de loin et dramatique de plus près. Il faut par exemple avoir vu les décors morbides, effroyables, surchargés, ne laissant aucun centimètre carré vierge, des églises portugaises et de vieilles dames faisant la tournée des saints de bois et plâtre peins, marmonnant devant chacun d’eux des prières canoniques, aussi certainement personnelles, baisant leurs pieds à plusieurs reprises, pour se convaincre de l’artificialité (de l’impasse) qui lie les promesses lumineusement célestes de l’après aux petites et grandes peines humaines de l’avant, et on ne sait alors s’il faut en rire ou en pleurer.
Bernard Cavanna a résolu cette contradiction non par l’opposition des deux thèmes avec strette de la réconciliation au dernier mouvement, voire fugue amoureuse, comme il se doit, mais en une spirale dialectique, le développement portant en lui sa propre contradiction, le fruit est assez mûr, puisque l’effritement apparaît dès le Kyrie, une destruction donnant naissance à quelque chose de nouveau.
Messe, un jour ordinaire ne serait pas le chef-d’œuvre qu’elle est s’il n’y avait pas la musique virtuose pour la légitimer sans appel. D’abord par sa magnificence sonore cohérente, toujours en combinaisons renouvelées. Aussi cette impression de nappe immobile, mais agitée de sonnailles, de cloches, de percussions, d’où émane une atmosphère d’inquiétude, de danger, et sur laquelle se développe une somptueuse et luxuriante action instrumentale et vocale, d’une immense expressivité qui ne faiblit pas d’une mesure au long de ses trente minutes, même dans les épisodes plus méditatifs, on reste en attente et en tension. Les effets théâtraux sont puissants, notamment dans les tutti chorals, l’intervention colorée des cuivres, les babillages de la clarinette ou ici et là, les commentaires du tuba, les interventions solistes et leurs frottements avec les prières de Laurence.
C’est une partition certainement difficile à mettre en place, elle est aussi difficile à suivre, avec une contradiction entre œil et oreille, une écriture tout en détails méticuleux en mobilité des voix, très polyphonique, et la plénitude sonore continue. Ça sonne chante la soprano (... mais ça ne répond pas, ajoute Laurence dans le film) à six reprises dans le Kyrie et une fois en conclusion du Credo. Côté musique, ça sonne tout du long. Généreusement.
La seconde opposition, riche de possibilités esthétiques, est que la solide structure musicale se maintient alors que le texte de la messe tourne à la folie et à la violence verbale. Parce que la désintégration dialectique de la messe, la négation de la négation, débouche sur une révolution (de spirale) inquiétante, qui peut évoquer le film Proba d’orchestra de Federico Fellini, une répétition d’orchestre perturbée par divers éléments contradictoires, qui tourne à la catastrophe et où le chef d’orchestre finit par haranguer les musiciens comme un clone d’Hitler. L’hystérisation de la messe avant la débandade nous a évoqué une autre image cinématographique forte issue d’Alexandre Nevski de Sergueï Eisenstein, quand les chevaliers teutoniques se replient régulièrement pour prier dans une atmosphère de messe des fous.
Mais « si on va au bout » (il semble que la messe puisse s'arrêter avant), jusqu’au court épilogue énigmatique sur les Marie salopes, barges draguant la vase des ports, nous pensons cette fois à un roman de Boris Vian, l’Arrache cœur, dans lequel le personnage La Gloïre, nettoie avec les dents le ruisseau du village, du fruit des mauvaises actions que les habitants y jettent pour se débarrasser de leur honte.
20 août 2024.




 À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41..
ISSN 2269-9910.

Lundi 24 Mars, 2025 14:24

