Aleko de Rachmaninov : analyse et nouvelle traduction du livret
Introduction —— Genèse de l'œuvre —— Les tziganes et l'orientalisme dans la littérature française et russe du XIXe siècle —— Les topoï romantiques de la liberté, du bonheur et du destin dans Les Tziganes de Pouchkine et l'Aleko de Nemirovitch-Dantchenko —— Les Tziganes de Pouchkine et l'Aleko de Nemirovitch-Dantchenko : quelles différences ? —— « Retour » de l'influence vériste subie : l'impact d'Aleko sur I Zingari de Leoncavallo. —— Nécessité d'une révision de la traduction du livret —— Le livret.
Introduction
Aleko est un opéra en un acte de Sergueï Vassilievitch Rachmaninov1sur un livret de Vladimir Nemirovitch-Dantchenko d'après le poème de Pouchkine2 Цыганы (Les Tziganes) publié en 1824, composé de la dernière semaine de mars 1892 au 13 avril de la même année et créé à Moscou au Théâtre Bolchoï le 27 avril / 9 mai 1893 avec Bogomir Korsov (Aleko), Maria Deicha Sionitzkaïa (Zemfira), Stepan Vlassov (le vieux tzigane), Lev Mikhaïlovitch Klementiev (le jeune tzigane) et Elizaveta Choubina (la vieille tzigane) sous la direction d'Ippolite Altani. Peu après, le 18 / 30 octobre de la même année, il est redonné à Kiev sous la direction du compositeur dont c'est la première apparition publique comme chef d'orchestre. Aleko est le premier des trois opéras composés par Rachmaninov, les deux suivants étant Le chevalier avare et Francesca da Rimini3. Il contient treize numéros. Parmi les influences subies, il faut citer deux œuvres créées en 1890, La Dame de pique de Tchaïkovski, dont la première a lieu au Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg le 7 / 19 décembre 18904 et surtout Cavalleria rusticana de Mascagni, représentée à Moscou au printemps de 1891 puis une nouvelle fois à la fin de mars 1892, soit exactement au moment où Rachmaninov travaille à son opéra5.
Le scénario de Nemirovitch-Dantchenko, identique à celui de Pouchkine malgré les énormes coupures pratiquées dans le poème, possède les mêmes caractéristiques véristes fondamentales que Cavalleria rusticana, dont la simplicité de la trame : un jeune gentilhomme russe au passé mystérieux fuit la civilisation pour la vie errante et libre des tziganes de Bessarabie. Resté prisonnier de ses passions, il sera bientôt banni de la tribu pour avoir refusé à sa jeune épouse infidèle la liberté dont les tziganes ont fait leur seule loi et assassiné les deux amants pour venger ce qu'il n'a jamais cessé de considérer comme « ses droits » maritaux.
Les quelques commentateurs qui se sont intéressés à cet opéra ne semblent pas avoir remarqué que Rachmaninov, avant d'écrire Aleko, a déjà abordé un thème similaire à deux reprises, la première fois en 1888 alors qu'il n'a que 15 ans et qu'il s'intéresse fugitivement à un sujet d'opéra dont il ne reste que quelques ébauches, Esmeralda d'après Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Dans le roman, la condamnation au gibet de la gitane Esmeralda est en fait un meurtre perpétré par Frollo pour un motif semblable de jalousie amoureuse. Un peu plus tard, environ un an avant Aleko, Rachmaninov met en musique le monologue d'Eugène Arbénine tiré de Mascarade, le drame en 4 actes que Mikhaïl Lermontov écrit en 1835. Arbénine est lui aussi en quête de liberté et d'indépendance, mais dans un cadre très différent, celui de la haute société pétersbourgeoise à laquelle il appartient par la naissance et l'éducation. Convaincu d'avoir été trompé par sa femme, laquelle est pourtant innocente, il la tue par jalousie et pour défendre son honneur.
L'intérêt que Rachmaninov conserve toute sa vie pour les tziganes et leur musique remonte vraisemblablement à une période précédant la composition d'Aleko. Or, à l'époque de l'opéra, il tombe sous le charme d'une femme mariée d'origine tzigane, Anna Alexandrovna Ladyjenskaïa, son aînée de cinq ans, dont le mari, Piotr Viktorovitch Lodyjenski, se voit tout d'abord dédier le Capriccio opus 12 sur des thèmes tziganes (1892-1894) avant que Rachmaninov n'ose, sans la nommer expressément, dédier à « A. L. » elle-même sa romance « Oh non, je t'en supplie, ne me quitte pas » puis sa première symphonie. On sait d'autre part que Rachmaninov ne se lassait pas d'entendre la sœur d'Anna, Nadejda, une chanteuse bien connue de romances tziganes.
Il est devenu aujourd'hui très rare d'entendre Aleko et plus encore, les deux autres opéras de jeunesse de Rachmaninov, ceci pour plusieurs raisons, dont deux au moins paraissent essentielles. D'une part, l'énorme succès de la production pianistique de Rachmaninov occulte très tôt le reste de son œuvre et d'autre part, les reproches émis par divers commentateurs sur les livrets de ces trois œuvres sont légion et paraissent en partie justifiés. Les critiques pleuvent en particulier sur celui du Chevalier avare, dont le texte de Pouchkine, fait pour être lu, n'aurait jamais dû être transporté à la scène sans adaptation, certaines de ses caractéristiques devenant au théâtre des défauts rédhibitoires, tels que son manque d'intérêt dramatique, une absence totale de personnages féminins, un monologue central qui couvre plus du tiers de la partition, un personnage d'usurier juif ouvrant la porte à des accusations faciles d'antisémitisme, etc. Le livret de Francesca da Rimini, malgré ses qualités, souffre des graves problèmes de collaboration entre Rachmaninov et Modeste Tchaïkovski. Rachmaninov voit les défauts, demande des corrections qu'il n'obtient pas, délaisse la partition pour celle du Chevalier puis y revient une fois celui-ci achevé sans que la collaboration se passe mieux. En revanche, bien que certains commentateurs déplorent également le manque d'action du livret d'Aleko, qui ne suscite aucune véritable tension à l'exception de deux scènes vraiment dramatiques (les deux affrontements entre Aleko et Zemfira), le texte de Pouchkine, beaucoup plus statique que le livret de Nemirovitch-Dantchenko puisqu'il est beaucoup plus long sans qu'aucune scène d'action n'ait été supprimée, est ici adapté par un véritable homme de théâtre qui parvient à maintenir une continuité et une logique de l'action qui n'existent pas dans l'original, notamment en inversant certains événements et en annulant par des moyens subtils les ruptures inhérentes à la forme « à numéros ». La partition, d'autre part, est une grande réussite dans laquelle le jeune compositeur fait preuve déjà d'un vrai tempérament lyrique. Ses dons de mélodiste qui s'affirmeront plus tard dans ses mélodies y font déjà merveille et surtout, aidé en ceci par son librettiste, il y montre un sens de la scène d'une étonnante maturité. Œuvre d'étudiant écrite pour obtenir son diplôme de composition, son opéra est jugé si remarquable par le principal examinateur, Piotr Ilytch Tchaïkovski, qu'il lui vaut la grande médaille d'or du Conservatoire, dont il est le troisième bénéficiaire après Taneiev et Korochenko, une inscription au tableau d'honneur du Conservatoire, c'est-à-dire sur la plaque de marbre à l'entrée de la grande salle et une note d'examen dont il n'existe vraisemblablement aucun autre exemple dans l'histoire de la musique, si toutefois il ne s'agit pas d'une légende. Le système de notation scolaire n'allant en Russie que jusqu'à 5, Tchaïkovski non seulement lui décerne la mention d'excellence, 5+, mais entoure « le chiffre 5 de + de tous les côtés »6. C'est grâce à sa chaude recommandation que l'œuvre sera créée au Théâtre Bolchoï l'année suivante. De plus, son ancien maître, Zverev7, avec lequel Rachmaninov avait pourtant eu un grave différend, le prend à part et lui fait cadeau de sa montre en or, que Rachmaninov gardera toute sa vie. On peut affirmer sans aucune exagération que c'est Aleko qui lance la carrière de Rachmaninov.
 Rachmaninov en 1892, à l'époque d'Aleko
Rachmaninov en 1892, à l'époque d'Aleko
Genèse de l'œuvre
A l'époque de la composition, Rachmaninov est un jeune homme d'à peine 19 ans qui, malgré sa jeunesse et le fait qu'il soit encore étudiant, a déjà produit un nombre d'œuvres impressionnant8. Elève de la classe supérieure de composition d'Anton Stepanovitch Arenski et de celle de contrepoint de Sergeï Ivanovitch Taneiev au Conservatoire de Moscou, il doit composer, pour obtenir son diplôme, une symphonie, plusieurs morceaux de chant et un opéra. Le choix du jury s'étant porté sur Aleko, Rachmaninov en compose la musique en dix-sept jours. Nous pouvons suivre les étapes de la gestation grâce aux lettres qu'il adresse à Natalia Dmitrievna Skalon. La première est datée du 18 février / 2 mars : « Au Conservatoire, le jour de l'examen de la classe de théorie de dernière année est déjà fixé. C'est le 15 avril qui sera le jour important pour moi. Le 15 mars [en fait le livret ne lui parviendra qu'un peu plus d'une semaine plus tard et, en conséquence, la date d'examen sera elle aussi ajournée] ils nous remettront le sujet d'un opéra en un acte. Comme tu vois, je devrai le composer, le mettre au net et l'orchestrer en un mois. [Ce ne sera] pas une petite affaire […] »9 Le 23 mars, Rachmaninov, qui a déjà bien avancé le travail de composition, lui écrit : « Le livret provient du poème de Pouchkine Les tziganes rédigé par Vlad. Nemirovitch-Dantchenko. Le livret est très bien fait. Le sujet est merveilleux. Je ne sais pas si la musique sera merveilleuse ; […] Deux danses sont déjà prêtes. »10 Nouvelle lettre le 30 avril : « Nous n'avons pas eu d'examen le 15 avril et ne pouvions pas en avoir un car le livret ne nous a été remis que le 26 mars […] J'ai fini mon opéra le 13 avril. » L'examen a finalement lieu le 7 / 20 mai 1892 et les trois candidats, Sergueï Rachmaninov, Léonide Conus et Nikita Morozov le réussissent. Mais alors que les Aleko de ses deux condisciples sombrent immédiatement dans l'oubli, celui de Rachmaninov est jugé si remarquable que les droits en sont presque aussitôt achetés par l'éditeur moscovite Karl Gutheil11 qui, jusqu'à sa mort en 1914, publiera la quasi-totalité de l'œuvre de Rachmaninov et une première représentation officielle est prévue pour la saison suivante. Le 10 juin 1892, le jeune compositeur écrit à Natalia Skalon : « Mon opéra Aleko a été accepté au Théâtre Bolchoï de Moscou. Il est prévu de le représenter après le Carême. Pour moi la représentation sera à la fois agréable et désagréable. Agréable car ce sera une bonne leçon de voir mon opéra sur scène et mes fautes théâtrales. Désagréable car cet opéra est voué à l'échec. Je dis cela en toute sincérité. Les choses sont ainsi, tout simplement. Tous les premiers opéras de jeunes compositeurs connaissent l'échec, et ceci pour la raison suivante : ils contiennent une multitude d'erreurs que l'on ne peut corriger parce qu'aucun de nous ne comprend [encore] vraiment la scène […] »
La première du 27 avril / 9 mai 1893 est pourtant un succès même si certains critiques émettent quelques réserves. Le critique musical du journal Moskovskie vedomosti écrit le 29 avril : « Aleko est une composition de grand talent mais c'est l'œuvre d'un compositeur novice qui n'est de ce fait pas exempte de quelques défauts résultant de son inexpérience : pour un jeune homme qui était encore assis sur les bancs de l'école au moment où il a écrit son opéra, c'est inévitable. L'un de ces défauts est le manque de cohérence entre les numéros séparés et les scènes. Presque chaque scène se termine brusquement et d'une façon abrupte ; la scène suivante commence alors immédiatement, sans laisser le moindre répit à l'auditeur. Un compositeur plus expérimenté aurait certainement aplani ces aspérités et ménagé des « ponts » entre les numéros facilitant le passage d'une atmosphère à l'autre. » Il ajoute cependant plus loin : « Bien sûr il y a des défauts mais ceux-ci sont largement compensés par les mérites, ce qui laisser penser qu'on peut attendre beaucoup de ce jeune compositeur à l'avenir ».
 A. S. Arenski (debout) et ses trois élèves candidats à l'examen :
A. S. Arenski (debout) et ses trois élèves candidats à l'examen :
Léonide Conus, Nikita Morozov et Sergueï Rachmaninov.
Les tziganes et l'orientalisme dans la littérature française et russe du XIXe siècle
L'évocation des tziganes dans les arts, phénomène romantique s'il en est, ne date pas pourtant pas du XIXe siècle et ses premières manifestations ne se limitent ni à la France ni à la Russie qui en deviendront cependant vite les hauts-lieux. Il suffit pour s'en rendre compte de penser à quelques figures de romans célèbres antérieures au XIXe siècle, telles que la Preciosa de La Gitanilla de Cervantes en 1613 par exemple, ou la Mignon de Goethe des Années d'apprentissage de Wilhelm Meister, 1795-96), ou à la littérature anglaise avec les Poèmes orientaux de Byron en 1813 (Le Giaour et La fiancée d'Abydos) ou Guy Mannering de Walter Scott en 1815 dont le personnage égyptien12 de Meg Merrilies est directement inspiré par la gitane Jean Gordon. Cette apparition des tziganes dans la littérature mondiale est indissociable du mouvement de l'orientalisme qui touche tous les arts et contamine la plus grande partie des artistes, poussant les uns, à Paris par exemple, à tenter d'échapper par le rêve à la société de leur époque dont ils dénoncent le moisi interne et sa conséquence, le spleen, en voyageant en imagination dans un Orient de pacotille, confortablement adossés aux coussins moelleux des salons d'une capitale qu'ils ne troqueraient pour rien au monde contre l'inconfort, les fatigues et les dangers d'un voyage en voiture de poste et jetant néanmoins des centaines d'autres sur les chemins à la recherche de l'aventure, du soleil et des grands espaces qui, comme pour les voyageurs d'aujourd'hui, leur permettent de fuir quelque temps la laideur du monde urbain, la grisaille des villes du Nord caractérisant cette époque de début d'industrialisation massive. Mais que le « voyage » soit imaginaire ou réel, ce qui importe pour les uns comme pour les autres c'est l'évasion, la fuite par le grand rêve romantique, le mirage, l'illusion d'un au-delà meilleur, d'une autre vie, de la liberté sans frein et sans limites, du bonheur absolu, c'est l'invitation au voyage dans un pays imaginaire ou réel où tout paraît luxe, calme et volupté, hors des « chaînes de la civilisation ». Avant que certains ne se mettent en route, l'Orient n'est tout d'abord pour tous qu'un « ailleurs » dont la situation géographique importe d'autant moins que son imprécision ou son irréalité donne des ailes à l'imagination ; pour un Parisien, est « oriental » tout ce qui est hors de Paris, non seulement à l'est de la capitale, mais d'abord et surtout au sud, les pays qui stimulent l'imagination étant tout autant l'Italie et l'Espagne de Mérimée, Stendhal ou Musset que la côte nord de l'Afrique.
L'art orientaliste sert aussi d'exutoire aux idéaux libertaires, voire révolutionnaires, dans le domaine politique ou contraires à la morale et au code de conduite de la société. La « persane », l'« égyptienne », la « gitane », la « zingara », la « bohémienne », que celle-ci soit nommée « captive », « esclave », « hôtesse arabe », « odalisque », ou simplement « courtisane », toutes ces créatures « de rêve », qu'elles se nomment à l'Ouest Zaïde, Namouna, Esmeralda, Carmen, Aïda, Lalla-Roukh, Lakmé, Djamileh, Aziyadé, Thaïs, Miarka, Butterfly ou Zemfira, Macha, Radda, Grouchenka, Olessia, Aza en Russie, ont la même fonction : elles doivent en effet toutes leur existence imaginaire aux fantasmes de la liberté de mœurs et du bonheur qu'elles promettent par la beauté de leur corps, de leur danse et de leur chant. Ces symboles de l'amour libre et des plaisirs défendus ne sont pas que féminins. Quelle jouvencelle occidentale étouffant dans une petite vie provinciale étriquée peut résister au charme du « sultan » ou de l' « émir » de ses lectures et de ses rêveries ? Le bel éphèbe arabe a d'autres admirateurs encore, qui fait courir en « Orient » Flaubert, Rimbaud, Loti, Gide, Szymanovski, tant d'autres, pour la même raison que celle que Saint-Saëns a si bien exprimée en s'indignant de ce qu'on le prenne pour un homosexuel. « Je ne suis pas homosexuel », protestait-il vigoureusement, « je suis pédéraste ». Et il avait bien raison, le brave homme, ce n'est pas du tout la même chose…
En littérature, l'un des premiers à évoquer les gitans en France est Eugène Sue avec El Gitano (Le Gitan, 1831), Le Commandeur de Malte (1841) et surtout Paula Monti ou L'Hôtel Lambert (1842). Dès 1831 l'Esmeralda du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo lance la mode de la gitane dans la littérature qui trouvera l'une de ses plus célèbres personnifications dans la Carmen de Mérimée écrite en 1845 et sa mise en musique par Bizet trente ans plus tard. Cependant, cette origine espagnole des gitans n'importe que pour les Parisiens qui vont à leur rencontre en faisant le voyage d'Espagne et tentent de vivre comme eux, en « libres habitants de l'univers », comme le fera Aleko chez les tziganes en Russie. Pour ceux qui se contentent de rêver dans les salons de la capitale se produit le phénomène contraire : le gitan « importé » par le rêve va rapidement se parisianiser. Il importe en effet d'autant moins à ces rêveurs que l'origine du gitan soit l'Espagne, la Bohême, l'Afrique du nord ou l'Inde que c'est cette méconnaissance même qui leur permet de voyager par la pensée dans un pays mythique d'autant plus attractif qu'il est inconnu. Favorisé par le côté artiste (danse, musique) du gitan, sa pauvreté, sa volonté de liberté et son insoumission aux règles sociales, un glissement sémantique s'opère alors entre l'artiste rêveur et sa création d'imagination : c'est le bohémien qui prend donc très tôt à Paris, grâce à cette ignorance et à une double ambiguïté orthographique (bohème / Bohême) et sémantique (Bohême / bohémien) le sens qu'il aura dans les Scènes de la vie de Bohème de Murger (1851) et qui se perpétuera dans la plupart des œuvres suivantes, de George Sand (La dernière Aldini, 1839, Consuelo, 1843, Teverino, 1845, La Filleule, 1853) à Pinson du Terrail (La Bohémienne du grand monde, 1867) en attendant des années 1880 particulièrement riches, en quantité si ce n'est toujours en qualité, avec, par exemple, le médiocre George Ohnet et sa Comtesse Sarah de 1883 ou Jean Richepin et sa célèbre Miarka, la fille à l'ourse de 1882, dont les quatorze mélodies qu'en tire Alexandre Georges en 1888 auront un succès fou dans les salons.
En Russie l'évocation des tziganes se produit un peu plus tôt qu'en France, en particulier grâce à Pouchkine qui, trois ans avant Les Tziganes, écrit en 1821 son poème Le prisonnier du Caucase suivi par Mikhaïl Lermontov en 1828 dans un poème portant le même titre et Vladimir Dahl dans une nouvelle, La Bohémienne, en 1831. Le thème fait flores et se retrouve par la suite un peu partout, notamment chez Tourguéniev, Tolstoï, Leskov, Tchékov, Kouprine et d'autres écrivains russes pour lesquels les tziganes représentent, plus que tout autre peuple, l'archétype même de la liberté dont ils sont privés. Un des cas les plus intéressants est celui de Gorki dont la première nouvelle, Makar Tchoudra, est publiée à Tiflis dans le journal Caucase le 12 septembre 1892, soit quelques mois seulement après la fin de la composition d'Aleko. L'action en est presque identique : Loiko Zobar courtise une jeune gitane, Radda, qui, tout en l'aimant secrètement, se refuse à lui pour ne pas perdre sa liberté. Elle finit par accepter son amour mais prévient Loiko qu'elle ne sera à lui que s'il lui fait d'abord acte de soumission. Lui, aussi fier et orgueilleux que Radda, accepte mais la tue immédiatement après cet aveu de faiblesse pour affirmer et préserver sa propre liberté. Le père de la jeune femme la venge en le tuant.
Comme en France, les tziganes de la littérature russe sont en grande partie des idéaux romantiques. Mais une grande différence existe entre les deux pays. Les tziganes ne sont pas que des créatures de rêve en Russie mais y ont une existence bien réelle. Implantés depuis des siècles, ils s'y sont adaptés et entre les Russes et eux se sont développés des traits communs. Une source difficilement vérifiable estime leur nombre à 200 000 environ deux décennies après l'époque d'Aleko. Autre différence avec l'Occident, des chœurs tziganes apparaissent à Moscou dès le XVIIIe siècle et font fureur au XIXe, toutes les villes importantes se couvrant alors littéralement de telles chorales. Situées le plus souvent à la périphérie des villes, elles attirent la noblesse russe dans les cabarets décris par Pouchkine et Tolstoï et la séduisent par le chant et la danse. Contrairement à celle des tziganes de nos contrées, la musique y est donc essentiellement vocale, les instruments n'y tenant qu'un rôle très secondaire d'accompagnement. Si les instruments principaux communs à tous les tziganes tels que le tambourin, l'accordéon, le violon et la guitare restent les mêmes, en revanche ils ne comprennent bien sûr ni le cymbalum et le taragot transdanubiens ni les castagnettes espagnoles mais parfois des instruments russes tels que la balalaïka. D'autre part, le répertoire de ces chorales, comme en témoigne Le cadavre vivant de Tolstoï, comprend généralement des chants tziganes et des chants russes en alternance. En revanche l'évocation dans la littérature russe du tzigane nomade, libre, joyeux, sans souci, menant une vie paresseuse qu'animent seules les fêtes quasi-quotidiennes est bien loin de la réalité. Les tziganes de Russie sont le plus souvent sédentaires, soumis au travail le plus dur, dont ils ne seront libérés qu'à l'abolition du servage en 1861. Le thème développé dans Les Tziganes et repris dans Aleko du noble ou du bourgeois russe désirant échapper à la servitude de la civilisation et se joindre à une troupe errante de tziganes pour parvenir à la liberté et au bonheur représente donc l'envers absolu de la réalité, une illusion romantique.
Pouchkine mis à part, l'écrivain russe chez lequel le thème des tziganes est le plus développé est indiscutablement Léon Tolstoï. Dans la généalogie des Tolstoï, il y a d'ailleurs un peu de sang tzigane. Son oncle Fiodor, dit « l'Américain », épouse en 1821 une tzigane, Avdotia Tougaïeva, qui lui donnera douze enfants dont un seul atteindra l'âge adulte. Son frère aîné, Sergueï, s'amourache à l'âge de 22 ans d'une chanteuse de la chorale tzigane de Toula, Macha Chichkina. En 1849, il l'emmène dans sa résidence de Pirogovo et vit en concubinage avec elle, ne finissant par l'épouser que dix-huit ans et trois enfants plus tard. D'après ce qui n'est peut-être qu'une légende, Léon Tolstoï lui-même se serait amouraché d'une tzigane de la même chorale de Toula. Une entrée de son journal précise en tout cas que « hier, j'ai presque été séduit par une belle tzigane mais Dieu m'a sauvé »13. Les tziganes sont évoqués tout au long de sa vie dans ses œuvres. Dans Guerre et Paix, dans Anna Karénine, on se rencontre, on joue aux cartes, on dîne au son des mélodies tziganes. Mais c'est surtout dans ses nouvelles qu'ils apparaissent en force et tiennent une place prépondérante, en particulier dans Sébastopol en mai (1855), Les Deux Hussards (1856), Les Cosaques (1863), La Nuit de Noël, et dans la plus connue de ses pièces de théâtre, Le cadavre vivant (1900-1904). Cette dernière œuvre, jouée pour la première fois en 1911 dans une mise en scène à laquelle collabore Nemirovitch-Dantchenko, contient d'ailleurs une de ses plus fortes évocations du chant tzigane auquel, à défaut des chanteuses, ses œuvres prouvent qu'il était particulièrement attaché. Il existe selon lui une connexion entre le caractère des tziganes et celui des Russes qu'il exprime ainsi dans sa nouvelle inachevée La Nuit de Noël : « Les tziganes ont d'abord interprété avec beaucoup de sensibilité les chants populaires russes, puis ils ont chanté des mélodies tziganes. Dans ces chants tziganes, les Russes retrouvent leurs racines populaires et c'est à cause de ces racines populaires que chaque Russe sait apprécier les chants tziganes. »14 Le thème se précise alors. La bohémienne, la belle séductrice, envoûte ses proies autant par son chant que par la liberté trompeuse qu'elle semble promettre à ses victimes. Le parallèle entre les Russes et les tziganes qui semble s'imposer naturellement à l'esprit de Tolstoï nous dévoile le sens de toutes les œuvres littéraires russes évoquant le thème de la liberté chez les tziganes, qu'il s'agisse de celles qui viennent d'être mentionnées ou du poème de Pouchkine et de son adaptation par Nemirovitch-Dantchenko.
Les topoï romantiques de la liberté, du bonheur et du destin dans Les Tziganes de Pouchkine et l'Aleko de Nemirovitch-Dantchenko
Par rapport aux orientalistes occidentaux, le thème de la liberté présente chez les auteurs russes une particularité qu'un peu de linguistique peut aider à faire comprendre au lecteur francophone. La langue russe possède trois mots aux sens bien spécifiques pour notre terme de liberté. Le premier, cвoбoда (svoboda), le plus courant, le plus général aussi, s'utilise surtout pour exprimer la liberté physique recouvrée par un ex-prisonnier ou la liberté patriotique. Le second, вольнocть (volnost), correspond plutôt à ce que l'on entend en français par l'expression « prendre des libertés avec », qu'il s'agisse de privauté, de libertinage, ou seulement de désinvolture. Le troisième, воля (volya), que l'on pourrait traduire par liberté totale, infinie, sans limites, est celui qui nous intéresse car c'est le terme utilisé dans toutes les œuvres sur les tziganes citées sopra. Il apparaît une vingtaine de fois dans le poème Les Tziganes de Pouchkine contre une seule occurrence pour svoboda, et encore cette dernière s'explique-t-elle par le besoin de la rime avec naroda, « du peuple ». Chez Nemirovitch-Dantchenko, contraint de supprimer la plupart des passages non dramatiques où ce terme apparaît, il est certes réduit à six occurrences mais il n'y en a aucune pour svoboda. Ce terme est plus riche, sa sphère sémantique plus large que svoboda, son usage plus fréquent dans la poésie. Il n'exprime d'ailleurs pas seulement la liberté totale mais aussi la volonté, le caractère. Sa combinaison avec l'adjectif tiré de svoboda nous donne l'expression « svobodnaïa volya », l'équivalent de notre « libre arbitre ». Dans l'esprit d'un Russe, le terme de volya éveille, consciemment ou non, diverses associations d'idées avec ce qui constitue à la fois ses propres valeurs et les valeurs les plus précieuses des tziganes. La volya est la liberté infinie, celle de l'air, du vent, de l'oiseau, de l'onde, des grands espaces de la steppe immense et sans limites, ainsi que la liberté d'action et de volonté, d'imagination et de rêve que ceci suppose. Les expressions na volyou ou na volnom vozdouxe signifient « au grand air », « à l'air libre » ; volnaïa ptitsa (littéralement : oiseau libre) prend le sens de « libre comme l'air » et l'adjectif pluriel commun à volya et à volnost, volni, « libres » signifie également « les vagues ». Dans le terme de приволье (privolie), ce qui pour nous, francophones, constitue deux sens bien distincts l'un de l'autre, liberté et espace, se fond en un seul pour un Russe. Liberté et grands espaces sont pour lui indissociables, comme pour les tziganes. Plus remarquable encore, par une logique qui nous échappe en partie et dont le Russe lui-même peut n'être pas parfaitement conscient, une association mentale aussi naturelle qu'inévitable se crée dans son esprit entre volya (liberté), dont l'adjectif féminin est semblable à volna (vague), et волнeниe (volnenie, agitation, émoi). Toute une philosophie est liée à ces associations mentales.
Ces termes — la volya, l'air, le vent, l'oiseau, l'onde et les grands espaces de la steppe — s'appellent l'un l'autre et leur groupement se retrouve dans toute la littérature russe, en particulier celle qui a trait aux tziganes. Dans Les Tziganes de Pouchkine, un passage déjà cité, non repris par Nemirovtch-Dantchenko, commence ainsi : « Il [Aleko] est maintenant un libre habitant de la terre ». Suit alors immédiatement une comparaison entre la volya et « l'oiseau de Dieu », symbole d'absolue liberté, dans laquelle le mot « oiseau » est mentionné quatre fois. Dans Makar Tchoudra de Gorki, le protagoniste, un vieux tzigane, parle de la destinée de l'homme. Dès que le mot volya a été utilisé, les associations coulent en cascade, laissant apparaître la volnenie et le côté tragique implicite de la volya et du destin: « Est-il donc né pour retourner la terre et puis mourir sans avoir eu le temps de creuser son propre tombeau ? A-t-il une idée de la liberté (ведома ему воля) ? L'espace des steppes lui est-il intelligible ? Le parler des vagues de la mer, du vent dans la steppe, réjouissent-ils son cœur ? Il est esclave dès sa naissance, esclave toute sa vie… »15 Fedor Protassov, le protagoniste du Cadavre vivant de Tolstoï, entend un chant tzigane et s'exclame : « C'est la steppe […] ce n'est pas la liberté (svoboda) mais la liberté sans limites (volya).16
Plus important encore, la rime de volya qui semble s'imposer immédiatement à l'esprit d'un Russe et lui paraît logique, c'est dolya, « le sort, la destinée », cette autre valeur essentielle commune aux Russes et aux tziganes. Ici aussi, la volya trahit son côté tragique. Cette rime, воля / доля, cette parenté linguistique vraisemblablement née d'une association mentale séculaire résume le drame entier de Pouchkine: l'amour de la liberté impossible, c'est-à-dire d'une liberté totale et sans limites pareille à celle de l'oiseau ou du vent dans la steppe, conduit l'homme à sa funeste destinée selon une dialectique amour / liberté qui se substitue à l'amour / devoir de la tragédie occidentale. Pouchkine utilise plusieurs fois cette rime, notamment lors de la dernière occurrence du mot volya avant l'épilogue :
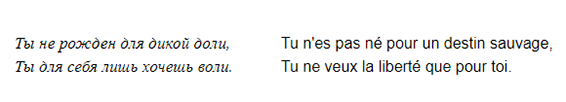
« Le romantisme russe traite traditionnellement l'amour d'une bohémienne comme une manifestation de la liberté illimitée [volya]. En aimant un homme qui n'est pas du milieu des bohémiens, la bohémienne le séduit surtout par le pressentiment qu'à côté de sa bien-aimée il pourra échapper à sa vie monotone se délivrer de toutes les conventions et de toutes les ʺ chaînes de la civilisation ʺ. Enivré par les chants tantôt joyeux, tantôt tristes, captivé par la grâce physique et la franchise de la passion d'une bohémienne amoureuse, le protagoniste étranger au milieu bohémien est hypnotisé par un rêve romantique : il se croit initié à une autre vie, aux émotions intenses, aux couleurs vives, variées, envoûtantes […] » Mais la liberté totale (volya) que promet l'amour d'une bohémienne n'est qu'une illusion qui conduit les amants à leur destin dramatique : « Elle soumet la conscience de celui qu'elle aime à un dur examen qui finit par son échec moral. La vision radieuse d'une autre vie se transforme donc vite en mirage parce que le protagoniste ne peut (ou ne veut) pas s'adapter complètement à la liberté totale des bohémiens, tandis que la bohémienne, privée de cette liberté, souffre d'une tristesse invincible qui tue son amour »17 et cherche à la retrouver dans la fuite ou dans un nouvel amour.
Cette analyse d'Elena Saprykina peut s'adapter sans le moindre changement à la plupart des œuvres de la littérature russe évoquant les tziganes, Le cadavre vivant de Tolstoï, Makar Tchoudra de Gorki ou Les Tziganes de Pouchkine et donc l'Aleko de Nemirovitch-Dantchenko. Dans Pouchkine, Aleko, un Russe « poursuivi par la loi » et fuyant « la servitude des villes étouffantes » est accueilli par Zemfira qui fait de lui son compagnon. Aleko devient alors « un exilé migrateur semblable à l'oiseau insoucieux» et, en apparence tout au moins, s'adapte parfaitement à la volya des tziganes et « ne regrette rien de ce qu'il a abandonné pour toujours ». Le narrateur de Pouchkine (se fondant ici avec l'auteur), prévient aussitôt le lecteur : et pourtant « comme les passions jouent avec son âme docile et avec quelle volnenie elles bouillonnent en son cœur épuisé. Depuis quand et pour combien de temps se sont-elles apaisées ? Attendez, elles vont se réveiller ». Le lecteur n'aura pas à attendre aussi longtemps que les personnages, cependant, puisque Pouchkine fait suivre ce passage d'une ellipse de deux ans. Le drame commence alors, réalisant la prophétie du narrateur. Zemfira étouffe dans cette relation et déclare à son père : « Son amour me pèse. Je m'ennuie, mon cœur exige la volya ». Le vieillard, ayant autrefois vécu le même drame avec Marioula, la mère de Zemfira, prévient alors Aleko : « Les hommes sont libres […] le cœur de la femme s'amuse quand il aime ». Pour le convaincre de ne pas faire obstacle au désir de liberté de Zemfira, il lui montre la lune, ce symbole de la liberté infinie dans un espace sans limites (volnaïa louna) et lui dit ces paroles que Nemirovitch-Dantchenko mettra dans la bouche du jeune tzigane pour que lui aussi ait un air :
Regarde, sous la voûte lointaine
la lune librement se promène;
en passant, elle éclaire la nature entière
d'une égale lumière.Qui pourrait lui indiquer une place dans le ciel,
et lui dire: arrête-toi là ?
Qui pourrait dire au cœur d'une jeune fille:
n'aime qu'une fois et tiens-t'en là ?
Il lui raconte ensuite l'histoire de sa propre vie et comment Marioula, la mère de Zemfira, l'a abandonné pour suivre un jeune tzigane. Mais Aleko se révolte : « Mais pourquoi n'as-tu pas plongé un poignard dans le cœur de la misérable et de son ravisseur ? » à quoi le vieillard répond : « A quoi bon ? La jeunesse est plus libre que l'oiseau ». Aleko montre alors son incapacité à s'adapter à la volya des tziganes : « Je ne te ressemble pas. Sans lutte, je ne renoncerai pas à mes droits et jouirai au moins de la vengeance ». Dès lors le drame est consommé. Aleko a échoué dans sa tentative, il est resté prisonnier de ses passions et les a portées avec lui de la civilisation dans le monde libre des tziganes. Epris de liberté, il ne sait pas l'accorder à autrui. C'est pourquoi les tziganes le chassent : Tu n'es pas comme nous, lui dit le vieillard, « tu n'es pas né pour un destin (dolya) sauvage, tu ne veux la liberté (volya) que pour toi. Quitte-nous donc ! » Comme nous l'avons vu, la rime volya / dolya résume le poème tout entier. La quête de la liberté totale n'est qu'un mirage, l'espoir de parvenir par cette liberté au bonheur une illusion romantique. Bonheur et liberté n'existent pas dans les rapports humains, surtout dans les relations amoureuses. Mais il ne s'agit pas sur ce point d'une véritable différence entre Russes et tziganes : tous les hommes sont esclaves de leurs passions. L'histoire du vieillard et de Marioula, tous deux tziganes, absolument identique à celle du Russe Aleko et de la tzigane Zemfira, en est une preuve suffisante. D'autre part, le vieillard qui a concédé la liberté à Marioula n'est pas plus heureux qu'Aleko. Si la quête du bonheur par la liberté totale des tziganes se révèle impossible pour les Russes prisonniers de la civilisation, en revanche les tziganes, qui possèdent la paix et la liberté sans limites n'en parviendront pas pour autant au bonheur. C'est ce que Pouchkine expliquera dix ans plus tard, en 1834, dans des vers célèbres où se retrouve la rime volya / dolya, c'est-à-dire le résumé d'une association mentale entre liberté, passions, bonheur et destin qui est la clé du poème des Tziganes:
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
(Давно завидная мечтается мне доля…)
Dans tout l'univers, il n'y a pas de bonheur, mais il y a la quiétude et la liberté sans limites.
Pouchkine adjoint à son poème un épilogue dans lequel il supprime tout doute à ce sujet:
Mais le bonheur n'existe pas non plus parmi vous,
O fils misérables de la nature !
Et les tentes déchirées
Connaissent les songes douloureux.
Vos tribus errantes
N'échappent pas aux malheurs.
Partout les passions fatales se déchaînent
On ne peut rien contre le destin.
Aleko ne représente donc pas seulement pas seulement l'opposition simpliste entre Russe et tzigane mais son dépassement dans l'Homme. Il représente également le poète romantique et ses illusions (son idéalisme, le mirage de la volya) dont Pouchkine, dans sa vie et dans ses œuvres, tente à la même période de se défaire. De nombreux commentateurs relèvent, dans la crise personnelle qu'il subit au moment de la rédaction d'Aleko, un changement général de style, l'abandon d'une vision romantique de l'homme, la désaffection du passé et le désenchantement successif au rejet de ces idéaux tels que la liberté sans limites, le bonheur total, l'amour éternel et le pouvoir de la poésie. En 1821 déjà il écrit :
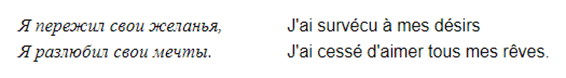
Mais qu'il est donc curieux alors que ces critiques si perspicaces n'établissent aucun parallèle entre le destin d'Aleko et celui de Pouchkine, qui paiera de sa vie le fait de ne pas avoir accordé à sa jeune, frivole, capricieuse et mondaine épouse, la belle Natalia Gontcharova qui « s'ennuie » et dont « le cœur s'amuse quand il aime », la volya amoureuse que « son cœur exigeait » et qu'il s'accordait pourtant si généreusement à lui-même. Ne dit-on pas en effet que c'est pour avoir séduit la femme du gouverneur d'Odessa en 1824, soit l'année même où il écrit Les Tziganes, qu'il est exilé à Mikhaïlovskoïe où il termine son œuvre ? Et lorsque d'Anthès vient courtiser Natalia (car « partout les passions fatales se déchaînent »), « ah, comme les passions se jouent alors de son âme trop docile ! » « Attention, ô lecteur, elles vont se réveiller ! » Il veut, comme Aleko, « planter son poignard dans le cœur de la traîtresse et de son ravisseur ». Jugeant son honneur bafoué, il provoque d'Anthès en duel, car il ne peut, ni ne veut « renoncer à ses droits et au plaisir de la vengeance ». Mais pouvait-il vraiment agir autrement ? Non, l'homme « ne peut rien contre le destin. »
Les Tziganes de Pouchkine et l'Aleko de Nemirovitch-Dantchenko : quelles différences ?
« La faiblesse principale de l'opéra réside, à mon avis, dans la vulgarité avec laquelle Nemirovitch-Danchenko, n'ayant rien compris à la psychologie du poème, avait tiré son livret des Gitanes de Pouchkine. Il est possible que la manière abstraite dont celui-ci traitait l'idée abstraite de liberté fût quelque peu risquée aux environs de 1890 où elle frisait la subversion ; mais la laisser entièrement de côté, alors que c'était là l'essentiel du sujet, cela ramenait le drame à n'être plus qu'une aventure de jalousie individuelle. »18
Ce jugement sévère n'est cependant pas lui-même à l'abri de toute critique, à l'image du livre tout entier de Victor Serov qui constitue un exemple assez classique de la musicologie ancienne plus romancée que scientifique, jamais analytique, et qui fourmille de lacunes, d'imprécisions, d'inexactitudes, voire d'erreurs grossières, un ouvrage, en somme, que le mélomane, averti ou non, trouvera intérêt à ne pas lire.
Serov semble considérer que le thème principal du poème de Pouchkine est l'émancipation des tziganes de Bessarabie de la tyrannie, un sujet en effet délicat à une époque où les informateurs au service des autorités sont nombreux et disséminés dans tout le tissu social, et que c'est là la raison pour laquelle Nemirovitch-Dantchenko réduit le texte de Pouchkine à une simple histoire de crime passionnel. Il n'est pas seul à penser ainsi et d'autres commentateurs vont jusqu'à interpréter le poème de Pouchkine comme une apologie de la liberté des femmes dans leurs rapports avec les hommes, soit comme un véritable plaidoyer féministe avant l'heure. Ceci nous semble être davantage une projection d'idées personnelles sur le texte de Pouchkine qu'une analyse objective. Non seulement Nemirovitch-Dantchenko ne « ramène » pas « le drame à n'être plus qu'une aventure de jalousie individuelle », comme le prétend Serov mais il n'existe nulle part dans le poème de Pouchkine aucune phrase, aucun mot, aucune allusion permettant d'affirmer que son poème a pour but de diffuser un tel message politique ou social. Il est vrai en revanche, comme nous l'avons signalé ci-avant, que le nombre d'utilisations du terme de liberté est plus réduit, mais dans une proportion à peu près égale à celle qui existe entre les dimensions respectives du poème et du livret et sans que les coupures effectuées sur ce point précis ne portent gravement atteinte à l'ensemble. Il en est une, toutefois, dont on peut regretter qu'il ne l'ait pas conservée : il s'agit du distique final, « Tu n'es pas né pour un destin sauvage / Tu ne veux la liberté que pour toi ».
Une comparaison entre les deux textes fait apparaître davantage de qualités que de défauts chez le librettiste. Elle montre aussi que les qualités et défauts du poète et du librettiste se situent sur des plans opposés. La réduction nécessaire opérée par Nemirovitch-Dantchenko appauvrit peut-être tant soit peu le thème de la liberté, altère gravement l'œuvre en passant à peu près sous silence le rapport entre ce thème et celui du destin (volya / dolya) mais donne au texte de Pouchkine la structure, la cohérence de l'action, la théâtralité qui lui font défaut. Ceci n'a d'ailleurs rien de surprenant, Vladimir Nemirovitch-Dantchenko19 étant un romancier, auteur dramatique et metteur en scène très expérimenté, fondateur avec Constantin Stanislavski du Théâtre d'art de Moscou, et père du projet de l'École-studio du Théâtre d'art académique de Moscou. Son sens dramatique fait merveille dans son adaptation d'un poème qui, pour se transformer en pièce de théâtre, se doit d'obéir à des principes tout autres.
Nemirovitch-Dantchenko rédige son livret dans le plus grand respect du poème en octosyllabes20 de Pouchkine. Les passages qu'il conserve sont inchangés et à aucun moment, à part quelques mots de liaison, il n'ajoute quoi que ce soit de son crû. Lorsqu'il supprime, il s'agit toujours de passages statiques, descriptifs, ou exposant des considérations certes importantes mais non essentielles à l'action. Celle-ci est non seulement maintenue intégralement mais elle est remarquablement mise en valeur, rendue plus homogène, mieux structurée, plus progressive par l'établissement de liens plus cohérents entre les diverses péripéties ainsi qu'entre les numéros. En revanche, pour parvenir à ce résultat, il chamboule totalement la succession des divers événements, opérant de très nombreuses rocades, la plupart du temps avec bonheur.
Ceci commence dès la fin du chœur d'introduction, soit dès le no 3 où le récit du vieillard s'adresse à tous les tziganes ainsi que, bien que cela ne soit pas précisé, à Aleko et Zemfira alors que chez Pouchkine, ce récit s'adresse au seul Aleko et se situe beaucoup plus avant dans l'action, après le no 9, ce qui, dramatiquement, n'a guère de sens et ralentit l'action à un moment où elle devrait au contraire avancer. De plus cette rocade a l'immense avantage de poser dès le début la mise en abyme, c'est-à-dire de présenter toute l'histoire de la triangulation entre Aleko, Zemfira et le jeune tzigane comme le double développé de celle qui s'est produite autrefois entre le vieillard, Marioula et un jeune tzigane en donnant ainsi un premier indice du rôle du destin et du sens de l'œuvre. Du même coup, le n° 9 lui-même, soit la chanson de Zemfira dans la scène auprès du berceau, est beaucoup mieux mis « en situation » par Nemirovitch-Dantchenko. Chez Pouchkine cette chanson précède la scène où Aleko surprend sa compagne et ne sert que de prophétie générale se rapportant aussi bien à Marioula qu'à Zemfira. Dans le livret elle est intégrée à l'action, devient la conséquence logique du duo d'amour no 8 de Zemfira avec le jeune tzigane et fait donc le lien avec celui-ci. Nemirovitch-Dantchenko évite ainsi la rupture de l'action dramatique qui se produit dans le poème de Pouchkine et, par cette rocade, rend celle-ci plus naturelle, plus vraisemblable et plus cohérente. La liaison du no 9 avec le no 10 dans lequel Aleko pleure son amour perdu, est de ce fait elle aussi plus logique.
On peut cependant adresser quelques reproches à Nemirovitch-Dantchenko mais autres que ceux que lui font Serov ou Norris. Lorsqu'il supprime le passage dans lequel Pouchkine raconte l'arrivée d'Aleko au campement des tziganes, conduit par Zemfira qui l'a « trouvé » errant dans la steppe, il supprime du même coup l'indication de la jeunesse d'Aleko qui, chez Pouchkine, a l'âge de Zemfira et de son nouvel amant, le « jeune » tzigane. Privé de toute autre précision à cet égard et influencé par les indications trompeuses de la chanson de Zemfira qui parle d'un « vieux mari » à « cheveux gris », le lecteur confond les deux récits, prend l'intrigue de l'opéra toute entière pour une histoire traditionnelle de vieux barbon et interprète faussement le sens de la liberté que revendique Zemfira, ceci d'autant plus facilement qu'il suppose, n'ayant sur ce point non plus aucune indication contraire dans le livret entier, qu'Aleko est bien le mari de Zemfira et non seulement son compagnon. Chez Pouchkine en revanche, la chanson de Zemfira étant dissociée de l'action et antérieure à celle-ci, l'amalgame ne se fait pas et le terme de « mari » est interprété comme il se doit par le lecteur qui comprend sans peine que Zemfira chante une chanson tzigane traditionnelle dans laquelle il est question d'un vieux mari et d'une épouse quelconques dont le rapport avec le couple qu'elle forme avec Aleko a besoin d'être ensuite précisé : « c'est de toi que parle ma chanson ».
Le second reproche que l'on peut adresser à Nemirovitch-Dantchenko est plus grave encore : alors que la plupart des multiples rocades qu'il opère dans le texte de Pouchkine témoignent d'un grand sens dramatique, il en est une qui manque de pertinence au point de fausser le sens de l'œuvre. Comme nous l'avons vu sopra, Pouchkine termine son poème par un extraordinaire distique qui « sonne » magnifiquement en russe et qui, en partie pour cette raison - la beauté de la langue de Pouchkine -, en partie parce que cette croyance en un destin tout-puissant est un des composants reconnus de l'« âme russe », mais essentiellement parce qu'il donne la conclusion et le sens du poème, est devenu par la suite un des passages les plus souvent cités de son œuvre :
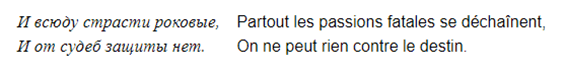
La place occupée par une affirmation dans un texte n'est jamais innocente mais constitue toujours chez un bon écrivain une indication très fiable de l'importance qu'il lui accorde et il en va de même de l'ordre des mots dans cette affirmation. Le premier et le dernier mot d'une œuvre ont une importance particulière. On constate ainsi que le premier vers du livret, «Как вольность, весел наш ночлег», met déjà en évidence le thème de la liberté (volnost). Ecrire « le dernier mot » d'une œuvre, lui apporter une « conclusion », c'est en préciser le sens à laquelle celle-ci tend toute entière dès le début, et le faire d'une manière si claire et si définitive que tout autre mot est superflu. Déplacer ce « dernier mot » à un autre endroit du texte, comme le fait Nemirovitch-Dantchenko, qui place ce distique à la fin de la première strophe du récit du vieillard (no 3), c'est, selon les cas, affaiblir considérablement ce sens, l'occulter, le supprimer, le dénaturer ou, le plus souvent, le trahir. Car c'est aussi, inévitablement, lui substituer un autre sens qui sera constitué par ce qui reste une fois l'amputation faite ou plus vraisemblablement par ce qui est choisi pour le remplacer. Ici, c'est le thème de la solitude, accentué par la répétition du mot final « seul », qui devient le thème essentiel, ce qui est mettre d'autant plus à côté de la cible que non seulement ce thème n'a jamais été abordé dans toute l'œuvre mais que le « à nouveau » de cette dernière phrase : « me voici à nouveau seul, seul » incite alors le lecteur plus fortement encore à se convaincre qu'il s'agit bien là du sens véritable, enfin dévoilé après avoir été soigneusement dissimulé dès le début pour faire d'autant plus d'effet par cet artifice final. Ce grave contresens n'est que faiblement excusé par le fait que cette allusion au destin est placée, comme nous l'avons vu, au seul endroit où le lecteur, ou l'auditeur, qui ne connaît pas Les Tziganes de Pouchkine peut ne pas la juger entièrement déplacée. Il aurait été plus judicieux de renoncer à cette rocade et l'on peut donc se demander ce qui a incité le librettiste à la faire tout de même. Le choix d'une telle fin nous semble devoir être interprété comme une influence du vérisme italien et peut-être est-ce là ce que Serov reproche vraiment à Nemirovitch-Dantchenko en parlant de « vulgarité ». Rachmaninov, terminant son œuvre par une marche funèbre qui s'intègre logiquement à l'action, montre peut-être aussi par là qu'il subit la même influence mais évite mieux que son librettiste le clash avec le poème de Pouchkine.
Le but de cet article étant l'analyse du livret et non de la musique, nous ne développerons pas ce dernier point. Tout auditeur se rend d'ailleurs compte de lui-même, sur le plan strictement musical, de la puissante séduction exercée par l'indépendance, la vitalité, la sensualité du monde bohémien sur le compositeur : mélodies orientalisantes, rythmes entraînants, parfois lancinants des danses, comme la danse des femmes énoncée à la clarinette, emprunts à la musique tzigane, comme le thème de la danse des hommes qui est une mélodie tzigane originale, passages lyriques mémorables, telle la Cavatine d'Aleko, à juste titre passée à la postérité grâce à la célèbre basse Chaliapine, ou la Scène auprès du berceau dont le texte inspira plus d'une vingtaine d'autres compositeurs russes sous le titre de « pièce tzigane » ou de « romance tzigane »21.
Tout au plus jugeons-nous utile de signaler une ou deux caractéristiques supplémentaires du livret qui, sans la musique, échapperaient peut-être à l'attention des lecteurs. Il est bien de se souvenir tout d'abord qu'Aleko n'est pas seulement une partition d'examen mais également un livret d'examen, qui doit donc se prêter à ce que l'on demande aux candidats à un examen final de composition. Il doit contenir des chœurs, dont un chœur d'entrée et un chœur final, des airs, des occasions de placer des pièces instrumentales, un récit, une romance et des ensembles dont un duo d'amour et un final, etc. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'utiliser un livret de « prêt-à-composer », c'est-à-dire structuré en numéros séparés, en pezzi chiusi dans lesquels les candidats peuvent montrer qu'ils maîtrisent les formes traditionnelles et faire la preuve de leur savoir-faire dans toutes ces situations différentes ainsi que, bien entendu, dans le domaine de l'harmonie, de la mélodie, du contrepoint, etc. Certains commentateurs se sont plaints de ce que l'introduction de danses instrumentales ralentit l'action. Soit, mais s'il s'agit d'une exigence d'examen, seuls comptent l'endroit où elles sont placées, dans l'action ou complètement coupées de celle-ci, et le lien éventuel, le « pont » créé pour affaiblir voire surmonter la rupture de l'action induite par la forme à numéros. Cela peut conduire parfois les candidats à quelques pièges dont voici un exemple. Juste après le meurtre de Zemfira, le chœur s'écrie : « D'où vient ce bruit ? Quels sont ces cris ? Qui trouble la nuit ? Que se passe-t-il donc ? Lève-toi, vieillard ! ». L'appel à une utilisation de l'espace acoustique étant ici impératif, Rachmaninov ne se contente pas d'imitations mais commence une véritable fugue. Quelle autre forme se prête aussi bien à la situation ? Et quelle bonne occasion de montrer sa compétence dans le domaine du contrepoint ! N'est-ce-pas d'ailleurs ce que les examinateurs attendent, espèrent même qu'il fasse ? Malheureusement, selon un autre point de vue, c'était donner tête baissée dans le piège. Mon Dieu, que ces tziganes de Bessarabie sont donc cultivés ! Ils parlent en vers dans la langue raffinée de Pouchkine et chantent des fugues occidentales ! Une convention de l'opéra à laquelle il ne faut prêter aucune attention ? L'objection n'est pas valable dans ce cas car il ne s'agit pas ni d'un opéra aristocratique ni d'un opéra bourgeois mais d'une œuvre vériste. A qui la faute, alors ? A Rachmaninov, à Nemirovitch-Dantchenko, à Pouchkine, aux examinateurs ? Comme nous l'avons vu dans ses lettres à Natalia Dmitrievna Skalon puis dans ses désaccords avec Modeste Tchaïkovski à propos de Francesca da Rimini, Rachmaninov était très sensible aux rapports texte-musique. Il changea d'avis plus tard sur le livret « à numéros » qu'il avait, à 19 ans, jugé « très bien fait » et déclara: « Cet opéra est écrit sur le vieux modèle italien démodé, que les compositeurs russes ont été habitués à suivre la plupart du temps » et, pendant quelques années, il interdit de e représenter.
« Retour » de l'influence vériste subie : l'impact d'Aleko sur I Zingari de Leoncavallo.
Parmi la liste interminable des œuvres inspirées par les tziganes, le poème de Pouchkine ou l'opéra de Rachmaninov et Nemirovitch-Dantchenko, qui touche tous les genres et non seulement l'opéra et qui devrait faire l'objet d'une étude en soi, nous n'en choisirons qu'une, I Zingari de Ruggero Leoncavallo, pour sa dette manifeste à Aleko. Nous nous limiterons de même dans cette trop brève analyse du parallélisme entre les deux opéras au texte seul, conformément à l'objectif suivi jusqu'ici ainsi qu'à un unique critère de vérisme, suffisamment éloquent en soi pour qu'il ne soit plus indispensable d'ajouter de trop longs développements. Le lecteur intéressé trouvera cependant en note un inventaire de tels critères, non exhaustif lui non plus, mais qui peut servir de guide à ses propres recherches.
I Zingari de Ruggero Leoncavallo, opéra en deux « épisodes » sur un livret de Enrico Cavacchioli et Guglielmo Emanuel d'après Les Tziganes du Pouchkine, dont la première a lieu au Théâtre Hippodrome de Londres le 16 septembre 1912, soit près de vingt ans après Aleko, suivent assez fidèlement le poème de Pouchkine mais n'en sont pas moins largement tributaires de l'œuvre de Rachmaninov et Nemirovitch-Dantchenko. L'action, contemporaine selon un principe essentiel du vérisme, est située « sur les rives du bas Danube », soit dans le delta, à l'endroit où, avant de se jeter dans la mer Noire, le fleuve fait office de frontière avec l'ancienne Bessarabie où Pouchkine situe son histoire. Cette précision bienvenue de l'époque et du lieu de l'action fait totalement défaut dans Aleko. Les personnages sont les mêmes mais portent ici des noms différents montrant une volonté de couleur locale manifeste qui tranche heureusement avec l'ignorance, l'imprécision et la fantaisie de l'orientalisme de l'époque. Aleko porte le nom de Radu, le jeune tzigane s'appelle Tamar et Zemfira devient Fleana. Si ce dernier prénom ne semble pas être une appellation très répandue, Radu et Tamar sont en revanche très fréquents dans la région élargie et chez les tziganes même si l'origine de ce dernier prénom est notoirement hébraïque22. Quelques autres différences importantes entre Aleko et I Zingari ne peuvent manquer de frapper le lecteur dès la distribution. Tamar est désigné comme étant le jeune poète de la tribu, ce qui est plus conforme à Pouchkine, qui s'est représenté lui-même dans Aleko, que ne l'est le personnage imaginé par Nemirovitch-Dantchenko. Le personnage de Radu semble également plus respectueux, à ce moment-là tout au moins, du texte de Pouchkine que l'Aleko de Nemirovitch-Dantchenko en ce que les librettistes italiens précisent dès la distribution qu'il s'agit d'un jeune noble, une indication présente chez Pouchkine et précieuse en ce qu'elle préserve non seulement le débat sur les éventuelles intentions sociales et politiques cachées de ce dernier, que nous avons cependant jugées douteuses et qui font entièrement défaut chez le librettiste russe, mais donnent délibérément à leur propre création cette portée sociale, cette opposition de classes qui fit le succès du vérisme à ses débuts avant de creuser sa tombe23.
L'action montre d'autres différences notables par rapport à Pouchkine et à l'adaptation de Nemirovitch-Dantchenko dans lesquelles cette première impression d'un meilleur respect du poème dans I Zingari semble se confirmer. Conformément au premier et à la différence du second, le premier épisode commence en effet, comme chez Pouchkine, par la rencontre de Fleana (Zemfira) et de Radu à l'extérieur du campement. Le rapport va alors s'inverser, Aleko restant beaucoup proche de Pouchkine que I Zingari. Les librettistes italiens innovent en ce que les deux jeunes gens sont surpris par Tamar, présenté dès le début comme un soupirant dédaigné, qui, par jalousie, les dénonce à la tribu. Prisonniers de celle-ci, conduits pieds et poings liés devant le vieux tzigane qui, dans cette version, en est le chef, ils ne sont pardonnés qu'à la condition que Radu rejoigne la tribu, coupe tout contact avec la société aristocratique et épouse Fleana, soit trois obligations auxquelles les jeunes gens sont contraints de se soumettre, ce qui donne un sens différent au problème central de la liberté exposé par Pouchkine et auquel Nemirovitch-Dantchenko reste fidèle. L'écart de Cavacchioli et Emanuel se remarque peu cependant à ce moment car ils se tirent bien d'affaire en exprimant ces conditions par une proposition spontanée de Fleana à laquelle Radu acquiesce librement. Cet écart a l'avantage de constituer la première amorce d'un dénouement surprenant pour se rapprocher de Pouchkine qui fera une entorse très remarquable aux règles tacites suivies par les véristes de la première heure. Dans un nouvel écart, Tamar s'oppose à cette décision de pardon contre laquelle il est seul à s'élever et déclare son amour à Fleana dans le but de la faire renoncer à ce mariage. (Le lecteur se souviendra ici des contradictions signalées entre les textes de Pouchkine et de Nemirovitch-Dantchenko à propos du mariage des deux protagonistes.) Fleana repousse les avances de Tamar et celui-ci, provoqué en duel par Radu, choisit de quitter le campement. Le premier épisode se conclut par la célébration du mariage, dans laquelle on entend, au loin, le chant de désespoir de Tamar, procédé typique du vérisme dès Cavalleria rusticana, qui l'utilise dès la célèbre sicilienne de l'introduction comme arrière-plan sonore de son fameux décor scénique en triangle casa-osteria-chiesa (la maison, le débit de boisson, l'église) dicté par le respect de l'exigence essentielle de la couleur locale.
Lorsque le rideau se lève sur le second épisode, une année s'est écoulée. Radu remarque la froideur de Fleana à son égard. Surprenant un chant d'amour « dans la roulotte de celle-ci » (feraient-ils déjà « roulotte à part » ? se demande alors le connaisseur), il l'interprète comme une preuve d'amour pour un autre homme. Il s'agit bien sûr de l'air le plus célèbre du texte et de la partition d'Aleko, la fameuse chanson de Zemfira « Vieux mari, mari cruel » dans la scène dite « auprès du berceau ». Celle-ci, curieusement, est entièrement retravaillée par les librettistes de Leoncavallo qui n'en gardent que le second vers, qu'ils placent bien en évidence au début, et le second, qu'ils rejettent plus loin à en endroit où il passe inaperçu. Seraient-ils eux aussi, en raison peut-être de ce que l'on appelle en critique littéraire « le mouvement de l'écriture», inconsciemment tentés par les joies de l'infidélité et la revendication de leur liberté personnelle ? Non, la rocade est purement délibérée, très soigneusement calculée pour une raison qui sera analysée en fin de chapitre mais que le lecteur attentif découvrira sans peine dans le dénouement déjà. A cette chanson fait suite sans surprise la confrontation entre époux au cours de laquelle Fleana déclare à Radu qu'elle ne l'aime plus et s'enfuit, malgré les efforts de celui-ci pour la retenir, pour rejoindre Tamar dont le chant jubilatoire est entendu une nouvelle fois dans la distance. Les amants se déclarent leur amour et se réfugient dans une hutte de paille et de bois dont Radu, qui les a suivis, ferme la porte avec un cadenas et à laquelle il boute le feu dans un accès de rage et de désespoir. L'effet du climax vériste atteint ici un des moments les plus forts de toute la littérature d'opéra : Fleana et Tamar meurent brûlés vifs sur scène après d'inutiles supplications et d'horribles hurlements de douleur qui ne cessent qu'à la chute du rideau.
Comme on le voit, Cavacchioli et Emanuel font preuve à la fois de fidélité et d'infidélité envers Pouchkine. Plus précis que Nemirovitch-Dantchenko sur certains points, ils s'en éloignent plus largement sur d'autres, en particulier dans la chanson de Zemfira. La première didascalie, dont le rapport entre le texte de Pouchkine et celui de Nemirovitch-Dantchenko fera l'objet d'une brève analyse dans le chapitre suivant, montre ici une différence essentielle entre ce dernier et les librettistes des Zingari. Ceux-ci respectent dans ce cas le texte de leur prédécesseur, conservé presque sans le moindre changement, mais en ajoutent de nouvelles dans la suite du texte en quantité totalement disproportionnée par rapport à ce dernier, qui se limite à quelques très brèves indications. C'est là un phénomène assez typique du vérisme (après Cavalleria rusticana cependant car Mascagni reste très mesuré sur ce point) qui permet, avec une longue suite d'autres critères24, d'en mesurer le taux. Leoncavallo, de son côté, manifeste le même zèle que Rachmaninov à tenter de son mieux d'introduire dans sa partition quelques effets de couleur locale tzigane mais le fait parfois, comme il était d'usage à l'époque, en puisant dans le maigre stock d'effets orientalistes à tout faire qu'utilisent tous les compositeurs et qui, de ce fait, paraissent déjà passablement rebattus vers 1912, à une époque où Bartók applique déjà la technique qui, en respectant le caractère de la musique populaire de chaque pays, contribuera à la naissance des écoles nationales. Pour son opéra, Leoncavallo étudie tout de même soigneusement les chants traditionnels gitans qu'il peut se procurer et va jusqu'à faire construire un instrument nouveau, le contraviolino, qui tient à la fois de la viole et du violoncelle. Si les chants sonnent parfois plus orientaux que véritablement tziganes, malgré l'emploi de harpes et de tambourins, en revanche la couleur locale est, comme chez Rachmaninov, plus marquée dans l'inévitable intermezzo séparant les deux épisodes dont c'est d'ailleurs une des fonctions essentielles selon la tradition lancée par Cavalleria rusticana et conservée par Rachmaninov dans la danse des hommes et la danse des femmes qui occupent exactement la même place.
Parmi les innombrables points de comparaison entre le vérisme d'Aleko et celui des Zingari, nous n'en développerons qu'un, le plus essentiel. Il est de tradition chez les véristes italiens, de structurer leurs œuvres selon un crescendo dramatique soigneusement dosé culminant dans un climax qui ne précède que de quelques secondes la chute du rideau. C'est à ce moment qu'intervient le meurtre, accompagné de cris presque toujours redoublés d'appel au mort ou à l'assassin et de didascalies précisant le moment exact de la chute des corps, comme en fait foi le tableau ci-dessous qui se contente de ne citer que les quelques œuvres suffisant à illustrer ce propos.
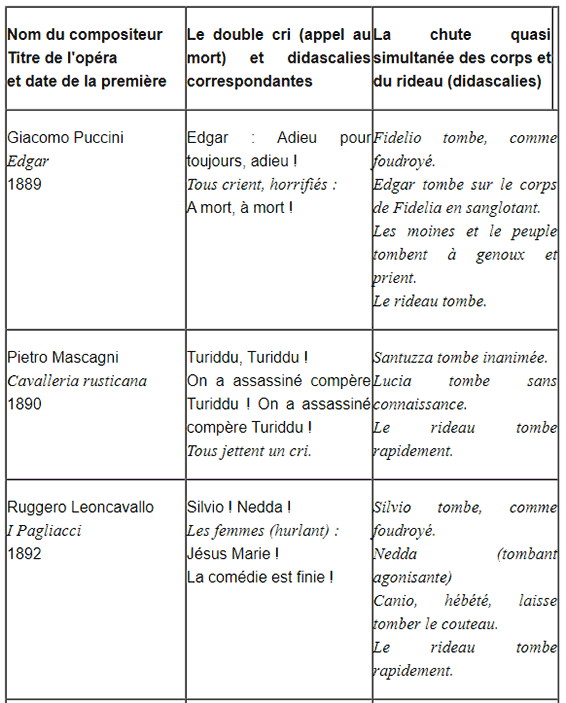
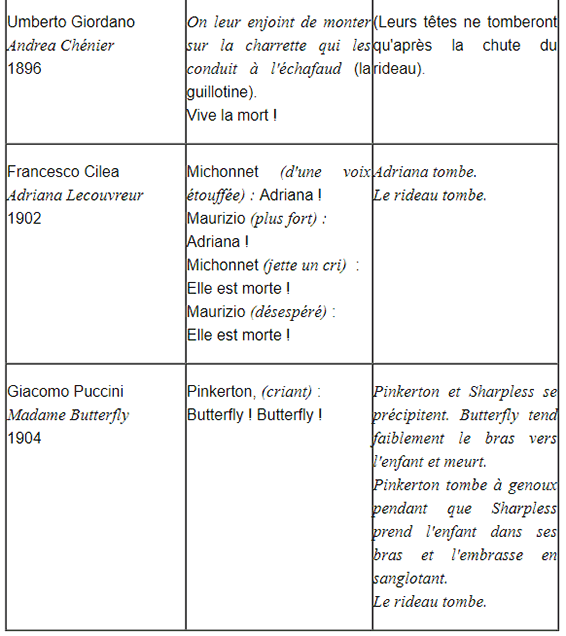
Le double appel aux morts existe bien dans Aleko et dans I Zingari ainsi que les didascalies, un critère qui permettrait déjà presque à lui seul de conclure à une forte influence vériste. Dans Aleko, au moment du meurtre du jeune tzigane, nous trouvons la situation suivante :
ZEMFIRA
Aleko !LE JEUNE TZIGANE
Je meurs !ZEMFIRA
Aleko !LE JEUNE TZIGANE
Je meurs !Il meurt.
Zemfira, dans sa réplique suivante à Aleko, continue ses doubles appels :
ZEMFIRA
[…]
Oh, qu'as-tu fait ! Qu'as-tu fait !
[…]ZEMFIRA
Se penchant sur le corps.Ô mon bien-aimé ! Pardonne-moi !
C'est mon amour qui a causé ta mort.
Ô mon bien-aimé ! (Bis)
Suit alors la scène du meurtre dont elle est elle-même victime. Poignardée à son tour par Aleko, elle survit cependant assez longtemps pour avoir le temps de répéter par trois fois :
ZEMFIRA
Je meurs en l'aimant. (Ter)
Puis
LE VIEUX TZIGANE arrive en courant et s'exclame :
Aleko ! Zemfira !
[…]
Peu après, Aleko lui-même s'adresse ainsi à la jeune morte :
ALEKO
Zemfira ! Zemfira !
Les répliques du chœur qui suivent sont également bissées et la fin si surprenante de l'opéra ne renonce pas à cette insistance si typique des véristes de la répétition comme procédé dramatique :
ALEKO
Ô malheur ! Ô tristesse !
Me voici à nouveau seul, seul !
Dans I Zingari, le degré d'insistance porté par les librettistes sur les répétitions dramatiques est à peu près semblable même si, dans ce cas, la chute des corps ne peut évidemment pas être mentionnée.
Les voix de Tamar et de Fleana :
Le feu !
Maudit sois-tu !
Miséricorde !
A l'aide !
A l'aide !
A l'ai… (sic !)Les voix meurent.
Les villageois accourent et tentent d'éteindre le feu mais
RADU (s'oppose à eux tous, menaçant, et tirant son poignard)
Arrière ! Arrière !
Une nouvelle didascalie précise alors que d'horribles hurlements jaillissent de la cabane en flammes.
LES TZIGANES
A mort l'assassin ! A mort ! A mort !RADU
[…]
Hurlez ! Hurlez !
[…]LES TZIGANES
Nous te tuerons ! – Attends ! – Maudit sois-tu ! Maudit! Maudiiiit! (sic !)(Ils le poursuivent dans sa fuite comme s'il s'agissait d'un animal féroce.)
Malgré la similitude évidente du procédé utilisé dans Aleko et I Zingari d'une part, et dans les opéras véristes cités dans le tableau qui précède, on peut observer quelques différences. La première est que ces deux opéras insistent encore davantage que les autres sur les répétitions. En effet celles-ci ne concernent plus seulement un double appel au meurtrier ou aux victimes mais s'étendent à des termes qui rendent le caractère vériste de ces deux œuvres encore plus prononcé et que Nemirovitch-Dantchenko et surtout Cavacchioli et Emanuel répètent le plus souvent de trois à cinq fois : « Je meurs ! », « A l'aide ! », « A mort ! », « Hurlez ! » ou encore « Maudit ! » C'est d'ailleurs ce procédé qui est à l'origine de la plus grande infidélité à Pouchkine commise par Cavacchioli et Emanuel que nous avons signalée sopra : la chanson de Fleana (la scène auprès du berceau dans Aleko) qui est entièrement retravaillée. Les librettistes n'en gardent que le second vers : « Poignarde-moi, brûle-moi ! » (Tagliami ! Abbruciami !) pour amener le dénouement tragique de la cabane en flammes et le placent en tête pour lui pour lui donner toute l'insistance voulue. Malheureusement ils ne s'arrêtent pas à ce qui aurait pu être une idée dramatique intéressante mais multiplient dans le reste du texte, de manière maladroite, lourde, grossière et même parfois grotesque, les allusions au bûcher final. Après plusieurs répétitions des verbes arroventarsi (s'embraser, prendre feu) et avvampare (brûler, flamber), Tamar s'exclame, dans la première réplique du duo d'amour Sono il rogo che s'accende (je suis le brasier qui s'enflamme) pour exprimer sa passion et prend la main de Fleana que les librettistes ne manquent pas de qualifier dans une didascalie de « brûlante ». Le premier mot du livret est d'ailleurs il fuoco (le feu), suivi par une double répétition de la fiamma (la flamme) et de mots tels que rovente (ardent, cuisant) et s'accende (s'enflamme). Cette technique de la répétition qui tourne au procédé systématique devient vite lassante sans compter que l'insistance malvenue qui fait placer les librettistes le Abbruciami en tête de la chanson de Fleana relègue à l'arrière-plan le premier vers « Vieux mari, mari cruel », conservé mais logiquement différé, qui perd dès lors le sens et l'importance qu'il a chez Pouchkine.
La seconde différence entre le caractère vériste d'Aleko ou des Zingari avec les œuvres bien connues citées dans le tableau est encore plus significative. Le parallèle permet ici aussi de comparer à la fois le taux de vérisme de ces œuvres et leur degré de fidélité à Pouchkine. Dans les deux cas, le connaisseur croit l'opéra terminé à la chute des corps. Tentant de prévenir celle du rideau, voyez-le qui se penche déjà hors de sa loge de scène pour acclamer et rendre à la vie la jeune diva (dont l'ego, pourtant indemne, renaîtra bien vite et plus florissant qu'avant sous les vivats et les louanges aussi excessives que bienvenues de ses admirateurs), puis qui se rassied, d'abord indécis puis de plus en plus perplexe : « Tiens, que se passe-t-il donc ? Pourquoi ce rideau ne tombe-t-il pas ? S'est-il accroché aux cintres ? une poulie coincée peut-être ? Le machiniste chargé de mettre le champagne au frais se serait-il oublié, trop occupé à prélever la part qu'on oublie toujours de lui offrir ? » Il ne se trompe qu'en partie pourtant, l'autre part de l'erreur revenant aux librettistes : l'action proprement dite finit bien avec la mort des protagonistes mais Nemirovitch-Dantchenko, comme Cavacchioli et Emanuel, nous surprennent par une fin étrange et inattendue. Le premier donne sa propre conclusion en remplaçant le thème de la liberté de Pouchkine par celui de la solitude, les seconds tentent de témoigner, trop tardivement, une apparence de fidélité au poème qu'ils ont quelque peu malmené jusque-là et que l'auditeur qui ne connaît pas cette œuvre risque fort de ne pas comprendre même s'il se souvient vraisemblablement de la déclaration de Radu au début du premier épisode:
LE VIEUX TZIGANE (tombant le visage dans la poussière et pleurant)
Laissez-le ! Laissez-le ! Tu n'étais pas né pour les immensités bleues de l'horizon. Tu n'as pensé qu'à toi-même. Ce n'est que pour toi que tu as cherché la liberté.Le rideau tombe rapidement.
« Tiens, la liberté ?», s'interroge alors le connaisseur. « Qu'est-ce que cela vient faire ici ? Ah mais oui, j'y suis maintenant, c'est le thème essentiel des Tziganes de Pouchkine ! Oui, c'est bien cela, ce destin inexorable qui frappe d'abord, puis cette liberté… Tout de même, quelle fin étrange ! Voyons, on a commencé par « le feu », ne devrait-on pas finir par ce bûcher final ? Il y a quelque chose qui ne joue pas. Mais quoi ? » Et en effet, quelque chose choque ici qui n'est pas seulement l'abandon subit du principe vériste sur lequel les librettistes ont construit leur œuvre de bout en bout, l'apothéose du bûcher, ni le caractère illogique de l'inversion de la rime volya / dolya de Pouchkine, ni même le fait que le thème du destin a été complètement passé sous silence, ce qui se reporte sur celui de la liberté, maisle fait que le dernier mot de l'œuvre qui tente par cette rocade un peu désespérée d'en rendre le sens et l'essence tombe mal dans ce contexte. La déclaration initiale de volonté de liberté de Radu n'a en effet été suivie d'aucun des développements que lui donnent, par allusions successives, les auteurs russes et ne correspond plus au sens, si typiquement russe lui aussi, que lui donne Pouchkine, l'écart étant allé grandissant au fil de l'œuvre et l'accent principal déplacé, comme dans le final d'Aleko, sur un thème de substitution. Le livret n'est cependant pas si mauvais mais on peut regretter que Leoncavallo, qui possédait une compétence rare dans ce domaine aussi, n'ait pas poursuivi dans la voie qui lui avait ouvert le succès et continué de rédiger à chaque fois ses livrets lui-même comme son idole Wagner. S'il avait lui aussi exploité toute sa liberté créatrice, le public n'aurait peut-être pas exercé son « droit de vengeance » ; le succès se serait alors montré plus fidèle et le destin plus clément.
 Un exemple du vérisme d'Aleko
Un exemple du vérisme d'Aleko
Nécessité d'une révision de la traduction du livret
La nouvelle traduction ci-dessous tente de gommer divers défauts récurrents dans les traductions de livrets d'opéra et nous la présentons ici avec l'espoir qu'elle puisse rendre service aux compagnies théâtrales ainsi qu'aux musiciens professionnels, amateurs ou simples mélomanes soucieux de l'union entre texte et musique.
Aleko a déjà été traduit plusieurs fois mais presque toutes ces traductions souffrent du même défaut: le traducteur ne s'est manifestement occupé que du texte sans se soucier du problème, récurrent dans les traductions de livrets, de faire coïncider texte et musique de manière à ce que, dans chaque vers, les différents membres de phrases correspondent autant que possible « mot pour note » à la musique. Traduire sans avoir la partition sous les yeux produit ainsi des contresens assez gênants et des décalages sémantiques, la musique exprimant ce que le texte n'a pas encore dit, ou a déjà fini de dire. Ce défaut, qui peut avoir des conséquences catastrophiques dans la traduction d'un madrigal du XVIe siècle où le figuralisme de détail est important et constant, est certes atténué dans une partition moderne mais la phrase musicale et sa structure interne étant de toute manière calculée dans tous les cas sur la phrase textuelle, ce principe doit être considéré comme intangible.
D'autre part, la révision est toujours plus facile que la traduction car il est possible, en confrontant les différentes versions, d'adopter la solution la plus heureuse trouvée par chaque traducteur. Ces différentes solutions peuvent aussi en suggérer une meilleure encore au réviseur et lui permettre d'unifier le texte et d'en préserver le sens essentiel. Une des versions consultées traduit par exemple une fois le terme de volya, sur le sens duquel nous nous sommes longuement étendus, par volonté. Dans un autre contexte, cette traduction pourrait parfaitement se justifier mais dans Aleko elle porte préjudice à l'ensemble de l'œuvre.
Les didascalies sont supprimées dans certaines versions pour diverses mauvaises raisons : il s'agit presque toujours d'économie dans lesquelles l'éditeur préférera invoquer le manque de place (alors les livrets publiés en trois ou même quatre langues présentées en regard l'une de l'autre montrent qu'il est parfaitement possible de le faire), parfois d'insouciance ou d'incompréhension de leur raison d'être. Elles font partie du texte, elles sont le texte, et permettent, au même titre que les répliques des personnages de préciser l'action, la psychologie des personnages, l'atmosphère, la couleur locale si importante dans les opéras influencés par le vérisme, et ceci pour tout lecteur et pas uniquement pour le metteur en scène pour lequel ces indications sont primordiales pour fonder sa propre interprétation. Or Aleko est peut-être un des meilleurs exemples que l'on puisse trouver de cette absolue nécessité de ne pas amputer le texte en supprimant les didascalies : la première d'entre elles provient en effet en grande partie de la première strophe du poème versifié de Pouchkine dont le texte est également utilisé pour la première strophe du chœur des tziganes selon la répartition ci-dessous.
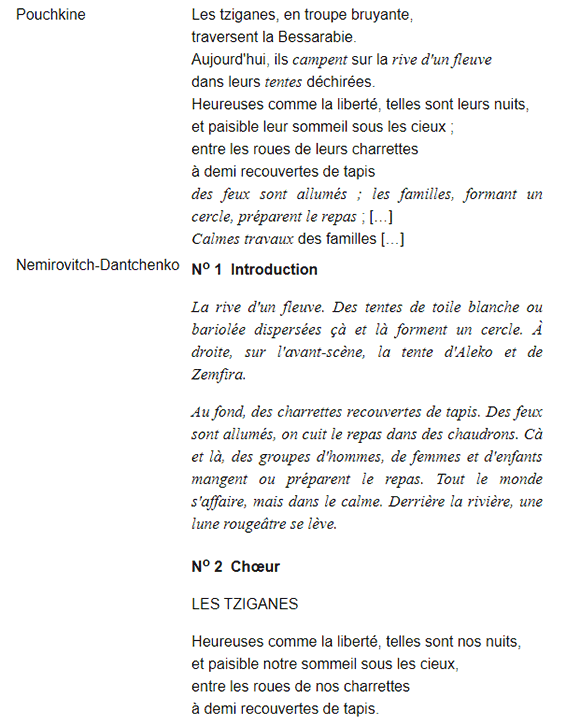
Le souci d'économie de place, et donc d'argent, produit plusieurs autres conséquences funestes. Le texte, tassé, compressé, ne respecte plus les alinéas et les strophes du poème versifié. Or, de même qu'une œuvre musicale n'est jamais indépendante de sa forme, c'est au sens du texte que l'on porte atteinte en en modifiant la forme, le but de cette dernière étant précisément, et dans tous les arts, de mettre le premier en évidence. Ceci ne gêne d'ailleurs pas seulement l'auditeur dans son effort de compréhension du sens de l'œuvre mais également l'interprète dont la mission est (ou devrait être) de découvrir d'abord ce sens par l'analyse du rapport forme / contenu puis de le rendre apparent à l'auditeur par son art.
Plus grave encore, le souci d'économie et l'incompréhension de l'importance de l'union indissociable entre le texte et la musique pousse les éditeurs et par voie de conséquence les traducteurs à adopter une disposition du texte qui s'est malheureusement généralisée dans les ensembles musicaux en rangeant les textes chantés par les divers personnages en-dessous les uns des autres au lieu de les accoler en respectant leur simultanéité. Suivre ainsi, livret en main, le déroulement d'un ensemble est difficile, voire impossible, le texte présentant successivement ce que l'on entend simultanément. Cette difficulté et l'incohérence qui en résulte peuvent même décourager nombre d'auditeurs dans leur louable intention de suivre simultanément le texte et la musique. Il préféreront alors ou lire le texte et écouter la musique séparément ou se désintéresseront du livret, ce qui est à l'opposé de l'union des arts voulue dans l'opéra et du travail du compositeur. Au contraire, le choix fait dans cette nouvelle traduction d'une disposition « en regard » permet à l'auditeur de suivre texte et musique simultanément, de savoir à tout moment ce que chante chaque personnage et surtout d'apprécier pleinement la manière dont le compositeur réagit à chaque ligne du texte. Les adjuvants en grande partie inefficaces dont se sert la disposition habituelle en mode successif pour tenter de pallier les conséquences de son absurdité, tels que la mention Ensemble et les accolades, deviennent inutiles et peuvent dès lors être supprimés.
L'exemple suivant permettra de mesurer les conséquences immenses du non-respect de la forme voulue par le librettiste et à laquelle s'est plié le compositeur et du mauvais choix de présentation de celle-ci sur la compréhension de la psychologie des personnages et le sens de l'œuvre. Une des versions publiées, une des plus mauvaises il est vrai, présente le texte suivant à la fin du no 8 :
LE JEUNE TZIGANE
Viendras-tu me retrouver ?ZEMFIRA
Lorsque la lune sera haute dans le ciel, viens, là-bas, derrière le tumulus.
LE JEUNE TZIGANE
Elle me trompera ! Elle ne viendra pas ! Dis-moi, viendras-tu me retrouver ?
ZEMFIRA
Sauve-toi, le voilà. Oui, mon bien-aimé, je viendrai.
Le souci d'une traduction plus fidèle et présentée dans une disposition qui respecte le déroulement de l'action dans la forme voulue à la fois par le librettiste et le compositeur donne en revanche le résultat suivant :
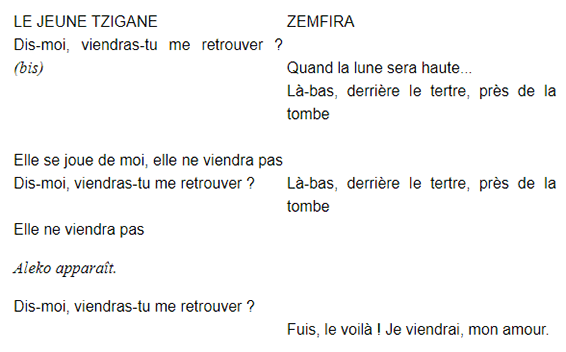
Dans le premier exemple, une partie du texte, l'allusion à la tombe ignorée par le traducteur, supprime du même coup l'annonce (tellement plus remarquable, fugitive, et subtile que l'habituelle prophétie des opéras des opéras italiens du XIXe siècle) du dénouement irrémédiable qui contredit le sens apparent de l'œuvre (l'apologie de la liberté des tziganes) en l'ancrant dans la thématique bourgeoise traditionnelle du XIXe de la triangulation et du piège moral amour / devoir dans lequel, cette liberté de l'amour, impossible, ne peut mener qu'à la mort. La seconde lacune de la première version, plus grave encore, est la suppression de la didascalie Aleko apparaît, l'autre splendide prolepse de Nemirovitch-Dantchenko dans ce fragment de son livret. Ces deux mots, à eux seuls, changent le sens de l'œuvre et justifient pleinement l'affirmation avancée supra selon laquelle les indications scéniques font partie du texte au même titre que les répliques des personnages. Le moment de l'apparition d'Aleko permet en effet au public, lors de la représentation au théâtre, ainsi qu'au lecteur du livret, de comprendre que celui-ci surprend les dernières répliques du jeune tzigane et de Zemfira et explique, tout en l'annonçant, sa vengeance à venir, créant ainsi un lien avec la suite de l'action malgré l'emploi de la vieille forme du pezzo chiuso, qui en principe a plutôt pour effet de l'interrompre, et ceci dans un duo d'amour qui est bien le moment le plus statique d'un opéra construit selon cette forme. De même, le lecteur / spectateur comprend que le jeune tzigane ne voit vraisemblablement pas Aleko survenir mais que Zemfira, elle, s'en aperçoit, que sa dernière réplique s'adresse à lui aussi et constitue non seulement une provocation, un défi à son égard mais une affirmation de sa liberté qui révèle la psychologie de son personnage. L'affirmation de Victor Serov prétendant que le librettiste n'a rien compris au thème de la liberté présent dans Pouchkine se retourne ainsi piteusement contre lui : avec quelle maestria celui-ci est évoqué, sans avoir besoin d'être même nommé !
C'est ce défi qui constitue le lien avec le no 9, la scène auprès du berceau dans laquelle Zemfira continue sa provocation. Si ce lien n'est pas rendu compréhensible par une disposition adéquate, les deux scènes semblent à l'auditeur sans rapport aucun l'une avec l'autre ou peut-être sans rapport autre que le principe d'opposition maximale entre deux scènes aussi contrastées que possible si longtemps maintenu par Verdi, dont la culture littéraire était pauvre, aux dépens de la vraisemblance, de l'unité et de la cohérence de ses livrets dans les opéras de ses années de galère. L'auditeur réagirait alors comme le critique musical des Moskovskie vedomosti dans le compte-rendu mentionné supra où il se plaint d'un « manque de cohérence entre les scènes » et de la nécessité de « ménager des ʺ ponts ʺ entre les numéros », en imputant ce défaut au compositeur, qui n'en peut mais, plutôt qu'au librettiste.
La disposition du texte adoptée dans cette nouvelle traduction présente un autre avantage majeur. Le lecteur, sans avoir besoin de recourir à la partition, s'apercevra à la seule lecture, même si c'est de façon plus ou moins consciente, de la différence de traitement des ensembles entre les numéros 4 et 8 d'une part et les numéros 9 et 13 d'autre part. Contrairement aux premiers, ces derniers suivent le principe du duo « sous forme de conversation », ou « en dialogue », préconisé par Rousseau dans sa fameuse Lettre sur la musique française dans laquelle il se plaint que « les duos sont hors de la nature : car rien n'est moins naturel que de voir deux personnes se parler durant un certain temps, soit pour dire la même chose, soit pour se contredire, sans jamais s'écouter ni se répondre. »25
Deux autres innovations de moindre importance méritent peut-être malgré tout une brève mention. Dans certains cas, au lieu de l'indication Bis traditionnelle, qui est parfois même oubliée, la répétition du texte écrit telle qu'elle se présente dans le texte de la partition peut souligner, tout en la respectant, l'intention voulue par le librettiste et le compositeur. Dans un opéra influencé par le vérisme comme l'est Aleko, l'assassinat est le climax de l'œuvre. Le traducteur doit se faire une obligation de ne pas saboter ce moment si important du drame en gommant l'insistance voulue par les auteurs. La mort du jeune tzigane est présentée ainsi dans la version déficiente précédemment citée :
ALEKO
Attends ! Où cours-tu si vite, beau garçon ? Reste couché ! (Il le poignarde).ZEMFIRA
Aleko !LE JEUNE TZIGANE
Je meurs !
Dans cette version insipide, le traducteur oublie non seulement la répétition des répliques de Zemfira et du jeune tzigane présentes dans la partition qu'il n'a vraisemblablement pas consultée mais aussi la didascalie indiquant le moment exact de la mort du jeune homme. Il est donc nécessaire de les rétablir, ce qui peut être fait aisément, par exemple de la manière suivante :
ALEKO
Halte-là !
Où cours-tu, beau jeune homme ?
Reste couché !
Il le poignarde.
ZEMFIRA
Aleko !LE JEUNE TZIGANE
Je meurs !ZEMFIRA
Aleko !LE JEUNE TZIGANE
Je meurs !
Il meurt.
La dernière observation sur la nouvelle traduction présentée ici concerne le rapport entre un texte russe versifié (Pouchkine et Nemirovitch-Dantchenko) et une traduction française qui doit nécessairement être en prose, n'importe quelle tentative de versification, même très habile, produisant immanquablement les défauts contre lesquels cette traduction tente de réagir. Cependant, dans certains cas, la musicalité si remarquable des vers de Pouchkine, qui ajoute tant à la musique, peut être au moins évoquée par l'assonance, lorsque ceci ne se fait pas au préjudice du sens. Entre autres exemples possibles, citons la romance du jeune tzigane (no 12) dont voici tout d'abord deux traductions traditionnelles, toutes deux présentées dans un texte compressé ne respectant pas la forme versifiée de l'original. La seconde n'est mentionnée (entre parenthèses) que lorsqu'elle diffère de la première.
« Regarde, sous la voûte lointaine, la lune vogue en liberté (se promène, libre). Sur toute la nature, elle répand une lueur égale (En passant, elle verse une égale clarté sur la nature entière). Qui pourrait lui indiquer un point (lui montrer sa place) dans le ciel et lui dire : Arrête-toi-là ! Et qui pourrait dire au cœur d'une jeune fille : Tu ne dois en aimer qu'un, invariablement ! (garde le même amour, ne varie point !)
La traduction présentée ici tente respecter la forme versifiée de l'original, tout en rétablissant dans le troisième vers le « en passant » (мимоходом) omis par le premier traducteur et, nous semble-t-il tout au moins, retrouve du même coup l'esprit de la romance que ces deux traductions en prose ont fait presque complètement disparaître.
Regarde, sous la voûte lointaine
la lune librement se promène ;
en passant, elle éclaire la nature entière
d'une égale lumière.Qui pourrait lui indiquer une place dans le ciel,
et lui dire: arrête-toi là ?
Qui pourrait dire au cœur d'une jeune fille:
n'aime qu'une fois et tiens-t'en là ? (Bis)
François Buhler
Mars 2015
Notes
1. Sergueï Vassilievitch Rachmaninov (Oneg, Semionovo, près de Novgorod, 20 mars / 1er avril 1873 – Beverly Hills, 28 mars 1943). La translittération moderne de Сергей Васильевич Рахманинов devrait être « Sergueï Vassilievitch Rakhmaninov ». Si celui-ci a écrit toute sa vie son nom « Serge Rachmaninoff », c'est d'une part pour se conformer à la translittération française usitée de son temps mais aussi pour tenter de faire prononcer son nom d'une manière conforme à ce qu'elle devrait être. La solution ancienne de transcrire par ff le в final n'était pas si catastrophique, cette lettre, qui correspond au v français, se prononçant en effet f en fin de mot. Le remplacement de ce ff par le v est cependant une solution plus heureuse puisqu'elle supprime le problème de donner à une même lettre russe deux orthographes françaises différentes et aboutit ainsi à la généralisation qui est l'un des objectifs essentiels que doit se proposer toute translittération. C'est là la seule raison pour laquelle nous continuons dans cet article à écrire ch au lieu du kh adopté partout ailleurs pour transcrire le x russe, qui se prononce comme la jota espagnole, tout en regrettant profondément de devoir perpétuer cette erreur au nom de l'usage plutôt que de la corriger.
2. Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, poète dramaturg et romancier (Moscou, 26 mai/ 6 juin - Saint-Pétersbourg, 29 janvier / 10 février 1837).
3. Ces deux opéras sont créés sous la direction du compositeur au cours de la même soirée du 11 janvier 1906 au Théâtre Bolchoï de Moscou où Rachmaninov avait accepté un engagement comme chef d'orchestre pour deux saisons à partir de septembre 1904.
Скyпoй рыцaрь (Le chevalier avare) op. 24 est un opéra en trois tableaux composé entre août 1903 et février 1905 sur la tragédie d'Alexandre Pouchkine dont le texte est repris presque mot pour mot par Rachmaninov. L'orchestration en est achevée en juin 1905, soit un mois avant celle de Francesca da Rimini.
Francesca da Rimini op. 25 est un opéra en un prologue, deux tableaux et un épilogue dont le livret est écrit par Modeste Tchaïkovski d'après le 5e Chant de L'Enfer de Dante. Rachmaninov en compose dès 1900 la scène 2 puis délaisse l'œuvre quelque temps. Le manuscrit de la partition pour chant et piano porte les dates du 25 mai au 30 juillet 1904 et l'orchestration est achevée en juillet 1905.
4. Пиковая дама (La Dame de pique) est un opéra en 3 actes composé à Florence du 19 / 31 janvier au 2 / 15 mars 1890, puis révisé en juin de la même année, sur un livret de Modeste Tchaïkovski d'après la nouvelle fantastique de Pouchkine de 1833 dont Tchaïkovski modifie cependant sensiblement l'époque et l'action et à laquelle il ajoute un nouveau personnage, tout en empruntant également à d'autres poètes russes tels que Joukovski et Derjavine.
5. Ce célèbre opéra en un acte, composé par Pietro Mascagni en 1889 sur un livret de Giovanni Targioni-Tozzetti et Guido Menasci d'après le drame et la nouvelle extraits de La Vita dei campi (1880) de Giovanni Verga, et créé à Rome au Théâtre Costanzi le 17 mai 1890, est la première œuvre majeure produite par le concours annuel lancé par l'éditeur Edoardo Sonzogno en 1883 et marque la naissance officielle du vérisme musical. Le succès en est stupéfiant : le compositeur devient instantanément célèbre et son œuvre, pendant les seules années 1890-91, est jouée dans 290 théâtres à travers le monde. L'influence de Mascagni et du vérisme se fait d'ailleurs encore sentir dans les opéras ultérieurs de Rachmaninov, en particulier dans le second tableau de Francesca da Rimini. Par la suite, Cavalleria rusticana et Aleko seront plusieurs fois représentés ensemble au Théâtre Bolchoï de Moscou.
6. ANDRE LISCHKE, Histoire de la musique russe des origines à la Révolution, Fayard, 2006, p. 487.
7. Nikolaï Sergeïevitch Zverev (Volokolamsk,1832 – 30 septembre / 12 octobre 1893) est un pianiste et professeur connu surtout par ses élèves Alexander Siloti, Sergueï Rachmaninov, Alexandre Scriabine, Konstantin Igoumnov, Alexandre Goldenweiser, Léonide Maximov, Fiodor Keneman, Matvei Pressman, Semeon Samuelson, etc. Totalement dévoué à ses élèves, Zverev les logeait chez lui et les traitait comme ses propres enfants. Il ne se maria jamais et il est probable qu'il était un homosexuel refoulé. Voici un extrait des souvenirs de Rachmaninov : « C'était un homme d'une intelligence, d'une générosité et d'une amabilité rares […] Il donnait l'impression d'être complètement fou de nous, ses élèves. Il ne nous demanda jamais le moindre centime en paiement, ni pour les leçons ni pour la pension (après tout, c'est dans sa maison que nous vivions). Il nous habillait chez les meilleurs tailleurs, nous ne manquions jamais une première dans les théâtres - musicaux ou dramatiques - de Moscou. Il va de soi que nous ne rations aucun concert de qualité vraiment supérieure. Et c'était une époque où l'offre était très grande: prenez par exemple les fameux concerts historiques d'Anton Rubinstein où nous avions l'occasion d'entendre tout ce qu'il y avait de plus grand ! » (Cité par Davide Polovineo, « Rachmaninoff. Les débuts. Comment enseigne-t-on aux génies ? » (21 avril 2008, Moscow Time), in Giornale dell'Istituto Europeo di Musica 1 (2011), p. 12).
8. Soit une réduction pour deux pianos de la symphonie Manfred de Tchaïkovski (1886); un Scherzo pour orchestre en ré mineur (février 1887) ; les Nocturnes pour piano n° 1 en fa dièse mineur, n° 2 en fa majeur (1887) et n° 3 en do mineur (1888) ; quatre pièces pour piano restées inédites de son vivant (Romance en fa dièze mineur, Prélude en mib mineur, Mélodie en mib majeur, Gavotte en ré majeur, c. 1888) ; quelques ébauches pour un opéra, Esmeralda, d'après Notre-Dame de Paris de Hugo (1888) dont il subsiste l'Introduction à l'Acte 1 et des fragments de l'acte 3 en une version pour piano datée du 17 / 30 octobre 1888 ; des esquisses d'un concerto de piano en do mineur (1889) ; deux mouvements d'un quatuor à cordes dédié à Alexandre Ziloti, soit une Romance en sol mineur et un Scherzo en ré majeur qui ne furent créés dans la version originale qu'en octobre 1945 à Moscou par le Quatuor Beethoven après une version, probablement pour orchestre, donnée le 24 février / 9 mars 1891 au Conservatoire de Moscou (1889) ; peut-être un Quintette à cordes (perdu) ; le motet à six voix Deux meus (1890), vraisemblablement en tant qu'exercice en classe de contrepoint ; les premières mélodies et autres œuvres vocales : Devant la porte d'une sainte demeure (Lermontov, 29 avril / 12 mai 1890), Je ne te dirai rien, (Fet, composé deux jours plus tard),Tu as fait vibrer mon cœur à nouveau (Grekov, non daté mais probablement aussi de 1890), ainsi que deux monologues de Boris Godounov (Pouchkine), Toi, Père patriarche, Encore une dernière histoire, le monologue d'Arbénine pour basse et piano (tiré du drame en 4 actes Mascarade de Mikhaïl Lermontov, 1835), un fragment de Mazeppa (Pouchkine, Poltava, 1828) à 4 voix, C'était en avril (Pailleron, 1er / 14 avril 1891) et Il commence à faire nuit (Tolstoï, 22 avril / 5 mai 1891); une Romance pour violoncelle et piano dédiée à Vera Skalon (6 / 19 août 1890) ; un Prélude pour piano en fa majeur (1891) tourné par la suite en un Prélude pour violoncelle et piano (1892) ; une Rhapsodie russe pour deux pianos en mi mineur (1891) ; une Valse pour piano à six mains en la majeur (15 / 28 août 1890) et une Romance en la majeur (1891) également composées pour les trois sœurs Skalon ; des ébauches pour deux mouvements au moins d'un poème symphonique, Manfred, probablement inspiré par la symphonie de Tchaïkovski qu'il avait réduite pour piano à quatre mains en 1886 et dont la partition est malheureusement perdue ; son Concerto n° 1 pour piano en fa dièse mineur (1890-91, achevé le 6 / 19 juillet 1891) qui sera revu en 1917 ; le premier mouvement d'une symphonie, Jeunesse ; une Suite orchestrale (perdue) ; un poème symphonique en ré mineur, князь ростислав (Le Prince Rostislav) d'après le roman historique d'Alexeï Tolstoï князь серебряный (Le Prince Serebryanni, 1863) et dédié à Anton Stepanovitch Arenski (9 / 22 – 15 / 28 décembre 1891) et le 1er Trio élégiaque en sol mineur pour piano, violon et violoncelle (18 / 31 janvier - 21 janvier / 3 février 1892) dont la première a lieu à Moscou neuf jours plus tard.
9. Cette lettre et les suivantes proviennent toutes du recueil de la correspondance de Rachmaninov édité par З. А. AПETЯН, С. В. Рахманинов, пиcьмa, Moscou, Muzgiz, 1955 (en russe). Celle du 30 avril mise à part, elles sont citées par GEOFFREY NORRIS dans son article Rakhmaninov's student opera, The Musical Quarterly, LIX/3, juillet 1973.
10. Il s'agit des deux pièces instrumentales de l'opéra, les n° 5, « Danse des femmes » et 6, « Danse des hommes », par lesquels Rachmaninov commence donc son œuvre.
11. Karl Alexandrovitch Gutheil s'occupe tout d'abord de la maison d'édition Stellovski puis reprend celle de son père à la mort de celui-ci en 1883 et opère la fusion entre les deux firmes trois ans plus tard. Les Editions russes de musique fondées en 1909 par Serge Koussevitski avec l'aide de Rachmaninov rachètent la firme Karl Gutheil à la mort de celui-ci en 1914.
A la recherche d'un jeune compositeur prometteur et encouragé par la chaude recommandation de Zverev, Gutheil offre à Rachmaninov la somme de 500 roubles pour son opéra et achète en même temps les droits de ses deux pièces pour violoncelle et piano op. 2 et de son premier cycle de mélodies op. 4. Cette offre représentait une grande chance pour la carrière future de Rachmaninov et la somme avancée lui parut être une petite fortune. Il ne gagnait en effet à cette époque que 15 roubles par mois grâce aux leçons privées données à son unique élève.
12. Il est vraisemblable que l'origine du mot gitan soit précisément le mot égyptien.
13. ALLA POLOSINA, in La bohémienne : figure poétique de l'errance aux XVIIIe et XIXe siècles, actes du colloque du Centre de recherches révolutionnaires et romantiques, Université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand, 12, 13, 14 mars 2003), Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2006, p. 226-227.
14. ALLA POLOSINA, op. cit. p. 229.
15. MAXIME GORKI, Nouvelles, contes et poèmes, 1892-1894, Hier et aujourd'hui, Les Editeurs Français Réunis, 1950, p. 18.
16. ELENA SAPRYKINA, in La bohémienne : figure poétique de l'errance aux XVIIIe et XIXe siècles, op. cit. p. 237.
17. ELENA SAPRYKINA, op. cit. p. 238.
18. VICTOR SEROFF, Rachmaninoff, Robert Laffont, Paris, 1954, p. 54.
19. Vladimir Ivanovitch Nemirovitch-Dantchenko (Ozourgeti, 11 / 23 décembre 1858 - Moscou, 25 avril 1943).
20. À l'exception de la chanson de Zemfira dans la scène auprès du berceau (n° 9) qui est en hexamètres.
21. Entre autres Mikhaïl Vielgorski (1824), Alexeï Verstovski (1832), Alexandre Gouriliov (1849), Vladimir Kachperov (1850), Alexandre Alyabev (1860), Piotr Tchaïkovski (dans les années 1860), Anton Rubinstein (1868), Sofia Zybina (1880), Pauline Viardot (1882), Vissarion Chebaline (1947).
22. Nous ne nous risquerons pas sur l'étymologie des prénoms d'Aleko et de Zemfira utilisés par Pouchkine et conservés par Nemirovitch-Dantchenko. Il est toutefois certain qu'Aleko est encore un prénom usuel en Bulgarie. En Russie en revanche, ce prénom est inconnu. Quant à Zemfira, certains lui donnent une origine kazakhe, d'autres y voient un mélange extrêmement intéressant entre les régions linguistiques hongroises et roumaines de la grande Hongrie. Zemfira viendrait alors à la fois du prénom roumain masculin Zamfir, qui a d'ailleurs aujourd'hui encore un équivalent féminin en Zamfirica, et du prénom hongrois féminin Zamira. Ce prénom de Zemfira, bien que très rare, est encore porté à l'heure actuelle mais, comme pour Aleko, nous ne sommes pas qualifiés pour nous prononcer sur sa prévalence chez les tziganes. En revanche, un détail que personne ne semble avoir encore signalé à ce jour, la présence très fugitive d'un Alenko, un enfant probablement, dans I Zingari pourrait bien renforcer la thèse d'une filiation créatrice entre Aleko et I Zingari.
23. Le vérisme proprement dit se limite en effet à deux seules œuvres, Cavalleria rusticana de Mascagni (1890) et l'infiniment remarquable I Pagliacci de Leoncavallo (1892, soit la même année qu'Aleko) dont le rapport entre le texte et la musique (Leoncavallo, qui fit des études littéraires, est son propre librettiste dans cette œuvre) et l'introduction parfaitement réussie du théâtre dans le théâtre dans son œuvre donne une nouvelle dimension à l'opéra, très éloignée de la vulgarité que lui reprochent les commentateurs qui n'ont pas su s'en apercevoir. Malgré leur énorme succès, le ver est déjà dans le fruit comme le montre le fait que ces deux œuvres sont soumises à des procès. Après 1892 intervient, d'abord timide puis de plus en plus violente, la réaction du public bourgeois des théâtres d'opéra qui se lasse vite du plaisir de s'encanailler dans ce petit monde de paysans siciliens, de romanichels, d'assassins, de prostituées, ce vulgum pecus… « Mais enfin, mon cher », entend-on alors de plus en plus souvent dans les foyers des théâtres d'opéra et les discussions animées des connaisseurs, « ces platitudes, ces grossièretés de langage, ces mœurs, ces assassinats sur scène … leur place est dans la rue, mais ici, à l'Opéra, voyons, une telle indécence, une telle vulgarité, c'est vraiment indigne de notre monde ! » Sous l'effet de cette récupération progressive par la bourgeoisie de son temple, le vérisme d'origine s'édulcore et infléchit son cours. Intervient alors la période mixte des compositeurs partiellement véristes qui restent tentés par les effets à succès mais rendent à ce haut-lieu de la bourgeoisie qu'est l'Opéra une image d'elle-même plus conforme à ses exigences en plaçant sur scène des personnages plus « dignes » : c'est la période des grands succès de Cilea, Giordano, Puccini surtout, celle qui voit dès 1896 le bohémien italien inculte se transformer en poète bohème parisien. Quelques années encore et le vérisme meurt, « assassiné » par la bourgeoisie ; le rideau tombe alors sur ce qui ne fut, dans l'histoire de l'opéra, qu'un « épisode », mais d'un apport de grande valeur.
24. Phénomène du Mezzogiorno de réaction contre l'internationalisme avec emploi de la couleur locale, du dialecte ou du langage populaire, des mélodies populaires et exaltation du patriotisme ; tentative de représentation de la réalité, du vrai ; personnages provenant uniquement de la plus basse couche sociale (illettrés, voleurs, forçats, prostituées), d'où l'importance particulière des chœurs ; sujet contemporain, en général un fait-divers du crime ; tranche de vie (bozzetto), soit un seul acte ou deux (Kurzoper); structure générale de l'action en crescendo dramatique aboutissant à un climax correspondant à l'assassinat et à la chute quasi simultanée du rideau ; rapidité de l'action et intensité expressive ; simplicité extrême de l'action et nombre de personnages réduit ; simplicité des passions, des personnages, des décors, de la musique, laquelle est mélodique avant tout et donne priorité au texte ; violence, instincts primaires et bestiaux, nudité des passions, amour sexuel primaire, préjugés, croyances populaires, superstition ; bruitages divers (soupirs, sanglots, cris, hurlements, gifles, coups, cloches, galop de cheval, coups de fouet) ; choix déterminant du livret, plus important que la musique ; importance de l'action théâtrale, des décors et des indications scéniques (didascalies); dramatisation extrême, choix délibéré et unilatéral du malheur par réaction au lieto fine (le vérisme aboutit ainsi à une représentation partiale de la réalité); extrémisme, recherche de l'effet maximum tant dans le texte que dans la musique (changements dynamiques très fréquents et très rapprochés, nuances exagérées, souvent irréalisables, allant parfois jusqu'à un sextuple p à un sextuple f chez Puccini, longues pauses dramatiques, batteries, septièmes diminuées, etc.) ; recherche du succès avec exploitation plus délibérée qu'intuitive d'une demande du public, assujettissement à une mode qui « paie », opportunisme, etc.
25. JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Ecrits sur la musique, Stock Musique, 1979, p. 291.
© musicologie.org




 À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISSN 2269-9910.
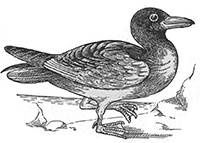
Lundi 23 Septembre, 2024 1:50

