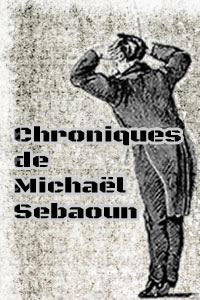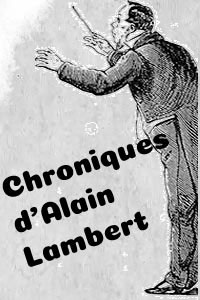Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780), Essai sur l'origine des connoissances humaines [...], Amsterdam, P. Mortier 1746.

Chapitre v
de la musique.
Jusqu’ici j’ai été obligé de supposer que la musique était connue des anciens : il est à propos d’en donner l’histoire, du moins en tant que cet art fait partie du langage.
§. 43. Dans l’origine des langues, la prosodie étant fort variée, toutes les inflexions de la voix lui étaient naturelles. Le hasard ne pouvait donc manquer d’y amener quelquefois des passages dont l’oreille était flattée. On les remarqua, et l’on se fit une habitude de les répéter : telle est la première idée qu’on eut de l’harmonie.
§. 44. L’ordre diatonique, c’est-à-dire, celui où les sons se succèdent par tons et demi-tons, paraît aujourd’hui si naturel, qu’on croirait qu’il a été connu le premier ; mais si nous trouvons des sons dont les rapports soient beaucoup plus sensibles, nous aurons droit d’en conclure que là succession en a été remarquée auparavant.
Puisqu’il est démontré que la progression par tierce, par quinte et par octave, tient immédiatement au principe où l’harmonie prend son origine, c’est-à-dire, à la résonnance des corps sonores, et que l’ordre diatonique s’engendre de cette progression ; c’est une conséquence que les rapports des sons doivent être bien plus sensibles dans la succession harmonique que dans l’ordre diatonique. Celui-ci en s’éloignant du principe de l’harmonie, ne peut conserver des rapports entre les sons, qu’autant qu’ils lui sont transmis par la succession qui l’engendre. Par exemple, ré, dans l’ordre diatonique, n’est lié à ut, que parce qu’ut, ré, est produit par la progression ut, sol ; et la liaison de ces deux derniers a son principe dans l’harmonie des corps sonores, dont ils font partie. L’oreille confirme ce raisonnement ; car elle sent mieux le rapport des sons ut, mi, sol, ut, que celui des sons ut, ré, mi, fa. Les intervalles harmoniques ont donc été remarqués les premiers.
Il y a encore ici des progrès à observer ; car les sons harmoniques formant des intervalles plus ou moins faciles à entonner, et ayant des rapports plus ou moins sensibles, il n’est pas naturel qu’ils aient été aperçus et saisis aussitôt les uns que les autres. Il est donc vraisemblable qu’on n’a eu cette progression entière ut, mi, sol, ut, qu’après plusieurs expériences. Celle-là connue, on en fit d’autres sur le même modèle telles que sol, si, ré, sol. Quant à l’ordre diatonique, on ne le découvrit que peu-à-peu et qu’après beaucoup de tâtonnements, puisque la génération n’en a été montrée que de nos jours1
§. 45. Les premiers progrès de cet art ont donc été le fruit d’une longue expérience. On en a multiplié les principes, tant qu’on n’en a pas connu les véritables. M. Rameau, est le premier qui ait vu l’origine de toute l’harmonie dans la résonnance des corps sonores et qui ait rappelé la théorie de cet art à un seul principe. Les Grecs, dont on vante si fort la musique, ne connaissaient point, non plus que les Romains, la composition à plusieurs parties. Il est cependant vraisemblable qu’ils ont de bonne heure pratiqué quelques accords, soit que le hasard les leur eût fait remarquer à la rencontre de deux voix, soit qu’en pinçant en même temps deux cordes d’un instrument, ils en eussent senti l’harmonie.
§. 46. Les progrès de la musique ayant été aussi lents, on fut longtemps avant de songer à la séparer des paroles : elle eut paru tout-à-fait dénuée d’expression. D’ailleurs la prosodie s’étant saisie de tous les tons que la voix peut former, et ayant seule fourni l’occasion de remarquer leur harmonie ; il était naturel de ne regarder la musique que comme un art qui pouvait donner plus d’agrément ou plus de force au discours. Voilà l’origine du préjugé des anciens qui ne voulaient pas qu’on la séparât des paroles. Elle fut, à-peu-près, à l’égard de ceux chez qui elle prit naissance, ce qu’est la déclamation par rapport à nous : elle apprenait à régler la voix, au lieu qu’auparavant on la conduisait au hasard. Il devait paraître aussi ridicule de séparer le chant des paroles, qu’il le serait aujourd’hui de séparer de nos vers les sons de notre déclamation.
§. 47. Cependant la musique se perfectionna : peu-à-peu elle parvint à égaler l’expression des paroles : ensuite elle tenta de la surpasser. C’est alors qu’on put s’apercevoir qu’elle était par elle-même susceptible de beaucoup d’expression. Il ne devait donc plus paraître ridicule de la séparer des paroles. L’expression que les sons avaient dans la prosodie qui participait du chant, celle qu’ils avaient dans la déclamation qui était chantante, préparaient celle qu’ils devaient avoir lorsqu’ils seraient entendus seuls. Deux raisons assurèrent même le succès à ceux qui, avec quelque talent, s’essayèrent dans ce nouveau genre de musique. La première, c’est que sans doute ils choisissaient les passages auxquels, par l’usage de la déclamation, on était accoutumé d’attacher une certaine expression, ou que du moins ils en imaginaient de semblables. La seconde, c’est l’étonnement que, dans sa nouveauté, cette musique ne pouvait manquer de produire. Plus on était surpris, plus on devait se livrer à l’impression qu’elle pouvait occasionner. Aussi vit-on ceux qui étaient moins difficiles à émouvoir, passer successivement, par la force des sons, de la joie à la tristesse, ou même à la fureur. A cette vue, d’autres qui n’auraient point été remués, le furent presque également Les effets de cette musique devinrent le sujet des conversations, et l’imagination s’échauffait au seul récit qu’on en entendait faire. Chacun voulait en juger par soi-même ; et les hommes, aimant communément à voir confirmer les choses extraordinaires, venaient entendre cette musique avec les dispositions les plus favorables. Elle répéta donc souvent les mêmes miracles.
§. 48. Aujourd’hui notre prosodie et notre déclamation sont bien loin de préparer les effets que notre musique devrait produire. Le chant n’est pas, à notre égard, un langage aussi familier qu’il l’était pour les anciens ; et la musique, séparée des paroles, n’a plus cet air de nouveauté, qui seul peut beaucoup sur l’imagination. D’ailleurs, au moment où elle s’exécute, nous gardons tout le sang-froid dont nous sommes capables, nous n’aidons point le musicien à nous en retirer, et les sentiments que nous éprouvons naissent uniquement de l’action des sons sur l’oreille. Mais les sentiments de l’âme sont ordinairement si faibles, quand l’imagination ne réagit pas elle-même sur les sens, qu’on ne devrait pas être surpris que notre musique ne produisît pas des effets aussi surprenants que celle des anciens. Il faudrait, pour juger de son pouvoir, en exécuter des morceaux devant des hommes qui auraient beaucoup d’imagination, pour qui elle aurait le mérite de la nouveauté, et dont la déclamation, faite d’après une prosodie qui participerait du chant, serait elle-même chantante. Mais cette expérience serait inutile, si nous étions aussi portés à admirer les choses qui sont proches de nous, que celles qui s’en éloignent.
§. 49. Le chant fait pour des paroles est aujourd’hui si différent de notre prononciation ordinaire et de notre déclamation, que l’imagination a bien de la peine à te prêter à l’illusion de nos tragédies mises en musique. D’un autre côté les Grecs étaient bien plus sensibles que nous, parce qu’ils avaient l’imagination plus vive. Enfin, les musiciens prenaient les moments les plus favorables pour les émouvoir. Alexandre, par exemple, était à table, et comme le remarque M. Burette2, il était vraisemblablement échauffé par les fumées du vin, quand une musique propre à inspirer la fureur, lui fit prendre ses armes. Je ne doute pas que nous n’ayons des soldats à qui le seul bruit des tambours et des trompettes en ferait faire autant. Ne jugeons donc pas de la musique des anciens par les effets qu’on lui attribue, mais jugeons-en par les instruments dont ils avaient l’usage, et l’on aura lieu de présumer qu’elle devait être inférieure à la nôtre.
§. 5o. On peut remarquer que la musique, séparée des paroles, a été préparée chez les Grecs par des progrès semblables à ceux auxquels les Romains ont dû l’art des pantomimes ; et que ces deux arts ont, à leur naissance, causé la même surprise chez ces deux peuples, et produit des effets aussi surprenants. Cette conformité me paraît curieuse, et propre à confirmer mes conjectures.
§. 51. Je viens de dire, d’après tous ceux qui ont écrit sur cette matière, que les Grecs avaient l’imagination plus vive que nous. Mais je ne sais si la vraie raison de cette différence est connue : il me semble au moins qu’on a tort de l’attribuer uniquement au climat. En supposant que celui de la Grèce se fût toujours conservé tel qu’il était, l’imagination de ses habitants devait, peu-à-peu, s’affaiblir. On va voir que c’est un effet naturel des changements qui arrivent au langage.
J’ai remarqué ailleurs3 que l’imagination agit bien plus vivement dans des hommes qui n’ont point encore l’usage des signes d’institution : par conséquent, le langage d’action étant immédiatement l’ouvrage de cette imagination, il doit avoir plus de feu. En effet, pour ceux à qui il est familier, un seul geste équivaut souvent à une longue phrase. Par la même raison, les langues faites sur le modèle de ce langage, doivent être les plus vives ; et les autres doivent perdre de leur vivacité, à proportion que, s’éloignant davantage de ce modèle, elles en conservent moins le caractère. Or, ce que j’ai dit sur la prosodie, fait voir que, par cet endroit, la langue grecque se ressentait plus qu’aucune autre des influences du langage d’action ; et ce que je dirai sur les inversions, prouvera que ce n’était pas là les seuls effets de cette influence. Cette langue était donc très propre à exercer l’imagination. La nôtre, au contraire, est si simple dans sa construction et dans sa prosodie, qu’elle ne demande presque que l’exercice de la mémoire. Nous nous contentons, quand nous parlons des choses, d’en rappeler les signes, et nous en réveillons rarement les idées. Ainsi l’imagination moins souvent remuée, devient naturellement plus difficile à émouvoir. Nous devons donc l’avoir moins vive que les Grecs.
§. 52. La prévention pour la coutume a été, de tout temps, un obstacle aux progrès des arts : la musique s’en est surtout ressentie. Six cents ans avant J. C. Timothée fut banni de Sparte par un décret des Éphores, pour avoir, au mépris de l’ancienne musique, ajouté trois cordes à la lyre ; c’est-à-dire, pour avoir voulu la rendre propre à exécuter des chants plus variés et plus étendus : tels étaient les préjugés de ces temps-là. Nous en avons de semblables, on en aura encore après nous, sans jamais se douter qu’ils puissent un jour être trouvés ridicules. Lulli, que nous jugeons aujourd’hui si simple et si naturel, a paru outré dans son temps. On disait que, par ses airs de ballets, il corrompait la danse, et qu’il en allait faire un baladinage. « Il y a six-vingts ans, dit l’abbé du Bos, que les chants qui se composaient en France n’étaient, généralement parlant, qu’une suite de notes longues.... et.... il y a quatre-vingts ans que le mouvement de tous les airs de ballet était un mouvement lent, et leur chant, s’il est permis d’user de cette expression, marchait posément, même dans sa plus grande gaieté ». Voilà la musique que regrettaient ceux qui blâmaient Lulli.
§. 53. La musique est un art où tout le monde se croit en droit de juger, et où, par conséquent, le nombre des mauvais juges est bien grand. Il y a, sans doute, dans cet art, comme dans les autres, un point de perfection dont il ne faut pas s’écarter : voilà le principe ; mais qu’il est vague ! Qui, jusqu’ici, a déterminé ce point ? et s’il ne l’est pas, à qui est-ce à le reconnaître ? Est-ce aux oreilles peu exercées, parce qu’elles sont en plus grand nombre ? Il y a donc eu un temps où la musique de Lulli a été justement condamnée. Est-ce aux oreilles savantes, quoiqu’en petit nombre ? Il y a donc aujourd’hui une musique qui n’en est pas moins belle, pour être différente de celle de Lulli.
Il devait arriver à la musique d’être critiquée à mesure qu’elle se perfectionnerait davantage, surtout si les progrès en étaient considérables et subits : car alors elle ressemble moins à ce qu’on est accoutumé d’entendre. Mais commence-t-on à se la rendre familière, on la goûte et elle n’a plus que le préjugé contre elle.
§. 54. Nous ne saurions connaître quel était le caractère de la musique instrumentale des anciens, je me bornerai à faire quelques conjectures sur le chant de leur déclamation.
Il s’écartait vraisemblablement de leur prononciation ordinaire à-peu-près comme notre déclamation s’éloigne de la nôtre, et se variait également selon le caractère des pièces et des scènes. Il devait être aussi simple dans la comédie que la prosodie le permettait. C’était la prononciation ordinaire qu’on n’avait altérée qu’autant qu’il avait fallu pour en apprécier les sons, et pour conduire la voix par des intervalles certains.
Dans la tragédie, le chant était plus varié et plus étendu, et principalement dans les monologues auxquels on donnait le nom de cantiques. Ce sont ordinairement les scènes les plus passionnées ; car il est naturel que le même personnage, qui se contraint dans les autres, se livre, quand il est seul, à toute l’impétuosité des sentiments qu’il éprouve. C’est pourquoi les poètes romains faisaient mettre les monologues en musique par des musiciens de profession. Quelquefois même ils leur laissaient le soin de composer la déclamation du reste de la pièce. Il n’en était pas de même chez les Grecs ; les poètes y étaient musiciens, et ne confiaient ce travail à personne.
Enfin, dans les chœurs, le chant était plus chargé que dans les autres scènes : c’étaient les endroits où le poète donnait le plus d’essor à son génie, il n’est pas douteux que le musicien ne suivît son exemple. Ces conjectures se confirment par les différentes sortes d’instruments dont on accompagnait la voix des acteurs ; car ils avaient une portée plus ou moins étendue selon le caractère des paroles.
Nous ne pouvons pas nous représenter les chœurs des anciens par ceux de nos opéras. La musique en était bien différente, puisqu’ils ne connaissaient pas la composition à plusieurs parties ; et les danses étaient peut-être encore plus éloignées de ressembler à nos ballets. « Il est facile de concevoir, dit l’abbé du Bos, qu’elles n’étaient autre chose que les gestes et les démonstrations que les personnages des chœurs faisaient pour exprimer leurs sentiments, soit qu’ils parlassent, soit qu’ils témoignassent, par un jeu muet, combien ils étaient touchés de l’événement auquel ils devaient s’intéresser. Cette déclamation obligeait souvent les chœurs à marcher sur la scène ; et comme les évolutions, que plusieurs personnes font en même temps, ne se peuvent faire sans avoir été concertées auparavant, quand on ne veut pas qu’elles dégénèrent en une foule, les anciens avaient prescrit certaines règles aux démarches des chœurs ». Sur des théâtres aussi vastes que ceux des anciens, ces évolutions pouvaient former des tableaux bien propres à exprimer les sentiments dont le chœur était pénétré.
§. 55. L’art de noter la déclamation, et de l’accompagner d’un instrument, était connu à Rome dès les premiers temps de la république. La déclamation y fut, dans les commencements, assez simple : mais par la suite, le commerce des Grecs y amena des changements. Les Romains ne purent résister aux charmes de l’harmonie et de l’expression de la langue de ce peuple. Cette nation polie devint l’école où ils se formèrent le goût pour les lettres, les arts et les sciences : et la langue Latine se conforma au caractère de la langue Grecque, autant que son génie put le permettre.
Cicéron nous apprend que les accents qu’on avait empruntés des étrangers, avaient changé, d’une manière sensible, la prononciation des Romains. Ils occasionnèrent, sans doute, de pareils changements dans la musique des pièces dramatiques : l’un est une suite naturelle de l’autre. En effet, Horace et cet orateur remarquent que les instruments qu’on employait au théâtre de leur temps, avaient une portée bien plus étendue que ceux dont on s’était servi auparavant ; que l’acteur, pour les suivre, était obligé de déclamer sur un plus grand nombre de tons, et que le chant était devenu si pétulant qu’on n’en pouvait observer la mesure qu’en s’agitant d’une manière violente. Je renvoie à ces passages, tels que les rapporte l’abbé du Bos, afin qu’on juge si l’on peut les entendre d’une simple déclamation4
§. 56. Telle est l’idée qu’on peut se faire de la déclamation chantante et des causes qui l’ont introduite, ou qui l’ont fait varier. Il nous reste à rechercher les circonstances qui ont occasionné une déclamation aussi simple que la nôtre, et des spectacles si différents de ceux des anciens.
Le climat n’a pas permis aux peuples froids et flegmatiques du Nord de conserver les accents et la quantité que la nécessité avait introduits dans la prosodie à la naissance des langues. Quand ces barbares eurent inondé l’empire romain et qu’ils en eurent conquis toute la partie occidentale, le latin, confondu avec leurs idiomes, perdit son caractère. Voilà d’où nous vient le défaut d’accent que nous regardons comme la principale beauté de notre prononciation. Cette origine ne prévient pas en sa faveur. Sous l’empire de ces peuples grossiers, les lettres tombèrent, les théâtres furent détruits, l’art des pantomimes, celui de noter la déclamation et de la partager entre deux comédiens, les arts qui concourent à la décoration des spectacles, tels que l’architecture, la peinture, la sculpture, et tous ceux qui sont subordonnés à la musique, périrent. A la renaissance des lettres, le génie des langues était si changé, et les mœurs si différentes, qu’on ne put rien comprendre à ce que les anciens rapportaient de leurs spectacles.
Pour concevoir parfaitement la cause de cette révolution, il ne faut que se rappeler ce que j’ai dit sur l’influence de la prosodie. Celle des Grecs et des Romains était si caractérisée qu’elle avait des principes fixes, et si connus que le peuple même sans en avoir étudié les règles, était choqué des moindres défauts de prononciation. C’est là ce qui fournit les moyens de faire un art de la déclamation et de l’écrire en notes : dès lors cet art fit partie de l’éducation.
La déclamation ainsi perfectionnée, produisit l’art de partager le chant et les gestes entre deux comédiens, celui des pantomimes ; et étendant même, son influence jusque sur la forme et la grandeur des théâtres, elle donna occasion, comme nous l’avons vu, de les faire assez vastes pour contenir une partie considérable du peuple.
Voilà l’origine du goût des anciens pour les spectacles, pour les décorations, et pour tous les arts qui y sont subordonnés, la musique, l’architecture, la peinture et la sculpture. Chez eux, il ne pouvait presque pas y avoir de talents perdus, parce que chaque citoyen rencontrait, à tous moments, des objets propres à exercer son imagination.
Notre langue n’ayant presque point de prosodie, la déclamation n’a pu avoir de règles fixes, il nous a été impossible de la partager entre deux acteurs ; celui des pantomimes a peu d’attraits pour nous, et les spectacles ont été renfermés dans des salles où le peuple n’a pu assister. De là, ce qui est plus à regretter, le peu de goût que nous avons pour la musique, l’architecture, la peinture et la sculpture. Nous croyons seuls ressembler aux anciens ; mais que, par cet endroit, les Italiens leur ressemblent bien plus que nous. On voit donc que, si nos spectacles sont si différents de ceux des Grecs et des Romains, c’est un effet naturel des changements arrivés dans la prosodie.
Chapitre vi
Comparaison de la déclamation chantante
et de la déclamation simple.
§. 57. Notre déclamation admet de temps en temps des intervalles aussi distincts que le chant. Si on ne les altérait qu’autant qu’il serait nécessaire pour les apprécier, ils n’en seraient pas moins naturels, et l’on pourrait les noter. Je crois même que le goût et l’oreille font préférer au bon comédien les sons harmoniques, toutes les fois qu’ils ne contrarient point trop notre prononciation ordinaire. C’est sans doute pour ces sortes de sons que Molière avait imaginé des notes5. Mais le projet de noter le reste de la déclamation est impossible ; car les inflexions de la voix y sont si faibles que, pour en apprécier les tons, il faudrait altérer les intervalles, au point que la déclamation choquerait ce que nous appelons la nature.
§. 58. Quoique notre déclamation ne reçoive pas, comme le chant, une succession de sons appréciables, elle rend cependant les sentiments de l’âme assez vivement pour remuer ceux à qui elle est familière, ou qui parlent une langue dont la prosodie est peu variée et peu animée. Elle produit sans doute cet effet, parce que les sons y conservent à-peu-près entre eux les mêmes proportions que dans le chant. Je dis à-peu-près ; car n’y étant pas appréciables, ils ne sauraient avoir des rapports aussi exacts.
Notre déclamation est donc naturellement moins expressive que la musique. En effet, quel est le son le plus propre à rendre un sentiment de l’âme ? C’est d’abord celui qui imite le cri qui en est le signe naturel, il est commun à la déclamation et à la musique. Ensuite ce sont les sons harmoniques de ce premier, parce qu’ils lui sont liés plus étroitement. Enfin, ce sont tous les sons qui peuvent être engendrés de cette harmonie, variés et combinés dans le mouvement qui caractérise chaque passion : car tout sentiment de l’âme détermine le ton et le mouvement du chant, qui est le plus propre à l’exprimer. Or, ces deux dernières espèces de sons se trouvent rarement dans notre déclamation, et d’ailleurs elle n’imite pas les mouvements de l’âme, comme le chant.
§. 59. Cependant elle supplée à ce défaut par l’avantage qu’elle a de nous paraître plus naturelle. Elle donne à son expression un air de vérité, qui fait que, si elle agit sur les sens plus faiblement que la musique, elle agit plus vivement sur l’imagination. C’est pourquoi nous sommes souvent plus touchés d’un morceau bien déclamé, que d’un beau récitatif. Mais chacun peut remarquer que, dans les moments où la musique ne détruit pas l’illusion, elle fait à son tour une impression bien plus grande.
§. 6o. Quoique notre déclamation ne puisse pas se noter, il me semble qu’on pourrait en quelque sorte la fixer. Il suffirait qu’un musicien eût assez de goût pour observer, dans le chant, à-peu-près les mêmes proportions que la voix suit dans la déclamation. Ceux qui se seraient rendus ce chant familier, pourraient, avec de l’oreille, y retrouver la déclamation qui en aurait été le modèle. Un homme rempli des récitatifs de Lulli, ne déclamerait-il pas les tragédies de Quinault, comme Lulli les eût déclamées lui-même ? Pour rendre cependant la chose plus facile, il serait à souhaiter que la mélodie fût extrêmement simple, et qu’on n’y distinguât les inflexions de la voix qu’autant qu’il serait nécessaire pour les apprécier. La déclamation se reconnaîtrait encore plus aisément dans les récitatifs de Lulli, s’il y avait mis moins de musique. On a donc lieu de croire que ce serait là un grand secours pour ceux qui auraient quelques dispositions à bien déclamer.
§. 61. La prosodie, dans chaque langue, ne s’éloigne pas également du chant : elle recherche plus ou moins les accents, et même les prodigue à l’excès, ou les évite tout-à-fait ; parce que la variété des tempéraments, ne permet pas aux peuples de divers climats de sentir de la même manière. C’est pourquoi les langues demandent, selon leur caractère, différents genres de déclamation et de musique. On dit, par exemple, que le ton dont les Anglais expriment la colère, n’est, en Italie, que celui de l’étonnement.
La grandeur des théâtres, les dépenses des Grecs et des Romains pour les décorer, les masques qui donnaient à chaque personnage la physionomie que demandait son caractère, la déclamation qui avait des règles fixes, et qui était susceptible de plus d’expression que la nôtre, tout paraît prouver la supériorité des spectacles des anciens. Nous avons, pour dédommagement, les grâces, l’expression du visage, et quelques finesses de jeu, que notre manière de déclamer a seule pu faire sentir.
Chapitre vii
Quelle est la prosodie la plus parfaite.
§. 62. Chacun sera, sans doute, tenté de décider en faveur de la prosodie de sa langue : pour nous précautionner contre ce préjugé, tâchons de nous faire des idées exactes.
La prosodie la plus parfaite est celle qui, par son harmonie, est la plus propre à exprimer toutes sortes de caractères. Or, trois choses concourent à l’harmonie, la qualité des sons, les intervalles par où ils se succèdent, et le mouvement. Il faut donc qu’une langue ait des sons doux, moins doux, durs même, en un mot de toutes les espèces ; qu’elle ait des accents qui déterminent la voix à s’élever et à s’abaisser ; enfin que, par l’inégalité de ses syllabes, elle puisse exprimer toutes sortes de mouvements.
Pour produire l’harmonie, les chutes ne doivent pas se placer indifféremment. Il y a des moments où elle doit être suspendue ; il y en a d’autres où elle doit finir par un repos sensible. Par conséquent, dans une langue dont la prosodie est parfaite, la succession des sons doit être subordonnée à la chute de chaque période, en sorte que les cadences soient plus ou moins précipitées, et que l’oreille ne trouve un repos qui ne laisse rien à désirer, que quand l’esprit est entièrement satisfait.
§. 63. On reconnaîtra combien la prosodie des Romains approchait plus que la nôtre de ce point de perfection, si l’on considère l’étonnement avec lequel Cicéron parle des effets du nombre oratoire. Il représente le peuple ravi en admiration, à la chute des périodes harmonieuses ; et, pour montrer que le nombre en est l’unique cause, il change l’ordre des mots d’une période qui avait eu de grands applaudissements, et il assure qu’on en sent aussitôt disparaître l’harmonie. La dernière construction ne conservait plus, dans le mélange des longues et des brèves, ni dans celui des accents, l’ordre nécessaire pour la satisfaction de l’oreille6. Notre langue a de la douceur et de la rondeur, mais il faut quelque chose de plus pour l’harmonie. Je ne vois pas que, dans les différents tours qu’elle autorise, nos orateurs aient jamais rien trouvé de semblable à ces cadences qui frappaient si vivement les Romains.
§. 64. Une autre raison qui confirme la supériorité de la prosodie latine sur la nôtre, c’est le goût des Romains pour l’harmonie, et la délicatesse du peuple même à cet égard. Les comédiens ne pouvaient faire, dans un vers, une syllabe plus longue ou plus brève qu’il ne fallait, qu’aussitôt toute l’assemblée, dont le peuple faisait partie, ne s’élevât contre cette mauvaise prononciation.
Nous ne pouvons lire de pareils faits sans quelque surprise ; parce que nous ne remarquons rien parmi nous qui puisse les confirmer. C’est qu’aujourd’hui la prononciation des gens du monde est si simple que ceux qui la choquent légèrement ne peuvent être relevés que par peu de personnes, parce qu’il y en a peu qui se la soient rendue familière. Chez les Romains, elle était si caractérisée, le nombre en était si sensible que les oreilles les moins fines y étaient exercées : ainsi ce qui altérait l’harmonie ne pouvait manquer de les offenser.
§. 65. A suivre mes conjectures, si les Romains ont dû être plus sensibles à l’harmonie que nous, les Grecs y ont dû être plus sensibles qu’eux, et les Asiatiques encore plus que les Grecs : car plus les langues sont anciennes, plus leur prosodie doit approcher du chant. Aussi a-t-on lieu de conjecturer que le grec était plus harmonieux que le latin, puisqu’il lui prêta des accents. Quant aux Asiatiques, ils recherchaient l’harmonie avec une affectation que les Romains trouvaient excessive, Cicéron le fait entendre, lorsqu’après avoir blâmé ceux qui, pour rendre le discours plus cadencé, le gâtent à force d’en transposer les termes, il représente les orateurs Asiatiques comme plus esclaves du nombre que les autres. Peut-être aujourd’hui trouverait-il que le caractère de notre langue nous fait tomber dans le vice opposé : mais si par-là nous avons quelques avantages de moins, nous verrons ailleurs que nous en sommes dédommagés par d’autres endroits.
Ce que j’ai dit à la fin du sixième chapitre de cette section, est une preuve bien sensible de la supériorité de la prosodie des anciens.
Notes
1. Voyez la Génération Harmonique de M. Rameau.
2. Hist. de l’acad. des Belles-Lettres, tom. 5.
3. Première partie, §. 21.
4. Tom. 3, sect. X.
5. Réfl. Crit., tom. 3, sect. XVIII.
6. Traité de l’Orat.
À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISNN 2269-9910.

Jeudi 16 Mars, 2023